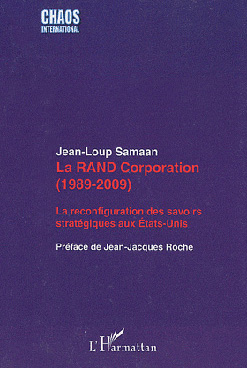
Née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Rand Corporation – pour Research And Development – fut d’emblée assignée par les responsables de l’Armée de l’air américaine à l’étude de la dissuasion. Dans le gigantesque mobile de Calder qui se met en place entre 1945 et 1955, des hommes, tel le malheureux Herman Kahn, s’attelèrent courageusement à penser l’impensable. Relais d’opinion, passerelle mais aussi fusible entre mondes civil et militaire, les think-tank – le terme est issu des chercheurs embarqués dans des tanks durant la Seconde Guerre – vont devenir un maillon décisif du processus décisionnel de politique étrangère et de défense des États-Unis.
De la complexité de la guerre froide, de la rationalité nucléaire et de ses déclinaisons opérationnelles, la mémoire garda un temps l’image esquissée par Kubrick, celle du Docteur Folamour, issu de l’obscure Bland Corporation. Pourtant, l’Histoire retiendra surtout l’effervescence intellectuelle post-1945 – que l’on songe un instant aux conférences Macy et à la naissance de la cybernétique – et, au-delà, l’étrange stabilité de cette guerre de cinquante ans qui, aux yeux de chacun, avait tout intérêt à rester froide.
Bien sûr, la guerre froide n’épuisa pas tout le spectre des possibles stratégiques dans la seconde moitié du XXe siècle. Au fond, les guerres chaudes, par proxy ou non, mais surtout l’ère des décolonisations et la globalisation des échanges, patente à partir des années 70, sont autant de forces profondes qui survivront à la bipolarité. La Rand ne fait d’ailleurs pas exception : ses travaux, au même titre que ceux de ses homologues et concurrents, se diversifient à partir des années 60. Néanmoins, calée sur le rythme de la guerre froide, l’activité de la Rand est recentrée sur les grandes problématiques de dissuasion et d’Arms control lorsque, au seuil des années 80, la guerre fraîche reprend ses droits au détriment de la Détente. Comme le montre cette étude, un recentrage des travaux de la Rand sur son cœur de métier s’opère alors sous l’impulsion de Reagan, celui qui, paradoxalement, contribua à la fin à la guerre froide, mais non pas véritablement à la fin de l’URSS. Pour cela, il faudra un processus interne, porté sans doute bien malgré lui par Gorbatchev. Et c’est là que la problématique centrale du livre trouve tout son intérêt historique.
Comment une organisation créée pour et par un contexte sociopolitique, celui de la guerre froide, pouvait-elle lui survivre ? Comment a-t-elle pu renouveler ses liens avec le sein nourricier, le Pentagone ? Comment des castes d’experts en dissuasion et en soviétologie, incapables de prévoir l’implosion de l’URSS, à l’instar, au demeurant, des autres membres de la communauté épistémique occidentale, et voyant s’effondrer l’ordre ancien au fondement de leurs activités, partant de leur légitimité, parvinrent à se reconvertir ? Dans quelle mesure la continuité l’a-t-elle emporté dans la longue phase de transition des années 90 que nous continuons faute de mieux à dénommer « l’après-guerre froide » ? Pour répondre à ces questions, Jean-Loup Samaan étudie tour à tour la genèse de l’idéologie techniciste qui irrigue les débats stratégiques – RMA (révolution dans les affaires militaires), guerre réseau-centrée etc. – dans un contexte hautement concurrentiel jalonné de « revolving doors » pour les déchus de l’administration sortante et d’immixtion des entreprises de consultants (Booz Allen Hamilton, etc.).
L’auteur se penche ensuite sur le rôle de la Rand dans les mutations doctrinales et opérationnelles du Département de la Défense américain à partir des années 1989-1991 – époque difficile où la Rand perd sa « rente » historique, mais où chacun réapprend que, malgré la tendance aux fameux dividendes de la paix et à la baisse des budgets de défense, réformer et restructurer coûte cher, du moins à court terme. Et la Rand saura, bon an mal an, en profiter, naviguant à vue entre affinités clientélistes traditionnelles (l’Air Force) et nouveaux défis (le cyber, le terrorisme, la contre-insurrection) ainsi qu’entre la reconnaissance forcée d’une phase d’incertitude quant aux priorités stratégiques américaines et la nostalgie pour le projet Solarium du tournant des années 50, qui continue d’ailleurs à animer les think-tank sous l’ère Obama.
Enfin, l’ouvrage se penche sur l’internationalisation de la Rand, en tant qu’outil du soft power américain en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, avec plus ou moins de succès politiques et financiers. Concernant l’Europe, qui reste le terrain de prédilection de l’extension de la Rand en tant qu’instrument d’influence américaine, on pourra notamment se demander jusqu’à quel point la Rand a servi d’impulsion, de relais ou encore de fusible dans les relations transatlantiques, tant sur le dossier de l’élargissement de l’Otan que sur celui de la réforme des armées européennes vers la projection de forces et l’interopérabilité, une demande constante de Washington dans le grand marchandage otanien, sur fond d’enjeux industriels vitaux de part et d’autre de l’Atlantique. Beaucoup reste à éclaircir sur cette période, et les leçons que chacun en tire aujourd’hui – a-t-on manqué une occasion d’intégrer la Russie ? L’obsession de la technologie dans les réformes militaires n’a-t-elle pas eu d’importants effets pervers ? La tutelle maintenue par les États-Unis sur l’Europe n’a-t-elle pas perdu sa raison d’être ? Quoi qu’il en soit, Jean-Loup Samaan achève de manière convaincante son étude de la reconversion de la Rand sous l’angle d’un « soft power » pas si soft que cela, et de la diffusion d’un « prêt-à-penser » ou « prêt-à-porter institutionnel » qui a trouvé certains démentis en Irak et sans doute davantage encore en Afghanistan.
Il reste difficile de tirer de cette étude du « complexe militaro-intellectuel » américain – mis en lumière par Paul Dickson une vingtaine d’années après la mise en garde du président Eisenhower contre le triangle de fer du complexe militaro-industriel – des conclusions pour l’organisation de l’expertise française. Du reste, contrairement au préfacier – le professeur Jean-Jacques Roche, qui a toutefois le mérite de replacer les enjeux sur le plan épistémologique du vieux débat du quantitativisme et du qualitativisme – l’auteur prend garde de pousser trop loin la comparaison transatlantique. Au demeurant, ce n’est plus seulement à l’échelle française mais bien européenne qu’un nouveau modèle pourra émerger et, espérons-le, se révéler viable, à mesure que les forces historiques qui travaillent à la mutualisation des moyens de politique étrangère, de sécurité et de défense entre les membres de l’UE porteront leurs fruits.
Pour ceux qui étudient la sociologie des organisations, cet ouvrage ouvrira de fécondes pistes de recherches appuyées sur un solide dispositif théorique aux accents bourdieusiens, et peut-être encore davantage wébériens (cf. « le désenchantement des stratégistes ? »), voire schmittiens – l’ère des « neutralisations » tient une place importante dans les nombreux passages de cette étude consacrés à l’idéologie techniciste d’outre-atlantique. Pour tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux Relations internationales, le principal apport de cette étude résidera sans doute dans la relecture qu’il offre des évolutions stratégiques des années 90. Une relecture qui ne fait que commencer de part et d’autre de l’Atlantique, à la faveur d’une recomposition globale des équilibres dont l’immédiat après-guerre froide aura été le prélude et, il faut le rappeler, grâce à une nouvelle vague historiographique qui remet elle-même en cause certaines visions simplistes de la guerre froide. À mesure que nos sociétés respirent, ce ne sont plus tant les années 90, mais peut-être la guerre froide elle-même qui commence à être appréhendée comme une longue parenthèse.






