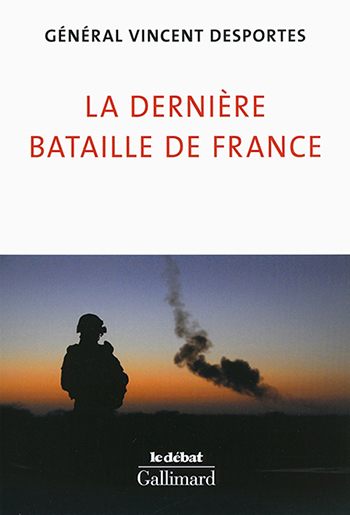
Vincent Desportes n’est pas content. Quand ce général n’est pas content, il le dit. Quand il le dit, cela s’entend. La bataille, dernière selon le titre, ne se joue pas sur le champ, mais dans la situation de nos armées, laquelle ne cesse de se dégrader. Certes, constate l’auteur, nous engageons nos forces à tout va et avec un succès apparent. Mais si nous sommes capables de gagner des batailles, nous sommes incapables de gagner des guerres.
La LPM 2014-2019 touche le fond dans la décrépitude. Le budget de la défense y apparaît, une fois de plus, comme variable d’ajustement : « l’État providence a cannibalisé l’État régalien et l’a délégitimé ». La sacralisation de la dissuasion nucléaire est pour beaucoup dans cette diminution de nos capacités ordinaires. Personne pourtant et quoi qu’on dise, ne saurait prouver son efficacité et Desportes, ici, n’est pas loin de Norlain et consorts. Quant aux Opex, elles servent à « l’amusement du prince » et le haut commandement militaire pèse peu sur les décisions. Féroce, non ?
Sans doute l’analyse de la menace, que tout stratège place en tête de sa réflexion, est-elle un peu pauvre dans cet ouvrage, et son expression trop classique. Dans vingt ou trente ans, dit-on, Londres, Berlin et Paris pourront être rayés de la carte. Par qui ? Pour quoi ? Voici la réponse : faute de menace précise, les armées sont « réservoir de résilience ». Pour s’en tenir aux modernes, Psichari a déjà dit cela, Pierre Gascar aussi [1].
Le livre de Desportes est parsemé d’heureuses formules. Sur la menace (tout de même) : « L’ennemi a déjà pénétré sur le territoire ». Sur la responsabilité de l’intervenant, Colin Powell : « C’est comme à Pottery Barn [2], ce que vous cassez vous appartient ». Ainsi l’Irak aux États-Unis depuis 2002. Ainsi… la Libye à la France.
[1] Pierre Gascar : Les bêtes et Le temps des morts ; Gallimard, 1953.
[2] Célèbre magasin de poteries.



_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)




