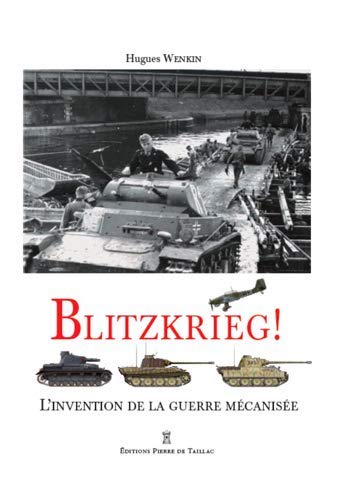
Face à la paralysie stratégique due aux fronts continus de la Première Guerre mondiale, deux réponses très différentes sont proposées par les belligérants. Les Britanniques proposent une solution d’ordre mécanique avec la mise au point des chars d’assaut et leur engagement opérationnel, notamment à Cambrai en octobre 1917. Les Allemands quant à eux explorent la voie tactique, avec l’organisation de « troupes d’assaut » (Stosstruppen) à Riga d’abord en septembre 1917, puis à l’ouest l’année suivante. Dans les années 1930, la combinaison de ces deux approches donnera naissance à ce que les journalistes de l’époque nommeront la « guerre éclair », le Blitzkrieg.
Loin de se limiter à l’approche allemande, comme le titre de son livre pourrait le faire supposer, le propos d’Hugues Wenkin est, plus largement, « d’expliquer comment le monde militaire a apprivoisé le moteur à explosion jusqu’à obtenir une méthode de combat entièrement nouvelle, basée sur la mobilité, la complémentarité des armements, la vitesse d’exécution et le choc ». On peut donc le lire aussi comme une histoire de la genèse de la guerre mécanisée.
L’auteur n’est pas militaire, mais ingénieur de formation, ce qui lui permet de mettre l’accent sur certains aspects techniques souvent négligés par d’autres. Il en est ainsi, par exemple, de la baisse de qualité des blindages allemands à partir de 1944, baisse de qualité due à la perte de l’accès aux ressources de nickel permettant la production d’acier à haute résilience. Précision importante, et souvent négligée, qui relativise l’impact opérationnel de l’entrée en service des nouveaux chars Panther et Tigre II.
Nous n’évoquerons ici que quelques points saillants du livre qui sont de nature à renouveler l’historiographie de la matière.
Le rappel de la bataille de Verdun en tant que laboratoire des tactiques d’infiltration des Stosstruppen mises au point par le capitaine Rohr est le bienvenu. L’année suivante à Riga le général Oskar von Hutier (cousin par alliance de Ludendorff soit dit en passant) va organiser ces troupes d’assaut à un échelon tactique supérieur en s’inspirant de ces premiers résultats. L’idée de motoriser l’infanterie remonterait selon Wenkin à la bataille de Caporetto (octobre 1917), où l’absence de cavalerie aurait empêché les austro-allemands d’exploiter leur percée initiale.
Le rôle éminent du général anglais Fuller dans la conception de la bataille de Cambrai (novembre 1916 – janvier 1917), qui met en œuvre pour la première fois plus d’une centaine de chars, est évoqué fort pertinemment, ainsi que son influence entre les deux guerres. Par contre, s’agissant de la genèse de la conception allemande du Blitzkrieg, l’auteur nous semble sacrifier plus que nécessaire à cette tendance historiographique récente qui consiste à minorer le rôle capital de Guderian, au profit de celui de Fuller et Martel en Angleterre, et de Lutz en Allemagne.
Si Wenkin reprend les conclusions de l’historien allemand Karl-Heinz Frieser (Le mythe de la guerre éclair, 2003) sur l’inexistence d’une véritable doctrine formelle de la guerre éclair au sein de l’état-major allemand en 1940, il n’en reste pas moins que l’idée était déjà en l’air dans les années 1930 avec les choix réalisés concvernant l’organisation et l’équipement sous l’égide de Lutz et de Guderian. On relève ainsi l’avance conceptuelle des chars Panzer III et IV, notamment au niveau de leur ergonomie interne (équipages de cinq hommes aux tâches bien définies, ce qui permettait de raccourcir leur temps de réaction), tous les engins équipés de radios, tout au moins en réception. Leurs futurs adversaires, les chefs de char français, véritables hommes-orchestres en tourelle, sont souvent dépourvus de moyens radio et en sont réduits à communiquer par fanions ou même à quitter leurs engins sous la mitraille pour donner ou recevoir leurs ordres.
L’affaire de Mechelen, où le 10 janvier 1940, deux officiers allemands sont faits prisonniers alors qu’ils se trouvent en possession des plans d’offensive à l’ouest, est relatée dans le détail. Cet incident conduira à abandonner le plan initial d’offensive qui prévoyait un effort principal en Belgique, au profit du plan Manstein du 17 février (le « coup de faucille ») transférant la majorité des Panzerdivisionen (7 sur 10) au Groupe d’armées A dont l’axe d’effort se situe dans les Ardennes autour du XIXe Panzerkorps de Guderian. On connaît la suite…
La bataille de France apparaît très vite comme la confrontation de deux systèmes : « On y voit un modèle méthodique, rigide et manquant de liaisons, confronté à un second, basé sur la souplesse et étudié pour s’attaquer aux faiblesses du premier. » En application des enseignements du premier conflit mondial, le système français est fondé sur le concept de la bataille conduite qui impose « d’éviter les combats de rencontre et d’attendre l’adversaire sur une position déterminée à l’avance et favorisant la défense… Par ailleurs, la chaîne de commandement est organisée d’une manière rigide, appropriée à un combat statique ». L’établissement d’une telle position défensive demandait une dizaine de jours, ce qui justifiait l’approche de Guderian (voir, Souvenirs d’un soldat, Perrin, 2017) qui considérait que tant qu’il restait en mouvement son adversaire ne pourrait rien contre lui.
Wenkin fait intervenir dans son analyse, le « cycle de Boyd » (la boucle OODA), ce qui est encore assez rare dans le milieu de l’histoire militaire pour être souligné. Wenkin estime ainsi la durée du cycle de décision d’une division blindée française à 36 heures et celui d’un groupe d’armées à 72 heures. Le contraste est frappant avec une doctrine allemande qui favorise la mobilité et la rapidité. Un général de division allemand parcourt le cycle de Boyd en une demi-journée, parfois même en quelques heures.
L’auteur mentionne également les grandes lignes du style de commandement allemand, l’Auftragstaktik basé sur la subsidiarité et l’initiative laissée aux subordonnés dans le cadre général de l’intention du supérieur. Si ce style de commandement peut expliquer les premières victoires, il s’érodera au cours de la guerre. Le général von Manteuffel relève ainsi après Stalingrad un déclin de « l’art allemand de la conduite flexible du combat » en raison de l’obligation qui pesait désormais sur tous les officiers de suivre à la lettre les ordres émanant du quartier-général d’Hitler, même pour des points d’importance tactique mineure.
Hugues Wenkin souligne également les limites du Blitzkrieg. Limites tenant souvent au matériel, mais aussi à la taille du théâtre d’opérations.
La qualité des T-34, dont l’existence n’est découverte qu’en juillet 1941, surprendra ainsi les tankistes allemands engagés à l’est qui faisaient déjà face à une très forte supériorité numérique soviétique (13 000 chars contre 4 000). Avec l’apparition progressive de la radio dans les chars alliés, la supériorité technique allemande commencera vite à s’éroder. À la fin de la guerre, la pénurie de métaux rares, déjà soulignée plus haut, fragilisera les engrenages et les boîtes de vitesses des véhicules.
Alors qu’en 1940, la « portée mécanique » des divisions blindées allemandes était de 400 km, à l’est celle-ci doit dépasser 1 000 km. Le risque est alors grand de détruire le matériel par manque de maintenance. C’est donc finalement à bout de souffle que les derniers engins allemands se présenteront devant Moscou en novembre 1941, certaines panzerdivisionen n’ayant plus dans leurs effectifs qu’une demi-douzaine de chars. On pourrait ajouter que ce phénomène n’est pas nouveau, ni d’ailleurs limité à la guerre éclair à l’allemande. À partir du précédent de 1812, Clausewitz en son temps avait déjà relevé l’attrition importante qui accompagne immanquablement toute offensive en profondeur, ce qui lui avait permis de poser en principe la supériorité de la défensive.
Hugues Wenkin dans cette étude vise avant tout à l’exhaustivité en procédant à travers une approche comparatiste de la question où les apports des principales puissances militaires sont évoqués et discutés en détail. On appréciera en particulier les développements consacrés à l’évolution de la doctrine soviétique dans les années 1920, sous l’égide de Frounzé, et à l’effort industriel immense qui l’a accompagnée, appuyé sur des acquisitions de brevets occidentaux.
En conclusion, si l’on peut se trouver en désaccord avec l’auteur sur quelques points de détail, notamment une certaine surestimation du temps de réaction des unités alliées en 1944 (à part quelques exceptions – Patton lors de la bataille des Ardennes – il nous semble que l’« avantage du tempo opératif » ne s’est aucunement inversé à la fin de la guerre comme le soutient Wenkin) et lui reprocher une vision parfois un peu schématique du Blitzkrieg, il faut saluer la publication de cet ouvrage sur un sujet souvent négligé par l’historiographie en langue française. Le livre bénéficie en outre d’une belle finition, il est relié, et son propos est servi par une abondante iconographie.






_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)

