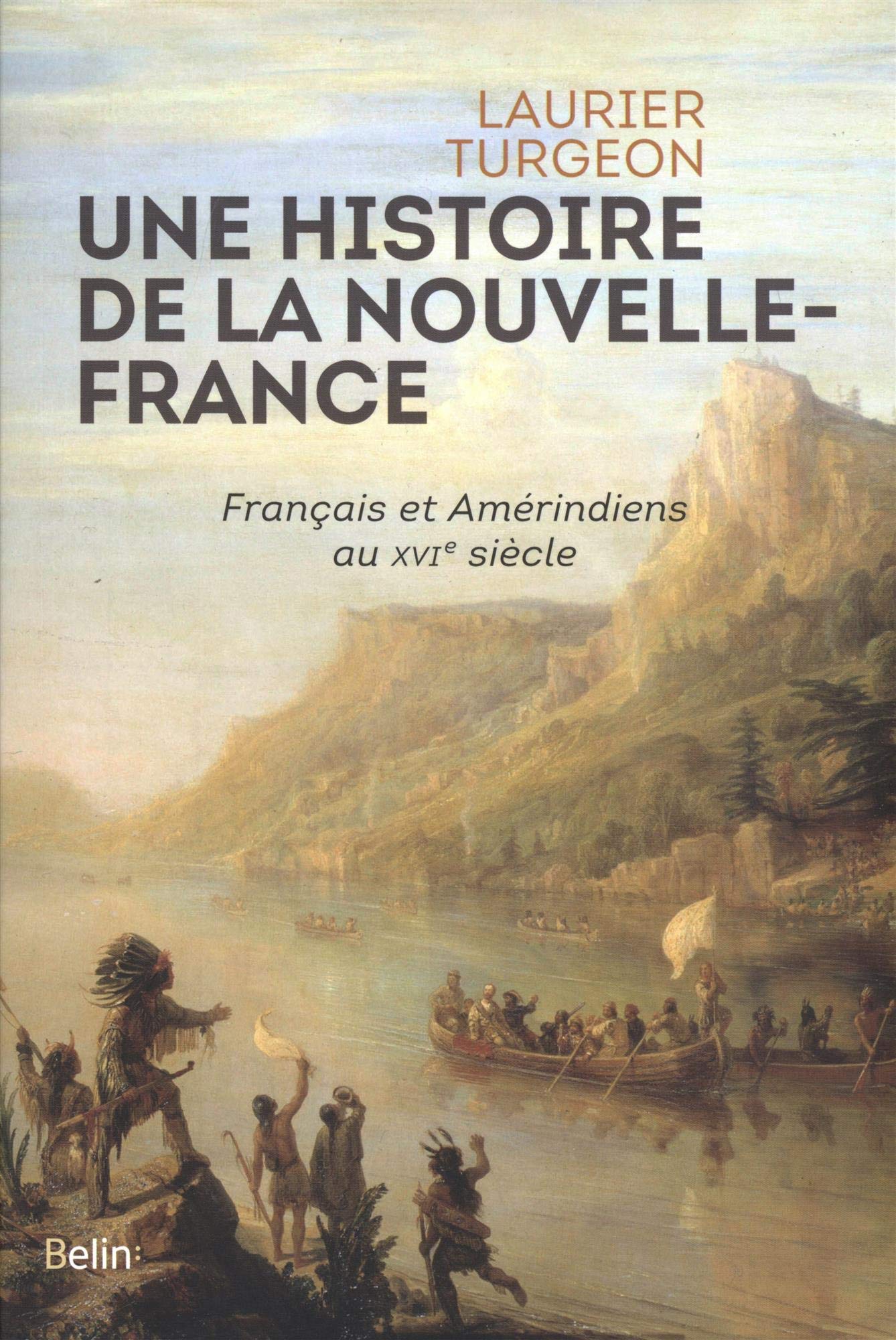
Les Français (Normands, Bretons et Basques) n’étaient venus pêcher la morue près des côtes de Terre-Neuve officiellement qu’à partir de 1508, mais de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, les voilà qui commencent à hiverner sur les bords du Saint-Laurent, avant de remonter vers les Grands Lacs et de toucher le Mississippi. Avant la fondation de Québec en 1608, il y a un siècle d’échanges entre les Français et les Amérindiens dans ce qui est aujourd’hui l’est du Canada. Les rencontres ne sont certes pas toutes pacifiques, mais les objets troqués sont très vite accompagnés de mots.
Pour conduire son étude, Laurier Turgeon (de l’Université Laval à Québec) a choisi quatre biens qui sont échangés (ou prélevés sans opposition) par les Français et les Amérindiens et qui servent de support à la description des différences, mais aussi des points communs entre les deux groupes : la morue, la peau de castor, le chaudron en cuivre et les perles de verre.
L’introduction est un modèle du genre, avec une claire énonciation méthodologique et des objectifs du livre : les Amérindiens ont aussi des objectifs au travers du commerce et ne voient pas les objets échangés de la même manière que les Français (ou les Européens de manière générale). Ici, l’auteur veut faire voir les conséquences de l’échange dans les deux cultures.
Ainsi, en premier lieu la morue. Au XVIe siècle, elle est importée en grandes quantités en France. Comme ce poisson ne rentre pas vraiment dans le régime de la plupart des groupes indiens de la côte, il n’y a pas de concurrence avec les pêcheurs européens. En 1508, le premier navire dieppois est armé pour la pêche et le nombre de bateaux français impliqués augmente rapidement pour atteindre la centaine dans les années 1520. En 1580, il y aurait 500 navires français pêchant la morue de Terre-Neuve (p. 36). Très loin d’être un espace marginal, Terre-Neuve est un pôle qui fait jeu égal avec les Antilles et qui représente le double de la mobilisation en hommes et en navires de l’Amérique du Sud. Pour pouvoir sécher le poisson et extraire la graisse, les pêcheurs s’installent à terre et bientôt naissent des établissements saisonniers (on ne pêche que l’été) puis permanents. Une activité proto-industrielle s’y déploie pour vider, découper, saler et sécher le poisson (on peut pêcher jusqu’à 400 morues par jour et par pêcheur, p. 41). Tout cela exige des capitaux très importants, avec des réseaux de financement complexes. Le produit de la pêche est distribué dans tout le royaume, et toutes les couches de la population mangent de la morue (mais pas les mêmes parties). Son exotisme, très souvent mentionné dans les sources, est partie intégrante de la valeur qu’on lui prête.
Avec le castor, les rapports avec les Amérindiens sont forcément moins fortuits ou épisodiques. Le castor n’est pas inconnu en Europe. On l’appelle bièvre au Moyen-Âge, mais à partir de 1587, le mot grec castor est utilisé pour l’anoblir et rendre compte de son exoticité (p. 147). Largement consommée par les Indiens (viande et peau), sa peau est échangée avec les Français pour se procurer des objets métalliques (haches, couteaux, chaudrons, etc.) et des perles de verre. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le commerce des peaux passe d’occasionnel lors de la pêche (commerce dit de pacotille, c’est-à-dire hors contrat d’armement, p. 94) à organisé. Les « conquêtes » du castor et de la morue (terme d’époque, révélateur de la colonisation pour l’auteur, p. 141) sont étroitement liées, souvent combinées en une expédition de plusieurs navires (p. 125). Si avec le castor on échange d’autres peaux, cette dernière est prépondérante et est transformée en France pour assouvir la formidable demande en chapeaux, manteaux, doublures et manchons. Soit exactement comme au Canada…
Le troisième chapitre traite des chaudrons de cuivre échangés contre les peaux. Le cuivre vient de toute l’Europe pour la fabrication des chaudrons, mais d’objet usuel banal en Europe, il se pare d’un statut rituel arrivé dans les mains indiennes et chasse le cuivre produit localement (p. 168). Les chaudrons servent lors des grandes occasions (« faire chaudière »), mais aussi pour des inhumations. Certains sont découpés pour en faire des bijoux, mais continuent néanmoins de signifier la collectivité.
Dernier chapitre et dernier objet, les perles de verre. Là encore, cette production n’est pas extrêmement valorisée en France. Comme pour les chaudrons, du fait de leur exotisme, leur statut est diamétralement opposé parmi les Amérindiens, avec une autre utilisation (moins sur les habits, plus près du corps et avec des significations complexes). Ces perles étaient terriblement désirées et l’échange peaux contre perles considéré comme juste. Laurier Turgeon établit dans ce chapitre un parallèle entre Europe et Canada, où pierres précieuses et perles de verre sont investies des mêmes significations et d’une même valorisation des origines lointaines (p. 218).
La conclusion sacrifie aux questions actuelles de restitutions d’artéfacts par les musées. L’auteur énonce la réappropriation par les institutions « euro-canadiennes » (archéologues, gouvernements) des objets façonnés par l’homme retrouvés lors de fouilles, dans une « resacralisation muséale ».
Pour un lecteur très novice en archéologie et histoire moderne de l’Amérique septentrionale, ce livre est excellent en plus d’être d’une grande clarté. Sa facilité de lecture doit grandement au talent de Laurier Turgeon à passer d’un sujet à l’autre sans à-coups à l’intérieur des chapitres, qui eux-mêmes se veulent assez autonomes et permettent une lecture séquencée. On apprend bien évidemment une quantité astronomique de choses, comme la présence d’Indiens en France dès les années 1540 ou encore, que c’est le contact avec les Européens qui crée les échanges entre tribus indiennes pour l’échange des biens européens. Malheureusement, un index manque beaucoup à ce volume.
Ce livre est de plus une très belle fenêtre sur les relations entre deux groupes qui se connaissent de plus en plus, jusqu’à ce que les Français deviennent une tribu comme les autres au Canada grâce à la Grande Paix de Montréal en 1701. Une poignée de gens aventureux et qui resteront peu nombreux dans un territoire immense.







