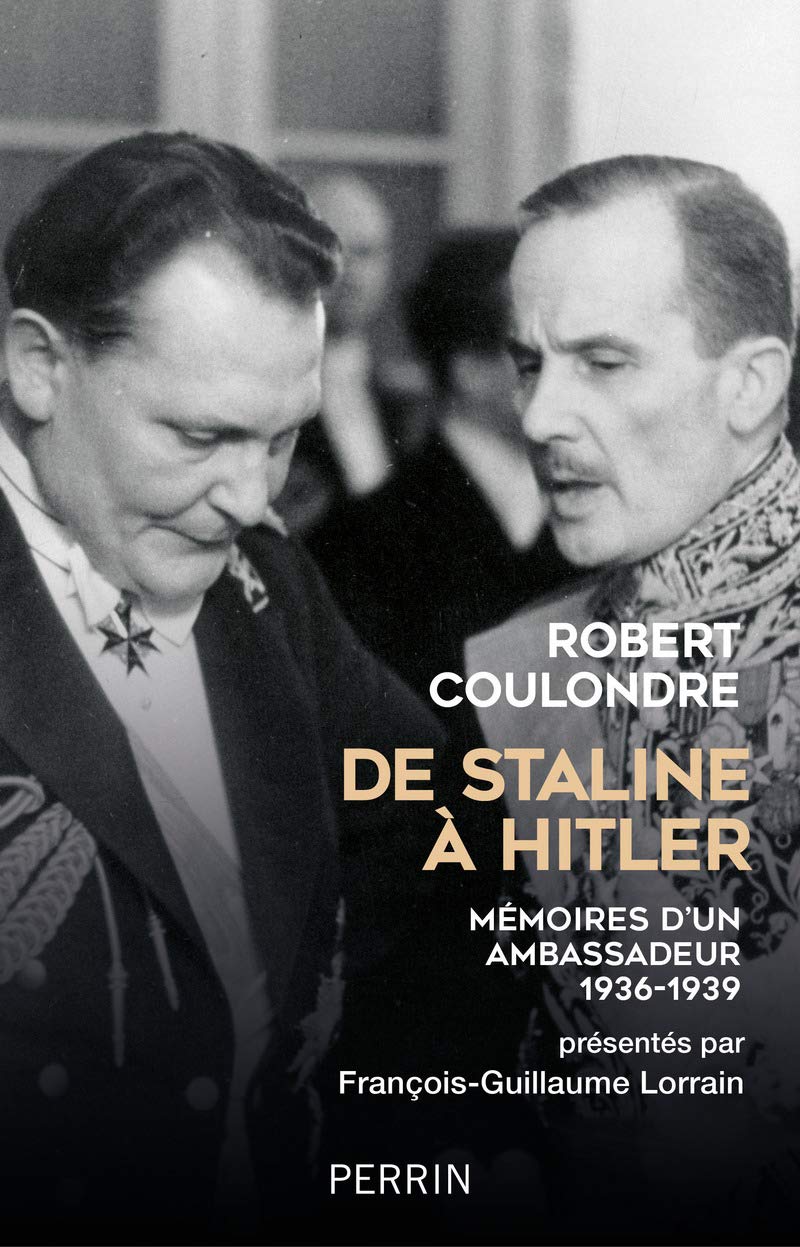
De Staline à Hitler, texte publié en 1950, relate le parcours d’un grand commis de l’État. Aux prises avec deux totalitarismes, il a également représenté la France à Moscou, de 1936 à 1938, puis à Berlin jusqu’en septembre 1939. François Poncet est reconnu, cité, encensé, republié. Robert Coulondre (1885-1959), lui, est oublié. Toutefois, dès le mois d’octobre 1940, il fait partie de cette charrette de diplomates dont le manque d’enthousiasme pour Pétain et le régime de Vichy leur vaut d’être mis en disponibilité. Certains rejoignent de Gaulle, comme Léon Noël, Maurice Dejean, Hervé Alphand, Jean Chauvel et plus tard René Massigli. D’autres, comme Coulondre, pratiquent l’abstention.
Fils du député de l’Hérault, Gaston Coulondre, il embrasse en 1909 la carrière de consul après des études de chinois et un diplôme à l’École libre de sciences politiques. Il est l’un de ces éminents agents qui auront permis d’asseoir la présence française au Liban et en Syrie, mettant notamment le holà aux ambitions de l’émir Fayçal, aiguillonné par les Britanniques et Lawrence d’Arabie.
Si la question de l’Orient le passionne, il bifurque pourtant fin 1919 vers le service des relations commerciales du Quai d’Orsay. Étant l’un des meilleurs experts économiques du ministère, il enrichit les délégations françaises lors des conférences internationales à La Haye (1929), Londres (1931), Stresa (1932). Il est aussi l’un des fleurons de la pépinière protestante du Quai, dont la figure emblématique, René Massigli, est un ami avec qui il travaille à la fin des années 1920 sur l’économie allemande.
À Moscou, il alerte surtout Paris en vain, sur la nécessité de maintenir des liens étroits avec l’URSS de Staline et d’empêcher sa lente dérive vers l’ogre nazi. Il rejoint son poste avec deux missions : détourner l’« œil de Moscou » et obtenir quelques précisions sur la teneur exacte de l’« assistance » de l’URSS en cas de conflit.
Coulondre ne se fait aucune illusion sur l’état d’esprit résolument antisoviétique qui règne à Paris. De fait, la diplomatie française des années 1930, dont l’impératif catégorique est de sauvegarder la paix, évolue sous le paradoxe d’une entente avec un pays dont le régime est abhorré par le personnel politique.
À cet égard, il s’inscrit donc dans la lignée ambitieuse et lucide de Louis Barthou. « Le sort que l’on fera à la Russie décidera dans un sens ou dans l’autre des relations qu’elle aura avec l’Allemagne », avait prophétisé ce dernier dès 1920 à la Chambre des députés. Barthou est le premier et le seul à développer une vraie politique à l’Est. Parallèlement, il met en place un pacte avec les pays baltes et la Tchécoslovaquie.
En France, on prend désormais de haut un pseudo-allié russe qu’on croit définitivement affaibli par les purges et qui s’est isolé sur le plan international. « C’est une crise de croissance d’un pays qui grandit vite », tempère Coulondre qui s’efforce de traduire les grands procès moscovites en termes familiers : un Thermidor organisé par Staline-Robespierre en personne. On ne l’écoute pas davantage. On tient sans doute là, l’une des raisons du silence qui accueille ses Mémoires en 1950, pleine guerre froide.
Il a beau décrire avec objectivité le système de terreur ou effleurer le système concentrationnaire aperçu lors d’un voyage en train, son portrait trop flatteur du tsar rouge dut en hérisser plus d’un : « Staline n’est pas beau, il est grand. On peut ne pas le saluer. Mais il vaut qu’on s’arrête et qu’on contemple. » Considération forgée à l’aune de ses choix stratégiques, mais dont la subtilité dut échapper à l’époque à certains.
« [Sa] force vient de ce qu’il a su percevoir longtemps d’avance certains développements, et notamment l’anéantissement de la Tchécoslovaquie et le quatrième partage de la Pologne ». Son long rapport adressé à Bonnet sur les conséquences de la conférence de Munich (30 septembre 1938) est un modèle du genre. Il l’analyse comme un quitus donné à l’Allemagne pour agir librement en Europe centrale et de l’Est, mais aussi comme une mise à l’écart par ses alliés occidentaux de l’URSS – évincée des négociations.
« Munich a poussé Staline vers Hitler », résume-t-il dans ses Mémoires. « J’ai échoué dans ma mission », conclut-il sobrement à la fin d’une première partie, la plus longue et sans doute le meilleur témoignage français sur l’URSS des années 1930. Il en a perçu les forces, les faiblesses, les intérêts, l’atmosphère, avec une justesse admirable que le recul du temps et la connaissance des événements ultérieurs teintent d’une ombre tragique.
Après avoir failli à mettre en place une entente contre Hitler, on le nomme à Berlin afin de travailler à une entente avec ce dernier. Le portrait du Führer est un passage obligé. Coulondre opte pour la duplicité : « Je pensais rencontrer dans un palais un Jupiter tonnant et je trouve dans une maison de campagne un homme simple, doux, timide sans doute ; j’ai entendu à la radio le Führer à la voix rauque, vociférant, menaçant, exigeant, et je viens de connaître le Hitler à la voix chaude, calme, affable, compréhensif. Lequel est le vrai ? Ou sont-ils vrais tous les deux ? L’un est-il au service de l’autre ? ».
Au cours des derniers mois avant la déclaration de guerre, il n’a plus le temps de décrire le Berlin nazi de la même manière qu’il a rendu compte du Moscou de la terreur. Il voit se lever la mauvaise récolte des graines semées jusque-là. La nouvelle proposition russe formulée le 15 avril 1939 d’un accord franco-anglo-polono-russe est considérée avec méfiance et retard. Les démocraties perdent du temps en tracasseries tandis qu’en face, Berlin en gagne avec Moscou.
Coulondre tient auprès de ses supérieurs un raisonnement plein de bon sens. Mais celui-ci n’est pas retenu. Puisque les Polonais sont réticents à s’allier avec leur voisin soviétique – car faussement persuadés qu’un tel accord inciterait Hitler à les attaquer – avançant d’abord sur une entente franco-anglo-russe, ce qui pousserait ensuite Varsovie, mise devant le fait accompli, à la rejoindre. Le calcul, astucieux, aurait pu faire reculer les Allemands. Or, les Anglais, sans en référer aux Russes, vont se rapprocher des Polonais afin de signer au mois d’août 1939, un pacte d’assistance.
Londres, qui a enfin renoncé à sa politique d’appeasement après la chute de la Tchécoslovaquie, snobe comme à son habitude Moscou au profit de Varsovie. Cette prise en tenaille de l’Allemagne – qui laisse l’URSS en dehors de la manœuvre – a pour conséquence logique, en déduit-t-il, de pousser Hitler vers Staline. Il tire la sonnette d’alarme en entonnant son antienne : la triple alliance franco-anglo-russe. En vain. Les négociations traînent, par la faute des Anglais qui multiplient les vexations à l’encontre des Soviétiques. Une dernière fois aussi, Coulondre rencontre Hitler, qui le convoque le 25 août 1939, deux jours après l’annonce de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop. Le Führer lui charge de transmettre à Daladier qu’il ne reculera pas. « Sur ces mots, Hitler se lève pour me donner congé. Je n’ai certes qu’un modeste rôle d’informateur, mais je ne suis tout de même pas une boîte aux lettres », s’insurge l’ambassadeur, qui prolonge l’entretien en lui affirmant que la France, cette fois, ne reculera pas non plus et qu’il ne croit pas aux prétendues agressions polonaises contre les citoyens allemands à Dantzig.
Le 5 septembre 1939, quelque part en Hollande, vers 5 heures du matin, il monte avec ses collaborateurs dans le train en direction de Paris dont viennent de descendre les 130 membres du corps diplomatique allemand qui a quitté la France. Cet échange ferroviaire lui inspire ce simple constat de chroniqueur : « Les wagons sentent mauvais, ils ont dû avoir chaud. »
Dans le tableau géopolitique des années 1930, nous demeurons obnubilés par le face-à-face franco-allemand. Coulondre fait, lui, toute la lumière sur le facteur russe trop souvent négligé. À cet égard, voilà le principal témoignage hexagonal qui permet de comprendre comment Hitler et Staline signèrent ce qui a été nommé le « pacte des Diables ». ♦







