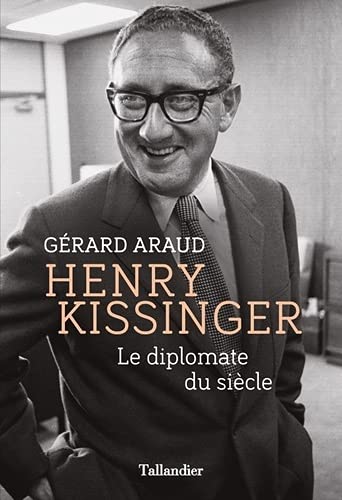
Lorsque Gérard Araud a été nommé, en 2009, Représentant permanent de la France auprès des Nations unies à New York, une de ses premières démarches fut de solliciter un rendez-vous auprès de Henry Kissinger. Il l’invita à un petit-déjeuner chez lui pour une entrevue qui devait ensuite se renouveler régulièrement dans son appartement, au restaurant ou dans son club. L’ancien secrétaire d’État lui dit l’estime qu’il portait à la diplomatie française. Il fit état de ses contacts avec la France, de Gaulle, avec lequel il s’était entretenu longuement en janvier 1969 lors du premier voyage de Richard Nixon à l’étranger, qu’il effectua en France, Giscard, Jobert, Mitterrand et son ami personnel, l’ambassadeur François de Rosen, spécialiste des questions nucléaires. Son ouvrage n’est pas une nouvelle biographie de Kissinger, mais une tentative de poursuivre ce dialogue au bénéfice des Français qui, pour la plupart, estime-t-il, ignorent tout ou presque du personnage. C’est en fait affaire de génération, Henry Kissinger est fort bien connu, comme l’auteur de ces lignes qui ont eu affaire avec les affaires diplomatiques lors de l’année de l’Europe, lancée en avril 1973.
Gérard Araud n’est ni un historien, ni un journaliste. C’est donc sur la base de son expérience diplomatique, en Israël, à New York et à Washington qu’il analyse la carrière de Henry Kissinger avec l’arrière-pensée d’essayer de dissiper les malentendus qui souvent opposent l’opinion publique et le monde feutré de la haute diplomatie. Il lui fournissait ainsi le modèle de ce que Gérard Araud aurait, en toute modestie, aimé être : un praticien qui réfléchit au sens de son action et tente de dépasser le flot quotidien des informations pour deviner les constantes derrière le foisonnement apparemment chaotique des mots et des faits. Peut-être à cause de sa formation scientifique, Gérard Araud refusait le relativisme qui explique tout conflit par des spécificités locales irréductibles à des explications générales et il se méfiait des émotions qui rendent impossible toute analyse objective d’une situation. Dans toute crise, dans tout conflit, j’essayais de remonter du particulier au général pour dégager les lois qui régissent les relations internationales.
Le Moyen-Orient, premier terrain d’expérience de Gérard Araud et espace diplomatique dans lequel Henry Kissinger développa ses vastes talents après la guerre d’octobre 1973, offrait le spectacle quasiment permanent des retournements d’alliances entre des États dont, à l’évidence, Israël n’était pas la principale préoccupation. Ce n’était ni hypocrisie ni inconstance, mais la recherche par les États d’un équilibre régional comme garantie de leur sécurité dans un contexte de frontières souvent récentes et d’existences nationales incertaines. Les Sommets pouvaient se succéder pour appeler à la lutte contre Israël, mais, dans les faits, ces incantations dissimulaient mal un monde de fer où des pays n’avaient qu’une obsession : leur sécurité face à leurs voisins, tout aussi arabes qu’eux.
Depuis quinze siècles, Le Caire, Damas et Bagdad se disputaient la prééminence régionale ; ils continuaient à le faire, qu’Israël existât ou pas. C’était là la réalité qu’il fallait prendre en compte et non des discours qui dissimulaient plus qu’ils ne révélaient. La recherche d’un équilibre des puissances au Moyen-Orient comme garantie de la paix était infiniment plus importante qu’une hypothétique solidarité avec des organisations palestiniennes que chaque État arabe essayait d’ailleurs de contrôler pour ses propres objectifs nationaux. « L’ennemi de mon ennemi est mon ami » semblait résumer la politique étrangère dans cette partie du monde. C’en était presque mathématique. Le rapprochement récent entre Israël et les monarchies du Golfe a d’ailleurs confirmé mes analyses. Oublié l’arabisme, oubliée la Palestine, oublié l’Islam, il reste une réalité beaucoup plus puissante que l’idéologie ou que la religion : la peur, en l’occurrence la peur de l’Iran. C’était partout la même obsession de la sécurité et la même recherche de la puissance pour l’assurer. Le monde en devenait sombre, mais prévisible. Or, je trouvais dans les ouvrages de Kissinger, en particulier dans Diplomatie, la confirmation historique et intellectuelle de mes intuitions acquises « sur le terrain ».
Gérard Araud portait un autre intérêt à Henry Kissinger, lié à sa pratique du pouvoir. La plupart des Américains connaissent l’homme et nourrissent à son égard des sentiments souvent passionnés pour voir en lui un criminel de guerre, un « capitulard » face au communisme ou un génie, mais un brin maléfique ; en tout cas un étranger aux valeurs américaines qui suscite autant l’admiration que la méfiance. Des « procès » ont été conduits par des militants d’extrême gauche pour le condamner et des livres ont été écrits pour le rendre responsable de massacres et de coups d’État, voire de génocide, tandis qu’études et biographies continuent régulièrement d’être publiées à son sujet. Un livre résume l’opprobre qui s’attache, dans certains milieux, au nom de Henry Kissinger : The Trial of Henry Kissinger (Le Procès de Henry Kissinger), publié en 2001 par l’essayiste Christopher Hitchens qui conclut que l’ancien secrétaire d’État mérite d’être poursuivi pour « crimes de guerre, crimes contre l’humanité et atteintes au droit international coutumier et écrit, y compris pour complot visant à assassiner, kidnapper et torturer ».
En définitive tel apparaît le « dear Henry » : un grand diplomate dans ses œuvres, avec ses ombres et ses lumières que reflètent l’admiration, mais aussi les controverses qui l’entourent. Il est d’abord un fils de l’Europe et qu’il l’est resté. Né en 1923 à Fürth, héritier d’une histoire tragique, ensuite parce qu’il a joué un rôle central dans l’histoire du monde à un moment particulier – la fin de la guerre du Vietnam, 1973-1975, l’ouverture vers la Chine, 1971-1972, la détente et la guerre du Kippour, 1972-1973 – et enfin parce qu’il incarne de manière exemplaire les dilemmes du diplomate souvent obligé de prendre des décisions ou d’accepter des situations dont il sait qu’elles scandalisent les consciences de beaucoup et ne satisfont pas la sienne. La carrière de Kissinger introduit également dans l’équation l’incertitude de la personnalité humaine, de ses erreurs et de ses faiblesses. Or, notre temps aime juger, condamner ou absoudre à partir d’un point de vue absolutiste qui refuse de prendre en compte la faillibilité et les faiblesses de l’homme. Par ailleurs, dans nos sociétés démocratiques, où les aspérités doivent disparaître et les bons sentiments l’emporter, on fait mine de croire que nos grands hommes étaient des chefs charmants, des collègues loyaux et des adversaires généreux… L’Histoire avance l’auteur n’a pas encore émis son jugement sur Henry Kissinger, mais, dès à présent, il est possible de conclure que ce ne sera pas œuvre facile. Peut-être faudra-t-il attendre une époque où tout ne se résume pas au noir et au blanc. Il conviendra d’espérer parce que ces temps n’apparaissent pas encore en vue. ♦







