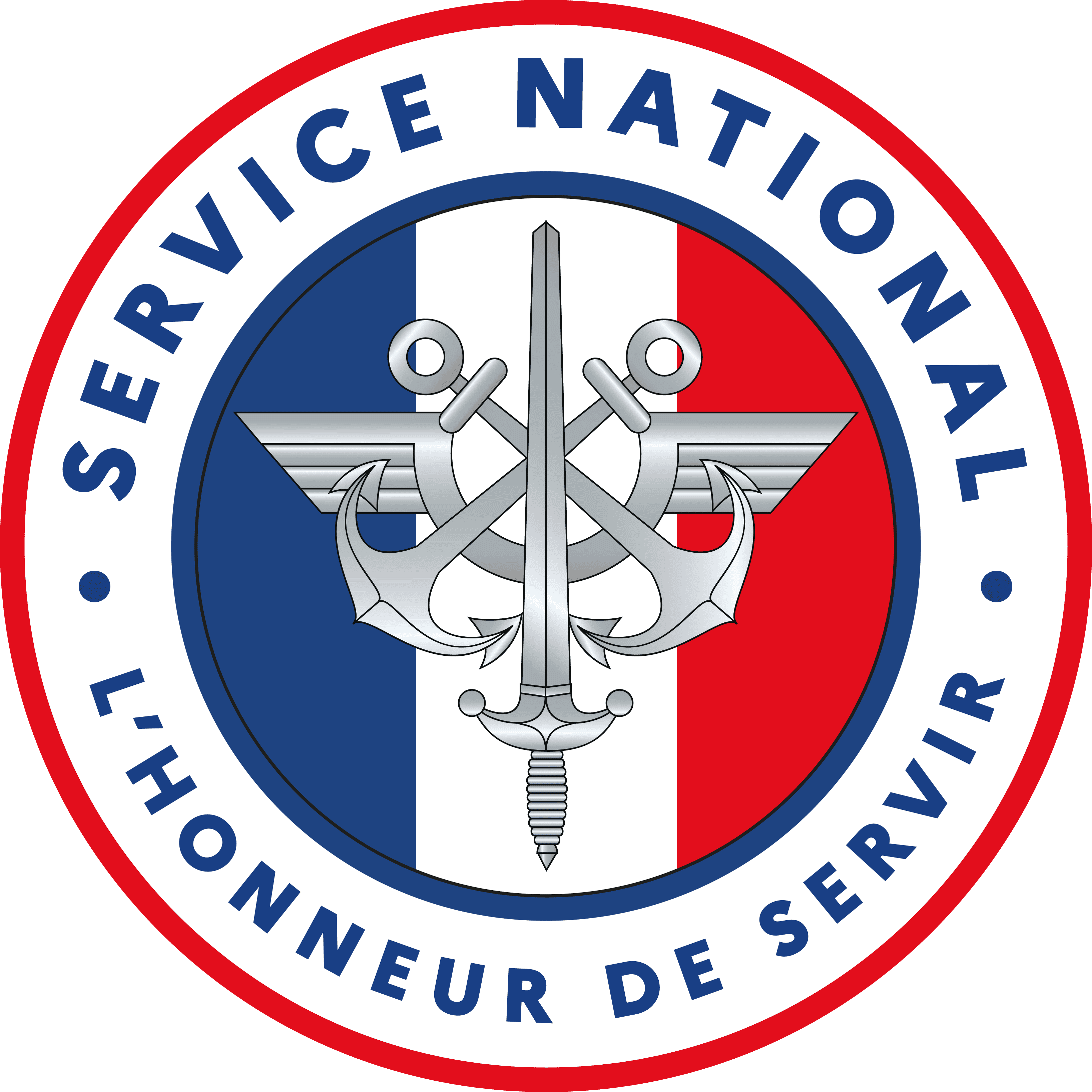Né en Palestine en 1915 (ce qui en faisait donc un « sabra » dans le vocabulaire israélien), de parents qui avaient immigré au début du siècle et rejoint un kibboutz, Moshe Dayan conserva toujours une certaine distance à l’égard de l’esprit communautaire si répandu à cette époque dans son environnement familial. « Le collectivisme absolu, la vie en groupe de même que l’égalité ne conviennent ni à mes habitudes ni à mon tempérament », écrivit-il plus tard. Le conformisme non plus : en 1935, il invite à son mariage la tribu arabe locale au grand complet au grand dam de son entourage.
La montée des périls des années 1930 en Palestine fit office de catalyseur. À la suite du soulèvement arabe de 1929, l’armée anglaise intervient du côté des sionistes installés en Palestine. La Haganah (la force d’autodéfense juive) monte alors en puissance et coopère officiellement depuis 1936 avec la puissance mandataire. Ses membres reçoivent alors une instruction militaire.
Dayan rejoint la Haganah et en devient vite instructeur. Le garçon solitaire et mal considéré au kibboutz, parce qu’il était plutôt individualiste, se découvrit alors meneur d’hommes. Il rédige bientôt un manuel de tactique où il fustige les rites de parade propres à l’armée anglaise et ses uniformes peu fonctionnels. Il y préconise des principes d’action plus offensifs.
Il perd un œil en juillet 1941 (sans doute par une balle française) alors qu’il observe à la jumelle des positions vichystes sur la frontière syrienne pour le compte de l’armée anglaise. Cette expérience en tant que « guide » d’une unité britannique détaché par la Haganah lui apprit de son propre aveu « les limites d’efficacité d’une armée soumise à des règles rigides ». Il critiquera ainsi plus tard les méthodes opérationnelles d’une armée régulière britannique pourtant érigée en modèle à l’époque. Trop de formalisme, pas assez d’improvisation à ses yeux.
Lorsque la guerre d’indépendance de 1948 se déclenche, Dayan est nommé à la tête d’un bataillon et se distingue immédiatement dans les combats de la vallée du Jourdain. Les témoins le créditèrent « d’un sang-froid et d’une intelligence tactique en tout point exceptionnels ». Il intervient ensuite sur le front sud, puis à Jérusalem. Dans les deux cas son indiscipline suscite une enquête pour insubordination, vite classée sans suite sous l’influence du Président Ben Gourion, qui sera souvent son protecteur dans les moments difficiles. Il émanait en effet de lui « une sorte d’insouciance talentueuse et victorieuse en parfaite adéquation avec l’image de jeunesse décomplexée que Ben Gourion cherchait à donner de l’Israël nouveau », comme le résume l’auteur.
À la fin de la guerre de 1948, Dayan devient commandant du secteur sud (le Neguev) avec le grade de général de division. Il avait tout juste trente-quatre ans.
Quatre ans plus tard, en 1953, Dayan est nommé chef d’état-major de Tsahal. Il révolutionne les mentalités au sein de l’armée. Il décide d’abord d’affecter l’ensemble des crédits budgétaires à l’armement au détriment du confort et de l’habillement des soldats. Il cherche aussi à insuffler une mentalité offensive à ses hommes en décrétant notamment qu’un officier qui ordonnerait un repli serait destitué de son commandement à moins d’avoir perdu une grande partie de ses hommes (on parlait même d’un ordre de grandeur de 80 %). Pour Dayan, l’encadrement militaire avait pour principale vocation de galvaniser les troupes. En plus du talent manœuvrier, il exigeait que ses officiers aient foi dans leur action et communiquent cette même foi à leurs soldats. Ariel Sharon, son ancien subordonné, critiquait toutefois son style de commandement : « Il avait l’habitude de donner ses instructions de manière ambiguë, laissant une large place à l’initiative et à l’interprétation. Si les résultats étaient là, tout allait pour le mieux. Mais en cas d’échec, la responsabilité n’était pas la sienne, mais la vôtre. »
Les efforts de Dayan payèrent. Tsahal connut une victoire éblouissante dans le Sinaï en 1956, où l’armée égyptienne fut vaincue en huit jours seulement, du 26 octobre au 5 novembre, à l’issue d’une opération éclair parfaitement menée (couplée avec l’intervention franco-britannique à Suez). Le tout pour un coût relativement limité (172 tués israéliens). La pression internationale conduisit toutefois Israël à évacuer rapidement les territoires conquis. Cette victoire conféra à Dayan, qui passa toutes ses journées sur le front, un statut de héros national en Israël tout autant qu’une stature internationale.
Entre la guerre d’indépendance et la guerre des Six Jours, Tsahal s’est identifiée étroitement avec Israël. Pour Ben Gourion, Tsahal incarnait l’image idéalisée que le pays se faisait de lui-même. Une image d’efficacité et de confiance en soi. Moshe Dayan fut le visage officiel de cette armée avec son mépris des conventions et des règles établies, tout autant que son refus de la routine et de la discipline.
Il quitta néanmoins l’uniforme peu après et entra en politique à la tête du ministère de l’Agriculture, puis, en 1967, de celui de la Défense. Ministre de la Défense non conformiste, Dayan tenait à ce que ses tournées d’inspection se déroulassent sans cérémonie et sans qu’aucun détachement ne lui rendît les honneurs. Il écrivit plus tard dans ses Mémoires : « Les champs de blé, les vergers, les semis de légumes et les étables étaient plus inscrits dans mon sang que les tanks et les canons. »
Moshe Dayan se retrouva malgré tout au premier plan pendant la guerre des Six Jours où « sa modération relative, analyse l’auteur… signifiait clairement qu’il était passé du rôle de chef de guerre à celui de leader politique ». Nommé chef d’état-major trois années auparavant, Yitzhak Rabin avait déjà largement comblé les lacunes capacitaires évidentes de Tsahal et constitué une armée moderne.
Après la guerre, Moshe Dayan conservera ses fonctions de ministre de la Défense et se vit confier en plus, par le Premier ministre, l’administration des territoires occupés. Sans succès, il prônera l’idée d’une confédération israélo-arabe fondée sur une coopération économique. Il tenta malgré tout de normaliser les relations entre l’occupant et les structures municipales arabes antérieures à 1967.
En 1969, Ariel Sharon se trouva en désaccord avec l’état-major sur la construction de la ligne Bar-Lev dans le Sinaï, sans que Dayan, qui n’était pas loin de partager les mêmes vues, ne daignât le soutenir. Sharon écrira plus tard que ce dernier était « aussi lâche à prendre des positions publiques difficiles qu’il pouvait être courageux sur le champ de bataille ».
La guerre du Kippour en 1973 fut le chant du cygne de Dayan. Le haut commandement (qui avait été entièrement renouvelé depuis la guerre des Six Jours) refusa d’accéder à ses demandes d’information et de lui communiquer chaque jour les plans de campagne actualisés. Il lui reprochait en outre de chercher à intervenir trop fréquemment dans le domaine tactique. Isolé et marginalisé, à la différence du conflit précédent, Dayan n’avait plus aucune prise sur les décisions opérationnelles. Cela n’empêchera pas l’opinion publique et la classe politique de le tenir pour responsable des échecs initiaux et des importantes pertes en vies humaines de la guerre du Kippour (quatre fois plus importantes en valeur absolue que lors de celle des Six Jours). Devenu un bouc émissaire parfait des défaillances du haut commandement, il fut l’objet d’un véritable lynchage collectif. « Cette même vague qui l’avait porté au pinacle lors de la guerre des Six Jours [conclut l’auteur] le vouait désormais aux gémonies avec tout aussi peu de tempérance ou de rationalité. » Il fut ainsi considéré comme « responsable de décisions sur lesquelles il avait en fait peu de prise, de la même façon qu’il avait été célébré, une guerre auparavant pour un triomphe dont il n’était pas, et de loin, le premier responsable ». On ne peut nier toutefois que les déficiences en armes et en munitions étaient de son fait. Le fait que Tsahal ne disposait que de réserves suffisantes pour une petite semaine lui incombait aussi. En revanche, il ne pouvait être tenu responsable des décisions opérationnelles qui relevaient exclusivement du quartier général de l’armée. Dans cette épreuve, Dayan fut soutenu par le Premier ministre Golda Meir. Par contre, le seul officier supérieur à prendre son parti fut Ariel Sharon, lequel fit remarquer que Moshe Dayan fut le seul à s’être déplacé dans la zone des combats, le chef d’état-major de Tsahal, Elazar, et le commandant du front sud Gonen, étant restés sagement à l’abri dans leurs bunkers de commandement. L’année suivante, en 1974, une commission d’enquête indépendante, la commission Agranat (du nom de son président, chef de la cour suprême), blanchit Dayan et recommanda par contre les démissions du chef d’état-major et du commandant du front sud…
L’histoire se souviendra de Moshe Dayan comme le principal architecte du traité de paix avec l’Égypte. Après la signature des accords de Camp David, Henry Kissinger lui rendit hommage : « La guerre était le métier de Dayan, la paix fut son obsession. »
« Cet homme si complexe, porté aux nues ou vilipendé, avait su incarner son pays quatre décennies durant avec ses qualités et ses défauts », résume Georges Ayache. Complexité qui est d’ailleurs bien décrite dans ce livre. Surnommé péjorativement « l’Arabe » par Lévi Eshkol, Premier ministre dans les années 1960, en faisant référence à ses bonnes relations avec les populations palestiniennes, Dayan fut aussi un homme à femmes dont les frasques extraconjugales choquèrent la bonne société israélienne. Il fut aussi, et ceci est moins connu, un archéologue amateur et un pilleur de tombes interpellé par la police en 1965 pour s’être livré à des fouilles sauvages. En 1969 il se retrouva même enseveli lors d’un accident de fouille. Gravement blessé à cette occasion, sa santé ne s’en remettra jamais tout à fait.
Sa biographie s’identifie avec la période « héroïque » de l’histoire d’Israël, l’époque cruciale de la formation de l’État, avant son remplacement par des leaders issus d’une autre génération. On y rencontre avec plaisir quelques grandes figures : Ben Gourion tout d’abord, et Ariel Sharon, son protégé et son rival. On est d’ailleurs frappé par cette image de Ben Gourion en 1942, lequel voyant la guerre venir, tente de rattraper son manque de connaissances militaires en se plongeant frénétiquement dans la lecture de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide. Le futur chef d’État est en avance sur les responsables de la Haganah et pense déjà à la nécessité de doter le pays d’une armée moderne et aux moyens d’y parvenir. ♦