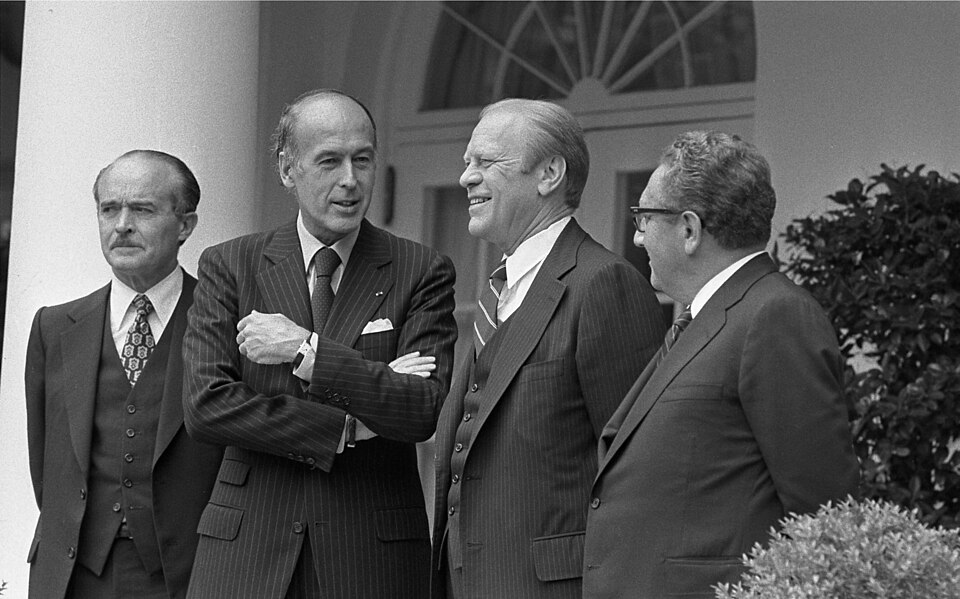Outre-mer - Évolution de la crise politique dahoméenne - Élections générales en Guinée, au Sénégal, au Tchad
Marquée encore par quelques épisodes, la crise politique dahoméenne a évolué vers l’apaisement. Par le référendum du 5 janvier 1964, le corps électoral a approuvé à des majorités exceptionnelles – 92 % de participation au scrutin, 99,80 % de OUI – le projet de Constitution proposé par le gouvernement provisoire du colonel Soglo. Elle est la troisième en date après la Constitution du 15 février 1959 et la Constitution du 26 novembre 1960, celle-ci caractérisée par la prééminence du président de la République par rapport au vice-président de la République et à l’Assemblée nationale.
Le Titre Ier relatif à l’État et à la Souveraineté, proche de celui de la Constitution française, reconnaît la pluralité des partis politiques : « ils se créent librement ». En principe, le parti unique devrait cesser d’être. Sont constitutionnalisés divers droits et devoirs du citoyen : liberté de la presse, liberté de réunion, liberté d’association, inviolabilité du domicile, secret de la correspondance. Comme sous la précédente Constitution, le pouvoir exécutif est bicéphale. Mais, alors que le président de la République avait des attributions générales et le vice-président de la République des attributions très limitées, désormais la situation est inversée.
Le président de la République conserve la plupart des attributs classiques du chef de l’État : veiller au respect de la Constitution et assurer par son arbitrage la continuité de l’État, présider le Conseil des ministres, promulguer les lois et, en Conseil des ministres, en demander une deuxième lecture, accréditer les ambassadeurs, exercer le droit de grâce. Avec l’accord du chef du gouvernement et du Bureau de l’Assemblée nationale, il peut soumettre un texte au référendum.
Il reste 83 % de l'article à lire
Plan de l'article



_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)