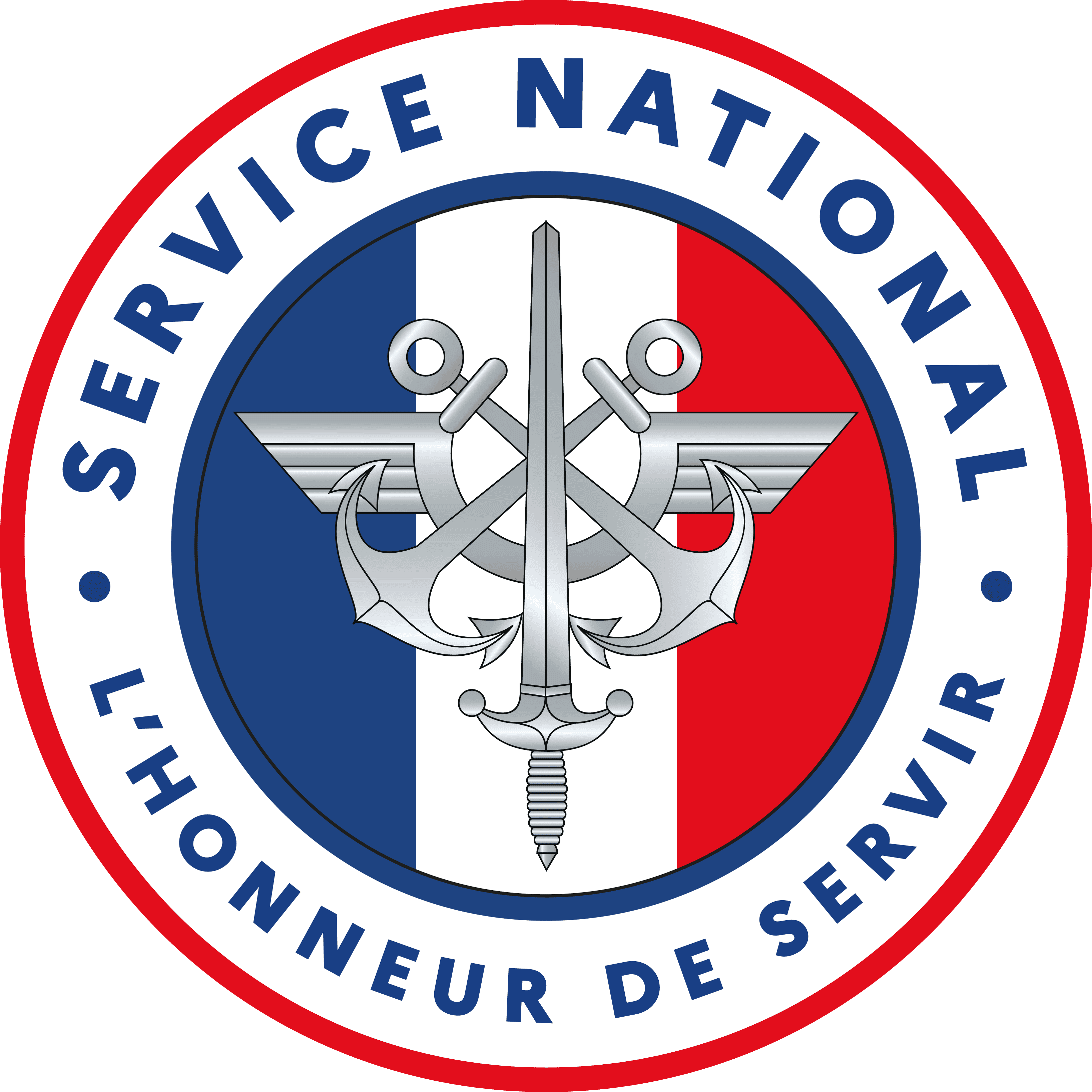Institutions internationales – L’ONU et les passions religieuses irlandaises – La Suisse et l’ONU – L’aveuglement, la passion, la loi – La dévaluation française et l’Europe
L’été n’a pas été calme. Certes, nul ne pensait que l’anniversaire de l’occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie [en août 1968] pourrait ne pas être marqué par des manifestations populaires, donc par une répression, et nul ne pensait davantage que la guerre du Vietnam et la tension au Moyen-Orient pourraient prendre des aspects fondamentalement nouveaux, du moins dans le sens de l’apaisement. Mais il eut fallu être devin pour prévoir les violences qui ont affecté l’Irlande du Nord, et, quels qu’aient pu être les déséquilibres monétaires, la dévaluation du franc.
Qu’il s’agisse du drame vietnamien, de l’univers kafkaïen dans lequel vivent les populations du Moyen-Orient, des affrontements irlandais, ou de la dévaluation du franc, ces événements ont d’abord concerné les gouvernements, et les institutions internationales n’ont pu qu’en enregistrer les développements ou essayer d’en restreindre ou d’en canaliser les conséquences. Mais il n’en est pas moins intéressant d’esquisser quel impact ces événements ont eu sur les institutions internationales, comment elles en ont influencé le déroulement.
L’ONU et les passions religieuses irlandaises
Il reste 94 % de l'article à lire