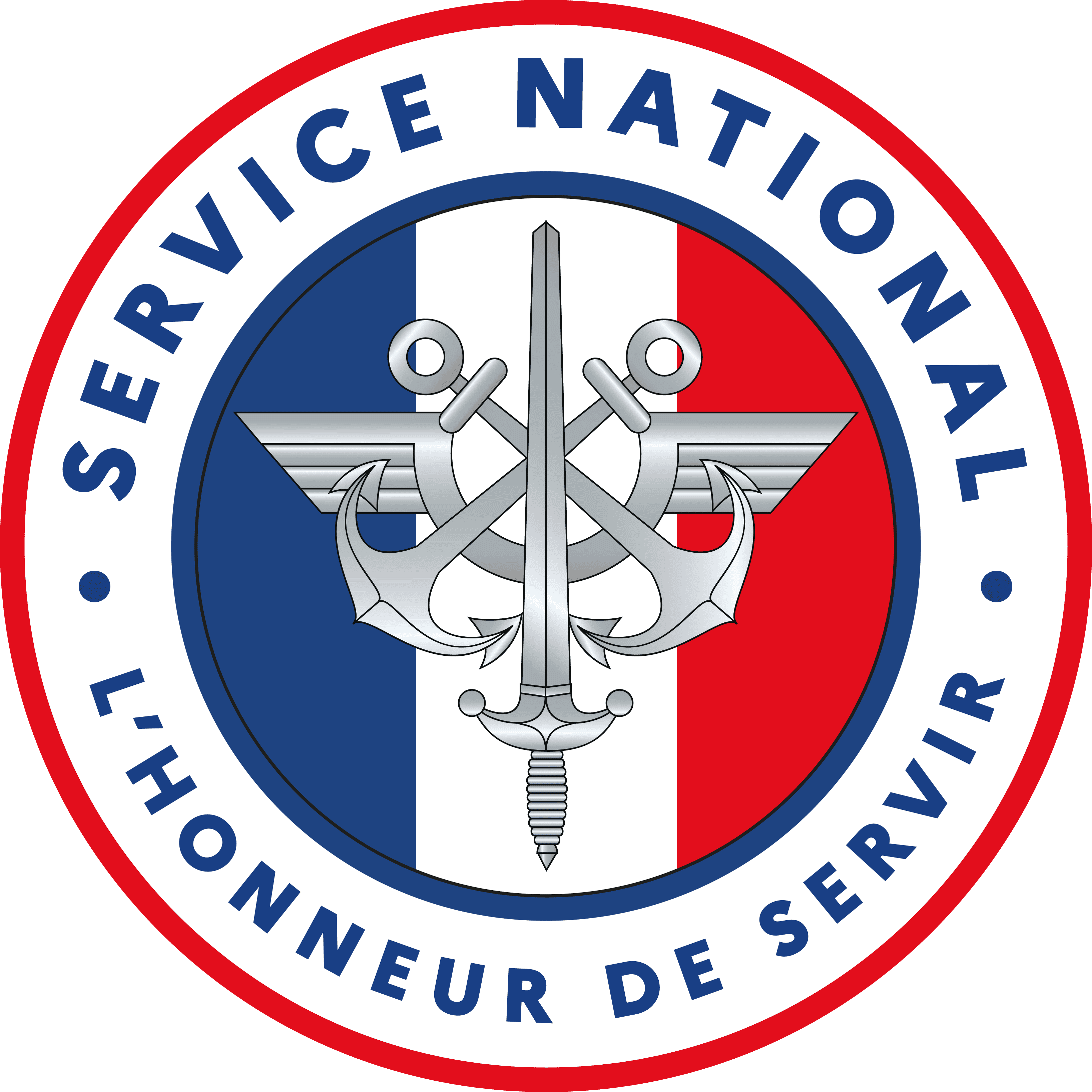Institutions internationales - Les agriculteurs et l'Europe - Une politique agricole commune - Préparatifs et réticences britanniques - La Livre sterling et l'Europe - Difficultés de l'Europe monétaire
Tandis que la guerre du Vietnam devient chaque jour davantage une donnée permanente de la situation internationale, à la fois cause et expression de certaines tensions, la crise du Moyen-Orient (où la « mission Jarring » a été provisoirement mise en sommeil) paraît évoluer vers une situation qui, si elle n’est pas la paix, n’est pas pour autant la guerre ouverte. Sans doute une telle situation est-elle comparable à l’équilibre instable des physiciens, et hypothéquée par le risque constant d’incidents qui, s’aggravant eux-mêmes par la logique de la violence, aboutiraient à une nouvelle conflagration. Mais les passions demeurent telles (encore que d’un côté et de l’autre certains s’efforcent de les « désamorcer ») et l’on conserve un tel souvenir des inquiétudes suscitées à de nombreux moments par les risques d’« escalade », que l’on a tendance à se satisfaire de cette absence de guerre ouverte, un peu comme, à l’époque de la guerre froide, on estimait que l’absence de conflit ouvert entre les États-Unis et l’Union soviétique devait combler les vœux.
Mais un autre drame a éclaté : le Pakistan oriental a sombré dans une guerre civile qui, même si une solution est trouvée dans les prochaines semaines, aura non seulement fait des dizaines de milliers de morts, mais créé un nouveau foyer d’instabilité en Extrême-Orient, car il serait surprenant que l’Union soviétique et la Chine ne se trouvassent pas rivales dans cette région, cependant que les États-Unis ne pourraient guère se désintéresser du golfe du Bengale. À dire vrai, cette explosion a été le résultat de l’accumulation des antagonismes et des méfiances entre les deux ailes du Pakistan, depuis sa création en 1947 (et qui ne se souvient de la guerre du Cachemire ?). Mais il a fallu l’intervention d’un élément « naturel » pour précipiter les événements. En novembre 1970, un ouragan s’abattit sur les côtes du Bengale oriental, où plusieurs centaines de milliers de personnes trouvèrent la mort. Le manque de rapidité des secours venus de l’Ouest, le peu de moyens mis en œuvre par le gouvernement firent que cette catastrophe donna lieu à une reprise de la campagne antigouvernementale. Les élections de décembre confirmèrent le mécontentement : la ligue « Awami » remporta une éclatante victoire, véritable plébiscite en faveur du leader autonomiste, le cheik Mujibur Rahman, qui enleva tous les sièges de l’assemblée régionale du Bengale oriental, et 163 sièges de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire la majorité absolue. L’apolitisme qui avait caractérisé la vie au Pakistan oriental fit place à une relance des revendications autonomistes de Dacca, qui tient « le grand capital » de la région occidentale pour responsable de son état de sous-développement. C’est tout le continent hindou qui est affecté par cette crise, dont on imagine mal qu’elle pourrait trouver une autre solution que basée sur la force.
Ressentiments économiques et sociaux, mais aussi heurts ethniques : ces diverses causes illustrent la fragilité de certaines constructions politiques. Alors que l’on parle de raison, les passions l’emportent dans certaines régions, des passions ancestrales, où réapparaissent parfois les antagonismes raciaux et religieux. Paradoxalement, c’est au Vietnam que le conflit est le plus dégagé de ces causes, qu’il est le plus « politique ». Sans doute a-t-on pu parfois enregistrer certaines manifestations du ressentiment du « Jaune » à l’égard du « Blanc », mais les passions se sont surajoutées à des motivations politiques, alors qu’en d’autres régions les arguments politiques se sont surajoutés aux passions raciales et religieuses.
Il reste 85 % de l'article à lire
Plan de l'article