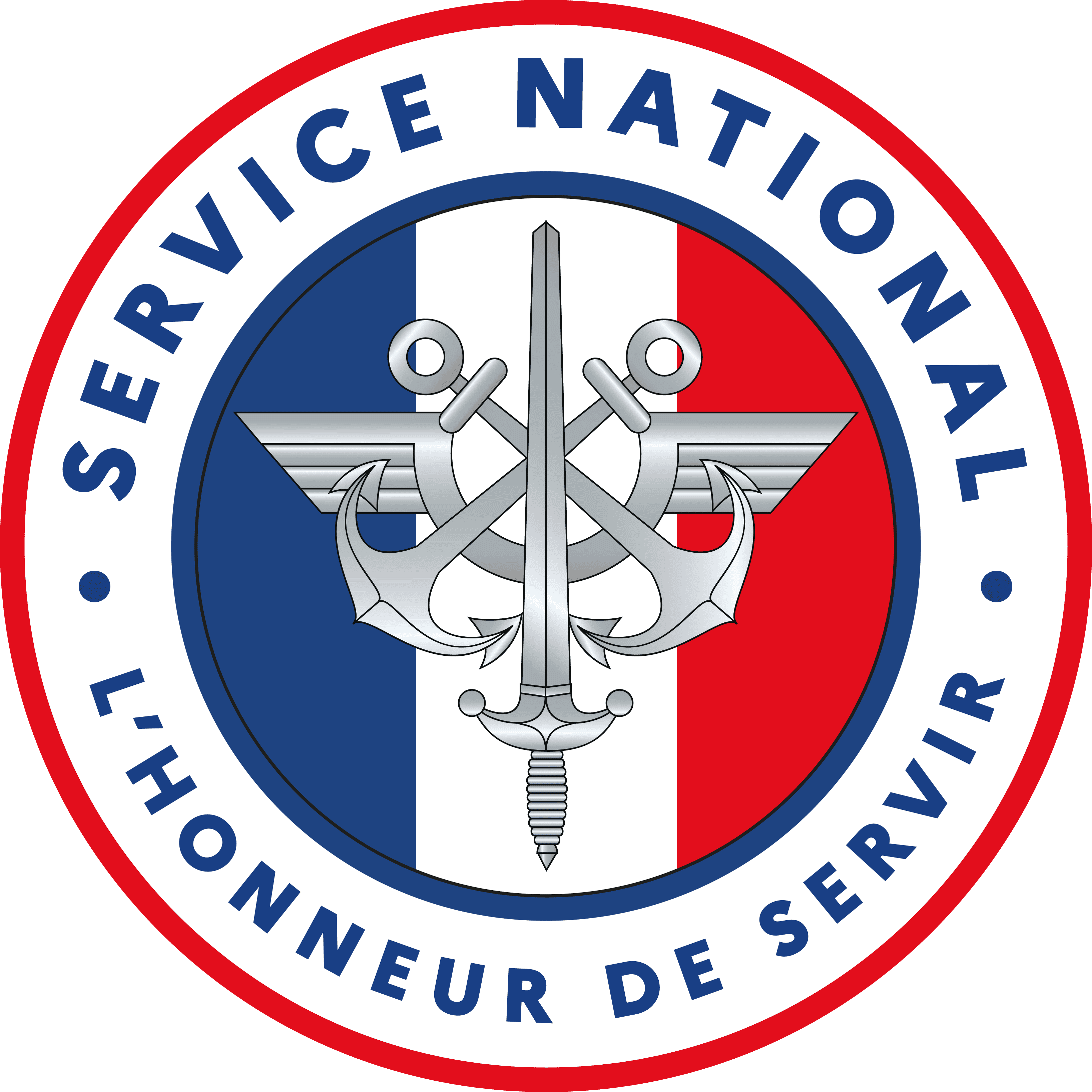Institutions internationales - Le choix « national » du président de la Commission des communautés européennes - Nouvel accord des « Six » sur l'agriculture - La Chine et l'Europe - Communauté européenne et COMECON (Conseil d'assistance économique mutuelle)
Bien qu’étant strictement national, le référendum sur l’Europe (23 avril 1972) décidé par le Président Pompidou a, par sa signification et ses résonances, largement débordé du cadre français. Il a donné une ampleur psychologique et politique nouvelle à l’« élargissement » de la Communauté européenne, et il a voulu mettre en lumière un consensus profondément démocratique. Les Français n’ont certes pas été appelés à élire des membres d’un vrai Parlement européen, mais en se prononçant pour ce qui a été réalisé, ils ont permis l’ouverture de nouvelles perspectives. En ce sens, ce référendum a été un événement européen. Et c’est bien ainsi qu’il a été considéré dans toutes les capitales, celles des pays membres de la Communauté, mais aussi celles des autres États.
Après l’échec, en 1954, du projet de Communauté européenne de Défense (CED), qui, à l’image de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (CECA), se voulait une communauté fonctionnelle à finalité politique, dans une perspective fédérale, l’Europe était au creux de la vague. La conférence de Messine aboutit au traité de Rome de 1957, qui créa le Marché commun. Puis les difficultés nées, notamment, de la candidature britannique donnèrent à certains l’impression que l’élan était brisé. C’est alors que la conférence de La Haye les 1er et 2 décembre 1969, puis le 22 janvier 1972 la signature du traité d’adhésion des quatre pays candidats « relancèrent » le mouvement. Il convenait que cette nouvelle étape fût approuvée, en elle-même et dans les perspectives qu’elle ouvre.
Aussi bien est-ce, encore ce mois-ci, sur les problèmes européens que se concentre l’attention. Seules les Communautés européennes ont en effet témoigné de quelque activité, cependant que les grands drames de notre temps, le Vietnam, le Moyen-Orient, et maintenant l’Irlande, se poursuivent sans qu’aucune organisation internationale veuille ou puisse intervenir efficacement.
Il reste 90 % de l'article à lire
Plan de l'article