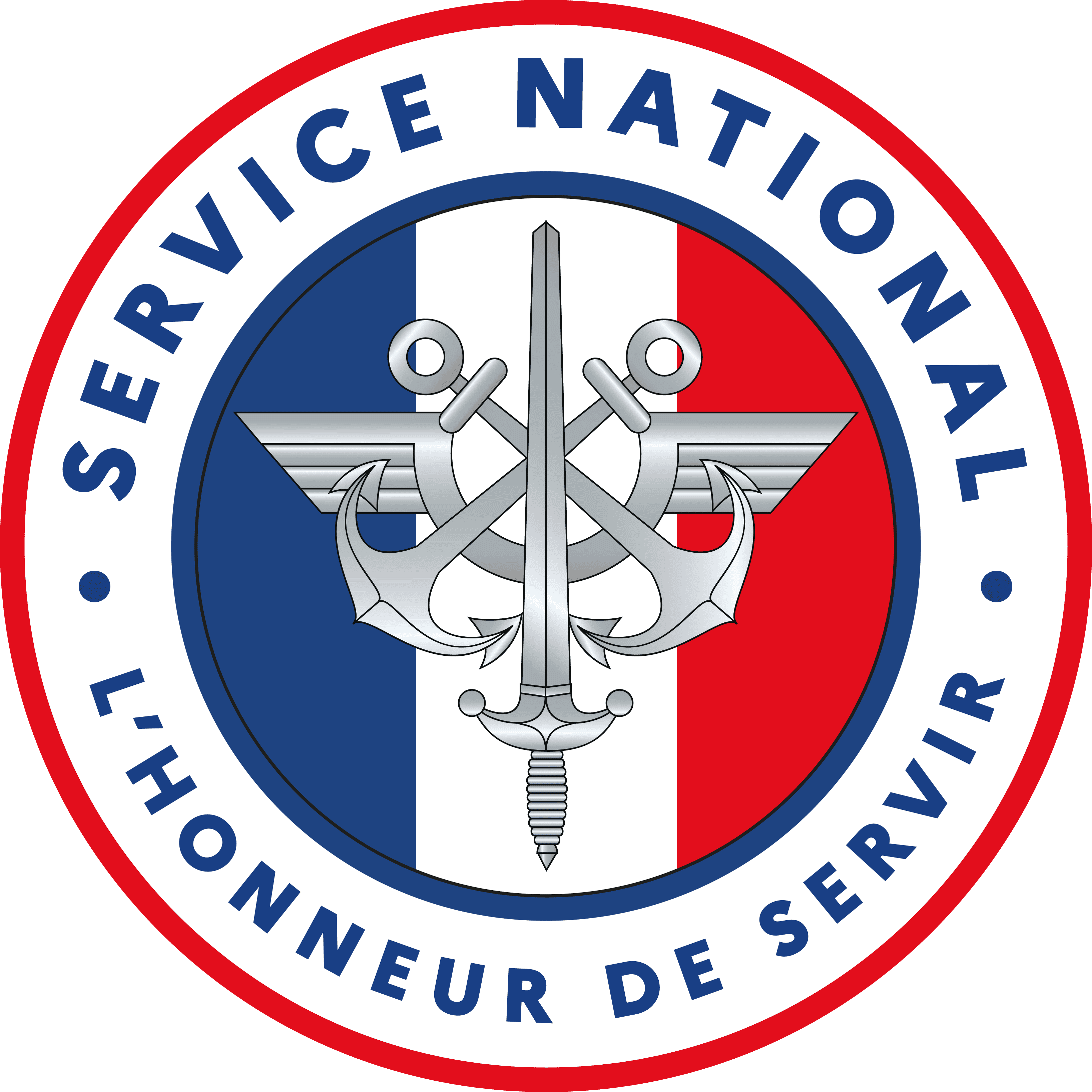Institutions internationales - L'Europe et le désordre monétaire - Les difficultés de la Politique agricole commune (PAC) - Imbroglios africains
Tandis que se poursuivait la « normalisation » en Pologne, la Conférence de Madrid, chargée, après celle de Belgrade de 1977, de dresser le bilan de la mise en œuvre de l’Acte final de celle d’Helsinki de 1975. Se déroulait dans l’indifférence, les négociations de Genève sur les armements stratégiques et celles de Vienne sur les réductions « mutuelles et équilibrées » des forces en Europe restaient enlisées dans des considérations techniques et hypothéquées par les nouvelles tensions internationales.
L’attention s’est concentrée sur l’Amérique centrale et sur l’Europe. Les États-Unis ont le sentiment que la guerre est à leurs portes, et ils n’ont pas oublié la menace de Che Guevara : « De l’Amérique latine, nous ferons cent Vietnam ! ». Ils ne laisseront pas l’Amérique centrale et la zone des Caraïbes tomber sous la domination communiste. Cuba est un foyer qui enflamme des brûlots dans toute la région. Le Nicaragua est perdu. Le Salvador est menacé. Après, ce sera peut-être le tour du Guatemala, de Panama et du Mexique. C’est ce qui explique le discours dans lequel le président Reagan a, le 24 février 1982 devant l’Organisation des États américains, proposé à cette région troublée une aide économique sans précédent, tout en dénonçant avec force l’action de l’URSS, par l’intermédiaire de Cuba et du Nicaragua. Pendant ce temps l’Europe a, une nouvelle fois, été affrontée à des difficultés tenant, les unes et les autres, à son manque d’homogénéité politique, qu’il s’agisse des discussions sur les prix agricoles ou de la dévaluation du franc belge et de la couronne danoise le 22 février 1982.
L’Europe et le désordre monétaire
Début février 1982, une nouvelle agitation s’est emparée des marchés des changes, les cours du dollar s’étant brusquement élevés sur toutes les places, après une série de baisses amorcée en septembre 1981. Les partenaires des États-Unis ont aussitôt subi les conséquences de ce mouvement. L’envolée de la monnaie américaine renchérit les factures pétrolières et, surtout, la tension des taux sur le marché des eurodollars empêche les pays européens, notamment la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne fédérale, d’opérer une nouvelle réduction du coût du crédit pour faciliter la relance de leur économie. Le 17 janvier 1982, lors d’une réunion à Versailles, les ministres européens des Finances avaient qualifié de « meurtrière » la politique américaine en matière de taux d’intérêt, et mis en accusation le secrétaire au Trésor, Donald Reagan, et le président de la Banque centrale des États-Unis (le FED), Paul Volcker. Ce dernier ne voulait pas assouplir sa politique d’argent cher aussi longtemps que le gouvernement et le Congrès n’auraient pas entrepris de réduire substantiellement le déficit budgétaire.
En dépit de leurs appels à la solidarité occidentale, les États-Unis restaient, en ce domaine, d’abord soucieux de leur politique intérieure, et les Européens subissaient, sans pouvoir les limiter, les fluctuations du dollar. Fin février 1982, il semblait que, compte tenu des résultats enregistrés dans la lutte contre l’inflation (ramenée à 5 %), M. Volcker était prêt à assouplir sa position sur les taux d’intérêt, et à en accepter la réduction.
Ce ne sont toutefois pas ces fluctuations qui expliquent le réajustement du système monétaire européen intervenu le 22 février 1982. La prospérité belge s’est considérablement dégradée, le déficit budgétaire est cinq fois celui de la France, la balance des paiements est de plus en plus déséquilibrée, le chômage touche 12 % de la population active, la désindustrialisation s’aggrave. Fortement attaqué depuis plusieurs mois, le franc belge devait être dévalué. Mais les partenaires de la Belgique ne pouvaient accepter les 12 % initialement envisagés par le ministre des Finances, M. de Clerq, M. Jacques Delors a jugé cette demande « inadmissible », et il a rappelé les trois principes du SME (Système monétaire européen) : équilibre global entre les droits et les devoirs des partenaires, équilibre entre les mesures internes et externes, refus de toute dévaluation susceptible de fausser la concurrence. Sans cette charpente, le SME s’effondrerait. Un accord a été établi sur les chiffres de 8,5 % pour le franc belge et de 3 % pour la couronne danoise. Le Luxembourg, dont le franc, lié au franc belge, est également dévalué de 8,5 %, a demandé un réexamen du fonctionnement de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, vieille de 60 ans. Le SME a été sauvegardé, mais la CEE a subi une nouvelle crise, alors que débutaient les difficiles négociations sur les prix agricoles.
Les difficultés de la Politique agricole commune (PAC)
Le 15 février 1982, les ministres de l’Agriculture des « Dix » ont ouvert le débat annuel sur le relèvement des prix agricoles (il doit être en principe terminé pour le 1er avril 1982) dans une atmosphère alourdie par les menaces de blocage proférées par les Britanniques. Ceux-ci semblaient décidés à empêcher tout progrès dans la Communauté tant qu’ils n’auraient pas reçu satisfaction en matière budgétaire. Le risque de crise paraissait d’autant plus sérieux que la politique commerciale de la Communauté est de plus en plus critiquée par ses partenaires extérieurs. Près de 10 ans après leur adhésion à la CEE, les Britanniques n’ont pas renoncé à en modifier la « Constitution », ce qui en changerait la nature et en affecterait les ambitions. Ils voudraient un droit permanent à ne pas payer au budget communautaire plus qu’ils n’en reçoivent, après avoir obtenu un arrangement agricole satisfaisant. Certains ont émis l’idée qu’un accord à neuf pourrait être réalisé, laissant Londres à l’écart, mais Mme Thatcher pourrait se référer aux textes, et refuser de payer sa quote-part au budget européen. Au surplus, l’appui de la Commission serait indispensable. Le nouveau président de l’Assemblée européenne, M. Piet Dankert, estime que « la politique des prix agricoles n’est pas satisfaisante, et pose même un problème pratiquement insoluble ». Mais, ajoute-t-il, « une politique plus favorable aux agriculteurs augmenterait la part du budget communautaire destinée à l’agriculture, alors que la réforme de structure demandée par la Grande-Bretagne tend à la réduire », M. Claude Cheysson a été très net : « La Communauté n’a jamais été prévue pour rembourser à chacun ce qu’il a payé ; les seuls transferts de ressources doivent se faire par la voie des politiques communes, et non par celle des transferts directs », ce qui va à rencontre du souhait britannique.
Au-delà de la Politique agricole, les discussions mettent en question la nature et l’avenir de la Communauté. Celle-ci est soumise à une triple dépendance – monétaire, énergétique, militaire – qui limite sa faculté à mettre en œuvre des politiques durables. Elle a été frappée plus durement que ses partenaires japonais ou américain par la crise. En 1973, les adhésions de la Grande-Bretagne, du Danemark et de l’Irlande, puis en 1981 celle de la Grèce, l’ont rendue moins homogène. La crise a accentué les divergences d’intérêts entre les États, chacun d’eux ayant l’impression d’agir aux limites de ses possibilités. La dynamique communautaire s’est affaiblie, alors qu’une politique économique extérieure commune, de plus en plus nécessaire, impliquerait un renforcement de la cohésion interne. Le SME a été un succès parce que la France et l’Allemagne fédérale, entraînant les autres États, à l’exception de la Grande-Bretagne, pensaient qu’il n’était pas possible de laisser le Marché commun à la merci de la politique monétaire américaine. Il apparaît qu’un nouvel effort collectif serait nécessaire pour sauver l’acquis communautaire, c’est-à-dire l’Union douanière, la politique agricole commune et le SME. Mais cette opération qui, compte tenu des actions qu’elle supposerait, s’apparenterait à un progrès et pourrait rétablir un consensus, apparaît bien difficile à concevoir dans le climat actuel. D’autant que la Grande-Bretagne n’a jamais accepté le Marché commun, auquel elle n’a adhéré que dans l’espoir de le transformer en une simple zone de libre-échange. Le général de Gaulle l’avait dit le 14 janvier 1963, en opposant son premier « non » à la candidature britannique : la Grande-Bretagne n’est pas prête à entrer dans l’Europe. Depuis, elle n’est pas devenue « européenne ».
Imbroglios africains
La signature d’un contrat énergétique entre la France et l’Algérie, puis la visite du Premier ministre à Tunis ont eu une heureuse influence sur les relations politiques entre Paris et les deux capitales du Maghreb. L’annonce d’une aide militaire accrue des États-Unis au Maroc a pu irriter l’Algérie : or, elle n’est pas liée au problème du Sahara oriental, mais aux négociations hispano-britanniques sur Gibraltar et à la prochaine adhésion de l’Espagne à l’Otan. Le fameux rocher ne jouerait pas son rôle stratégique si la rive sud du détroit n’était pas « sûre ». Elle dépend du Maroc.
Mais cette stabilité du Maghreb reste affaiblie par la tension algéro-marocaine à propos du Sahara oriental. Rabat a subi une défaite diplomatique : la République arabe sahraouie a été admise comme 51e membre de l’Organisation de l’unité africaine, l’OUA. Le Maroc n’a été soutenu que par le Cameroun, le Centrafrique, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Soudan, le Sénégal et le Zaïre. Le Gabon et la Somalie ne se sont pas estimés liés par cette décision du conseil des ministres réuni à Addis-Abeba. Aucun de ces États n’a toutefois menacé de se retirer de l’Organisation, comme plusieurs d’entre eux l’avaient fait dans le passé chaque fois que s’était précisée la perspective d’une admission de la République arabe sahraouie. À Rabat, le roi Hassan II (au pouvoir depuis 1961) a qualifié cette décision de « nulle et non avenue », en contestant à la République arabe sahraouie la qualité d’« État souverain et indépendant », condition prévue par la charte de l’OUA pour l’admission d’un nouveau membre. Jusqu’ici, l’OUA avait évité de heurter le Maroc de front. Aujourd’hui, le roi Hassan est au pied du mur. Mais le problème comporte un autre élément. L’OUA est fragile, et beaucoup s’inquiètent à l’idée de voir le colonel Kadhafi accéder à sa présidence. Fort de l’appui que lui donnent plusieurs pays africains, et de la signification de l’aide que lui accordent les États-Unis, le roi Hassan II essayera peut-être de faire « éclater » l’OUA.
La tentation sera d’autant plus grande, aux yeux de certains observateurs, que l’OUA est faible, et qu’elle vient de donner une nouvelle preuve de sa faiblesse dans la crise tchadienne. Le 11 février 1982, le président Goukouni Oueddeï (au pouvoir depuis 1979) a rejeté le « plan de paix » adopté par le comité spécial de l’OUA pour le Tchad. Ce plan prévoyait un cessez-le-feu le 28 février 1982, l’ouverture de négociations entre Goukouni Oueddeï et Hissène Habré le 15 mars 1982, des élections législatives et présidentielles entre le 1er mai et le 30 juin 1982, date à laquelle la « Force interafricaine de paix » sera retirée du Tchad. L’OUA a dû constater l’échec de la politique qu’elle a menée jusque-là. Elle éprouvait des difficultés de trésorerie, elle craignait des incidents avec les factions tchadiennes, elle se sentait incapable d’arbitrer un conflit vieux de 17 ans. Elle a dû par ailleurs prendre acte du retournement de la situation sur le terrain en faveur de Hissène Habré, dont le mouvement semble devenu le plus puissant et le mieux organisé. L’avenir du Tchad n’est pas éclairé pour autant. Si l’application d’un cessez-le-feu est concevable, à condition que chacun reste maître du terrain qu’il contrôle, des élections, même organisées sous le patronage de l’OUA et indépendamment des modalités du scrutin adopté, peuvent raviver les tensions entre les factions et entre les régions. L’OUA invite Goukouni Oueddeï à se « réconcilier » avec Hissène Habré, qu’il a fait condamner à mort et contre qui, en décembre 1980, il a fait appel aux troupes libyennes. Elle est partie d’une idée politique de l’unité africaine, en faisant abstraction de la complexité sociologique de l’Afrique et du caractère très particulier de la notion d’État dans cet amalgame d’ethnies, de religions, de clans, auquel seule la présence européenne avait pu donner des cadres administratifs d’inspiration moderne. Héritage de la « colonisation », les frontières n’enserrent pas des ensembles homogènes, et l’OUA se trouve ainsi écartelée entre sa vision légaliste des rapports politiques et la réalité humaine. Telle est sans doute la raison majeure de son impuissance. Les influences extérieures ne peuvent que l’aggraver. L’accession du colonel Kadhafi à sa présidence pourrait annoncer son éclatement : outre sa personnalité, le dirigeant libyen a contre lui, aux yeux de plusieurs États africains, le fait d’être considéré comme un relais de l’URSS. Son attitude à l’égard des événements de l’Angola ou de la Corne de l’Afrique dresse contre lui ceux qui ne veulent pas une extension de l’influence soviétique. Le 17 février 1982, M. Robert Mugabe a chassé de son gouvernement M. Joshua Nkomo, le vieux combattant nationaliste du Zimbabwe, et trois de ses sept lieutenants. Depuis quelque temps les Soviétiques, ses amis de toujours, avaient fini par accepter l’évidence : leur champion ne contrôlerait sans doute jamais le Zimbabwe. Les Occidentaux, eux, avaient toujours misé sur M. Mugabe. L’OUA n’a pu qu’enregistrer cette crise, survenue pourtant au voisinage de l’Afrique du Sud. ♦