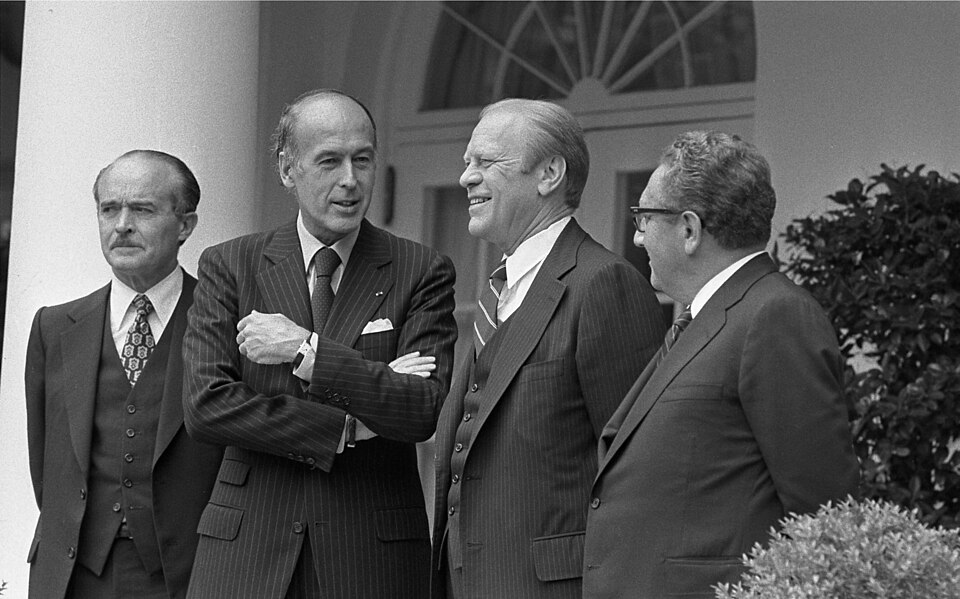Afrique - La politique africaine de la Libye : échecs ou péripéties ? - L'Afrique doit-elle se doter de l'arme nucléaire ?
Le premier semestre 1983 n’a pas été favorable au colonel Kadhafi. Depuis le double échec du « Sommet » des chefs d’État tenu à Tripoli l’an passé, réunion qui aurait dû se terminer par son accession à la présidence de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), le président libyen a vu ses principaux projets contrariés et s’est senti comme écarté d’éventuelles grandes décisions africaines. Cette perte de prestige ne déplait pas aux gouvernements les plus « progressistes » que l’influence exercée par l’auteur du « livre vert » sur les foules, notamment sur les jeunes, contraignait à une attitude ambiguë qui les poussait souvent à reconnaître ouvertement le bien-fondé des thèses libyennes tout en condamnant avec discrétion la forme de leur exposé. En réalité, Algériens, Éthiopiens, Tanzaniens, Angolais ou Mozambicains avaient compris que les positions du colonel Kadhafi, par des outrances ou des maladresses, desservaient leur propre cause et confortaient l’esprit de résistance à leur égard du clan des « modérés », en particulier celui des hésitants. Les États de la « ligne de front », dans leur ensemble, reprochaient au « bouillant colonel » de détruire l’unité d’une organisation qu’ils estimaient seule capable de mobiliser l’opinion internationale sans le soutien d’une idéologie, contre la politique du parti national sud-africain en Afrique du Sud même, en Namibie, voire à l’égard des pays voisins de ces deux États. L’Algérie, de son côté, pouvait estimer que les succès diplomatiques remportés par le Maroc en Afrique pour défendre sa politique à l’égard du Sahara occidental étaient causés par le soutien que la Libye apportait au POLISARIO. Le développement de l’influence soudanaise et saoudienne dans les pays du Sahel provenait aussi, selon certains Algériens, du prosélytisme de l’intégrisme libyen dans cette partie du continent, prosélytisme dont les arguments maladroits conduisaient à ranger le « progressisme » des États socialistes africains parmi les extrapolations d’un intégrisme religieux.
Les échecs récents rencontrés par la politique libyenne en Afrique ont eu pour théâtre certains pays de l’Afrique occidentale, le Tchad, la réunion de l’OUA tenue en juin 1983 à Addis-Abeba, le Maghreb où les relations entre les États s’améliorent malgré les interventions et en l’absence du colonel Kadhafi. Ils peuvent être considérés, par le gouvernement de Tripoli, comme les péripéties d’une pénétration idéologique dont les effets ne seront concrets qu’à long terme. Pourtant, si l’on en croit certains indices, l’opinion libyenne s’inquiète, ce qui paraît alarmer le pouvoir à son tour. Un article, publié par un proche du chef de l’État dans le Zahf-Al-Akhdar, instrument de propagande de l’idéologie kadhafiste, un véritable réquisitoire contre l’armée, peut laisser croire qu’une éventuelle opposition s’agite ou, plus exactement, que le gouvernement veut justifier à l’avance des mesures qu’il serait amené à prendre contre des officiers dont il peut craindre les complots, puisque plusieurs conspirations ont été déjouées et réprimées dans un passé récent. L’auteur de l’article les accuse de tous les vices et souhaite que les comités révolutionnaires de la Jamahiriya se chargent de démanteler l’armée cette « institution réactionnaire ». Dans l’esprit du colonel Kadhafi, une péripétie n’est d’ailleurs pas l’échec d’une stratégie ; la sienne consiste à profiter de toutes les occasions pour occuper, dans les pays africains au nord de l’équateur, la place laissée libre par les déçus du socialisme ou par ceux du libéralisme ; il n’ignore pas que son dynamisme attire et que son exemple inspirera longtemps de jeunes cadres ambitieux que les difficultés, rencontrées par leurs dirigeants dans le domaine économique, poussent à l’action. Il estime qu’il lui suffit de contenir, de son côté, l’effet des désillusions de sa propre population pour avoir finalement raison à terme.
En Afrique occidentale, après avoir tenté de déstabiliser la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie, l’effort libyen a porté sur le Liberia, le Ghana et la Haute-Volta [Burkina Faso]. Ce dernier pays a été l’objet de nombreuses tensions depuis la chute du général Lamizana, en 1980, et surtout depuis celle de son successeur le colonel Saye Zerbo, en novembre 1982. Pour la première fois de manière aussi caractéristique, on assiste à la lutte de plusieurs tendances idéologiques au sein de l’armée qui, jusqu’alors, était considérée, dans les pays africains, comme le seul garant d’une unité nationale contre les particularismes ethniques. Afin d’essayer de mettre fin à ces menées déstabilisatrices, le médecin-commandant Ouedraogo, chef de l’État « malgré lui », s’est donné 6 mois pour restaurer le pouvoir civil et renvoyer les militaires dans leurs casernes. Avant de prendre cette décision, il avait fait arrêter le Premier ministre Thomas Sankara et un autre officier « progressiste », le commandant Lingani ; il avait également dissous le « Conseil de salut du peuple » (CSP), instance suprême de l’État où les différentes tendances de l’armée s’affrontaient. Le capitaine Sankara, qui ne cache pas ses sympathies pour les Libyens, avait déjà été évincé du gouvernement précédent par le colonel Saye Zerbo. On l’a dit aussi l’inspirateur du putsch qui avait mis fin au pouvoir de ce dernier : pourtant, il n’avait été nommé Premier ministre par le CSP qu’en janvier 1983. De cette date au 19 mai 1983, jour de son arrestation, il avait entrepris une campagne de plus en plus dure contre les adversaires civils et militaires d’une politique qui tendait à rapprocher la Haute-Volta du Ghana du capitaine Rawlings, du Bénin de tendance un peu différente, du général Kérékou et, enfin, de la Libye. La chute du capitaine Sankara est actuellement un fait acquis mais les remous qu’elle continue à provoquer dans l’armée laissent à penser que la pénétration libyenne a été profonde et ne sera pas sans lendemain.
Il reste 76 % de l'article à lire
Plan de l'article




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)