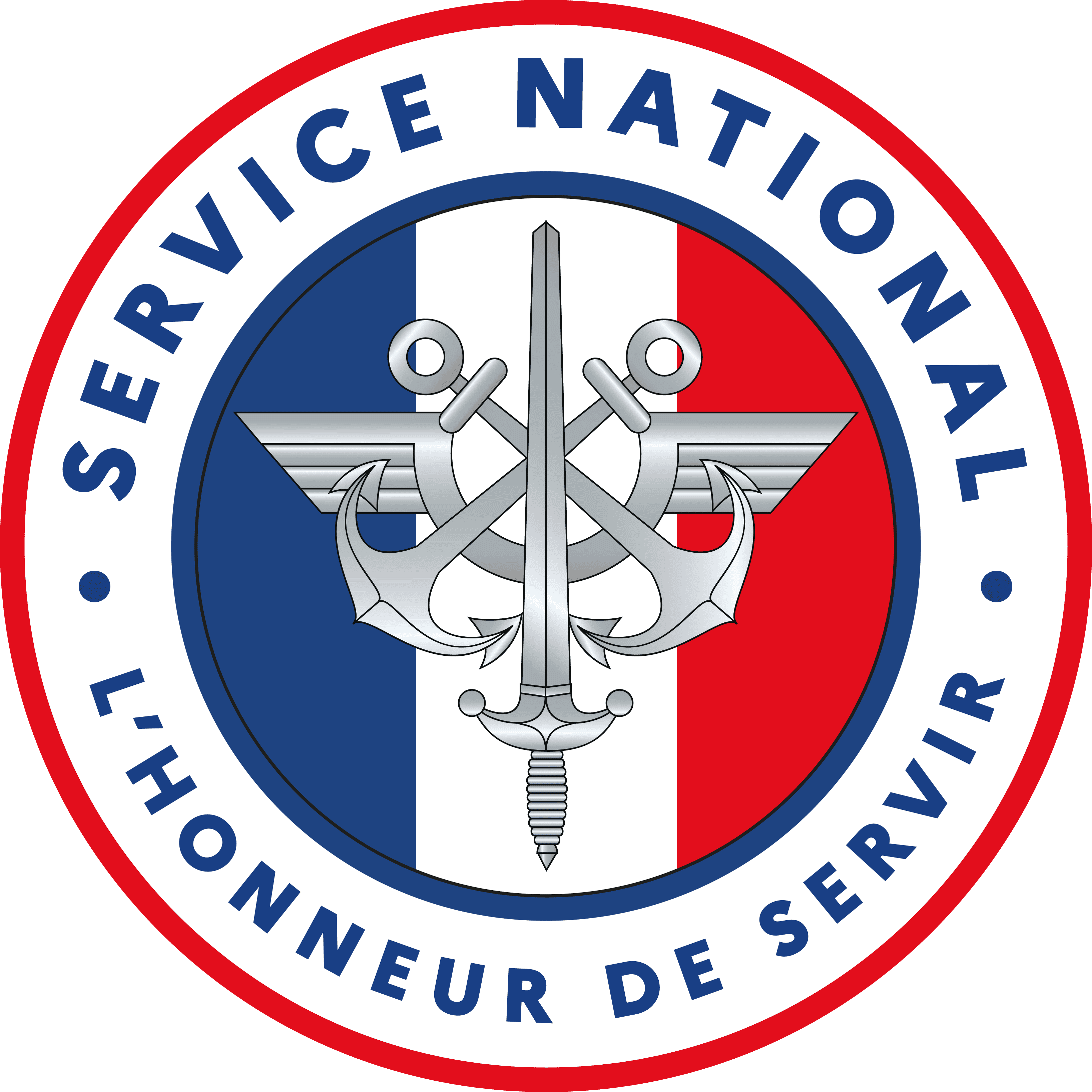Défense à travers la presse
M. Gorbatchev s’est rendu compte qu’il n’était pas toujours opportun de manier les idéologies comme des massues et d’en asséner de grands coups. Cela vient de le conduire à retirer les troupes soviétiques d’Afghanistan ; une manœuvre réussie dans la mesure où elle a l’approbation de l’Occident. Mais l’URSS laisse derrière elle un pays trop divisé contre lui-même pour qu’il ait conscience de ses besoins.
Nos confrères parlent en la circonstance d’échec militaire pour Moscou. N’oublions cependant pas que depuis qu’existe l’Union soviétique, il n’est pas de crise qui n’ait tourné à son profit et qu’elle a toujours trouvé le moyen, à l’heure du règlement, de tirer pied ou aile de son échec.
L’éditorialiste du Monde, du 15 mai 1988, n’en juge-t-il pas ainsi :
« L’évacuation de l’Afghanistan ne résulte pas d’un brusque mouvement de cœur de M. Gorbatchev, mais de la volonté d’échapper à un enlisement qui n’offrait d’autre perspective que plus de morts, de destructions, de réfugiés et le maintien d’un fardeau financier et diplomatique considérable, avec des risques de contamination islamique non négligeables dans les républiques soviétiques d’Asie centrale… Le risque pour la résistance (afghane) est de ne pas s’entendre, de finir par régler par les armes les différends qui séparent islamistes extrémistes et islamistes modérés. C’est d’ailleurs le calcul qui a été manifestement fait à Moscou : même après un éventuel effondrement de l’armée officielle afghane, une guerre civile opposant les différentes tendances de la résistance permettrait à l’Union soviétique de jouer de cette libanisation, en particulier dans les régions proches de sa frontière ».
Et dans Le Figaro du 17 mai 1988, Charles Lambroschini, après avoir souligné que les autorités de Kaboul disposent de certains atouts, comme une police de style KGB et des armes en abondance, considère que le président Nadjibullah compte surtout sur les divisions de la résistance. D’où cette conclusion :
« Même si, à défaut d’être certain, le chaos est probable, le dénouement semble impossible à prévoir. Seule certitude : Gorbatchev va s’employer à transformer cet échec militaire – le premier abandon d’une conquête par l’URSS – en un succès politique. Vis-à-vis de l’Afghanistan, où il va s’efforcer de tirer les fils dans les coulisses, aussi bien qu’à l’égard d’une opinion occidentale prête à céder sur l’essentiel devant chaque geste de bonne volonté du Kremlin. Mieux vaut prendre au pied de la lettre cette formule prêtée à Gromyko : Gorbatchev sourit mais ses dents sont d’acier ».
Il n’y a pas lieu de s’en formaliser. Une maladie du cœur héritée du romantisme nous porte trop souvent à croire que l’affabilité est signe de générosité et qu’elle doit être de règle dans les relations internationales. Quoi qu’il en soit, les dents d’acier se sont desserrées en Afghanistan, offrant ainsi un motif de satisfaction à l’opinion mondiale avant de sourire à l’intention du président Reagan. La rencontre de Moscou a donc pris, dans les médias, le relais du festival de Cannes. Les réactions de la presse vont du soulagement au scepticisme le plus affirmé.
Noël Darbroz, dans La Croix du 27 mai 1988, conjugue lucidement ces deux attitudes :
« En moins de trois ans, ces rencontres ont eu des résultats considérables : le désarmement nucléaire est amorcé et le traité sur l’élimination des missiles à portée intermédiaire est devenu réalité. Des conflits régionaux sont en voie d’apaisement comme en Afghanistan, en Angola. Une certaine liberté d’expression commence à poindre en URSS. Face à ces développements, le monde entier respire un peu mieux. Les deux supergendarmes semblent décidés à vouloir faire régner la paix… Deux idéologies n’en demeurent pas moins face à face, et un Occident trop confiant et imprudent pourrait très bien fournir, selon le mot célèbre de Lénine, jusqu’à la corde avec laquelle il sera pendu. Léniniste convaincu, Gorbatchev n’a certainement pas renoncé à imposer son idéologie au reste du monde, les chemins de la paix pouvant s’avérer les meilleurs ».
Il faut désarmer davantage, estime Yves Moreau dans L’Humanité du 30 mai 1988. Sans rappeler que le Traité sur les Forces nucléaires intermédiaires (FNI) ne concerne effectivement que 4 % des arsenaux des deux Grands, notre confrère explique à ses lecteurs que l’Union soviétique détruira trois fois plus de missiles que les États-Unis, alors comment justifier cet accord ? :
« La réponse fondamentale, c’est qu’il est grand temps d’en finir avec une conception de la sécurité qui serait fondée essentiellement sur la puissance militaire. Il faut adopter ce qu’on appelle ici (à Moscou) une nouvelle mentalité, un nouveau mode de pensée. Cela s’accompagne d’un vaste effort de réflexion autocritique sur la politique étrangère de l’URSS. Dans sa recherche d’une parité stratégique avec les États-Unis, elle a sans doute accordé trop d’importance aux facteurs militaires et pas assez aux initiatives politiques. L’URSS se serait ainsi laissé entraîner trop loin dans la course aux armements déchaînée par les Américains. Il ne s’agit pas de nourrir la moindre illusion sur la nature de l’impérialisme et de sous-estimer la menace qu’il représente. Mais il faut faire prévaloir sur cette menace une véritable restructuration, une perestroïka des relations internationales ».
Comme nous le rappelait opportunément Noël Darbroz, n’allons pas oublier que M. Gorbatchev est né, a grandi et vécu dans la tradition marxiste-léniniste et qu’il est porté par la force naturelle de son idéologie à ne rien abandonner des chances qui lui sont offertes. Le traité sur les FNI s’apparente à l’homéopathie. De surcroît, l’Europe occidentale est seule à en pâtir. Le problème est aussitôt plus difficile dès qu’il est question de réduire les arsenaux centraux. Dans Le Monde du 29 mai 1988, Michel Tatu en décortique la complexité :
« De nouveaux problèmes sont apparus. D’abord celui des missiles de croisière basés en mer (SLCM). Les Soviétiques se sont intéressés à ce vecteur, notamment avec le SSN-21 installé depuis janvier dernier sur des sous-marins et portant à 3 000 kilomètres, mais le Pentagone plus encore, qui voudrait en déployer quatre mille à bord de ses navires, dont huit cents environ équipés d’ogives nucléaires. L’idée ne fait pas l’unanimité aux États-Unis dont les principaux centres industriels sont disposés près des côtes, alors que l’URSS est bien à l’abri derrière sa masse continentale. Enfin et surtout, il est très difficile de distinguer entre les SLCM nucléaires et les autres. Un autre problème est celui des missiles balistiques mobiles. Ici, la critique ne porte pas sur la nature des armes, jugées au contraire mieux protégées, donc stabilisantes pour la dissuasion, mais sur les difficultés de contrôle. Voilà pourquoi les Américains ont proposé d’abord l’interdiction de tels engins, celle-ci étant beaucoup plus facile à vérifier qu’une simple limitation. Leur conversion récente aux missiles mobiles a permis un rapprochement des positions, mais il reste à s’entendre sur le mécanisme concret de vérification… Mais la grande différence avec les négociations passées est que, cette fois, la bonne volonté ne manque pas ».
Le communiqué commun publié à l’issue de ce sommet ne fait cependant état que de progrès et non d’un pas décisif vers un accord de réduction des armes stratégiques (START). Le président américain a paru d’ailleurs ne plus escompter le succès avant son départ de la Maison-Blanche. Le travail revient aux diplomates et, dans Libération du 2 juin 1988, Gérard Dupuy a ce commentaire :
« On comprend mal qu’on puisse se réjouir de ce sommet, sauf à remarquer, ce qui n’est pas rien, qu’il confirme que l’apocalypse nucléaire n’est pas pour demain… Il serait pourtant incongru de parler de match nul. On a surtout assisté à un échange inégal : l’Union soviétique a une politique, serait-elle mauvaise ; les États-Unis et l’Occident avec eux n’en ont pas, fût-elle bonne. L’après-Reagan est programmé, on risque d’attendre longtemps l’après-Gorbatchev ».
En fait, ce qui est programmé, c’est la diplomatie soviétique. Reste à savoir si le successeur du président Reagan donnera suite aux initiatives de l’actuel hôte de la Maison-Blanche. C’est précisément le sujet qu’analyse Baudouin Bollaert dans Le Figaro du 30 mai 1988 :
« La politique reaganienne, à côté d’un échec cuisant comme l’Irangate, a connu des réussites notables : de la Grenade à l’Afghanistan, en passant par le golfe Persique et la Libye. Sa doctrine de la paix par la force a donné des résultats spectaculaires dans le domaine Est-Ouest. Le réarmement américain et le soutien indéfectible accordé aux mouvements de libération antimarxistes ont ramené l’URSS à la table des négociations de Genève et bloqué l’expansion communiste dans le monde… Aujourd’hui, on peut dire que les nouveaux rapports instaurés avec Moscou conditionneront, dans une large mesure, la politique étrangère des prochains occupants de la Maison-Blanche. Et c’est là le deuxième legs de Ronald Reagan à ses successeurs. Cela implique, en matière de défense, la poursuite des négociations START (sauf si un accord est trouvé avant janvier) et aussi, à l’heure où Washington réclame à ses alliés un partage du fardeau de l’Otan, une série de choix difficiles… Enfin, il y a le programme Initiative de défense stratégique (IDS) de la guerre des étoiles et le problème de la compétition dans l’Espace que Zbigniew Brzezinski compare à la maîtrise des mers d’autrefois. Si un consensus s’est établi sur la nécessité de la recherche, le débat est loin d’être clos sur les modalités d’un éventuel déploiement… Enfin l’enjeu asiatique est énorme. Si l’URSS se retire effectivement d’Afghanistan, si elle démilitarise sa frontière avec la Chine et pousse les Vietnamiens à quitter le Cambodge, les tensions avec Pékin diminueront d’autant. Ce sera alors l’occasion pour les États-Unis d’entamer des négociations avec l’Union soviétique sur une réduction de leurs forces militaires en Asie et dans le Pacifique Ouest… Bref, s’il doit y avoir, à partir des legs de l’Administration Reagan, une révision des objectifs géostratégiques américains, elle s’inscrira dans la vieille et inusable doctrine d’équilibre des pouvoirs qui remonte à deux siècles ».
Selon la presse américaine, la glace fond. Notons que les compromis pacifiques sont le fait de gouvernements disposant d’autorité, les États faibles cédant à l’instinct des foules.♦