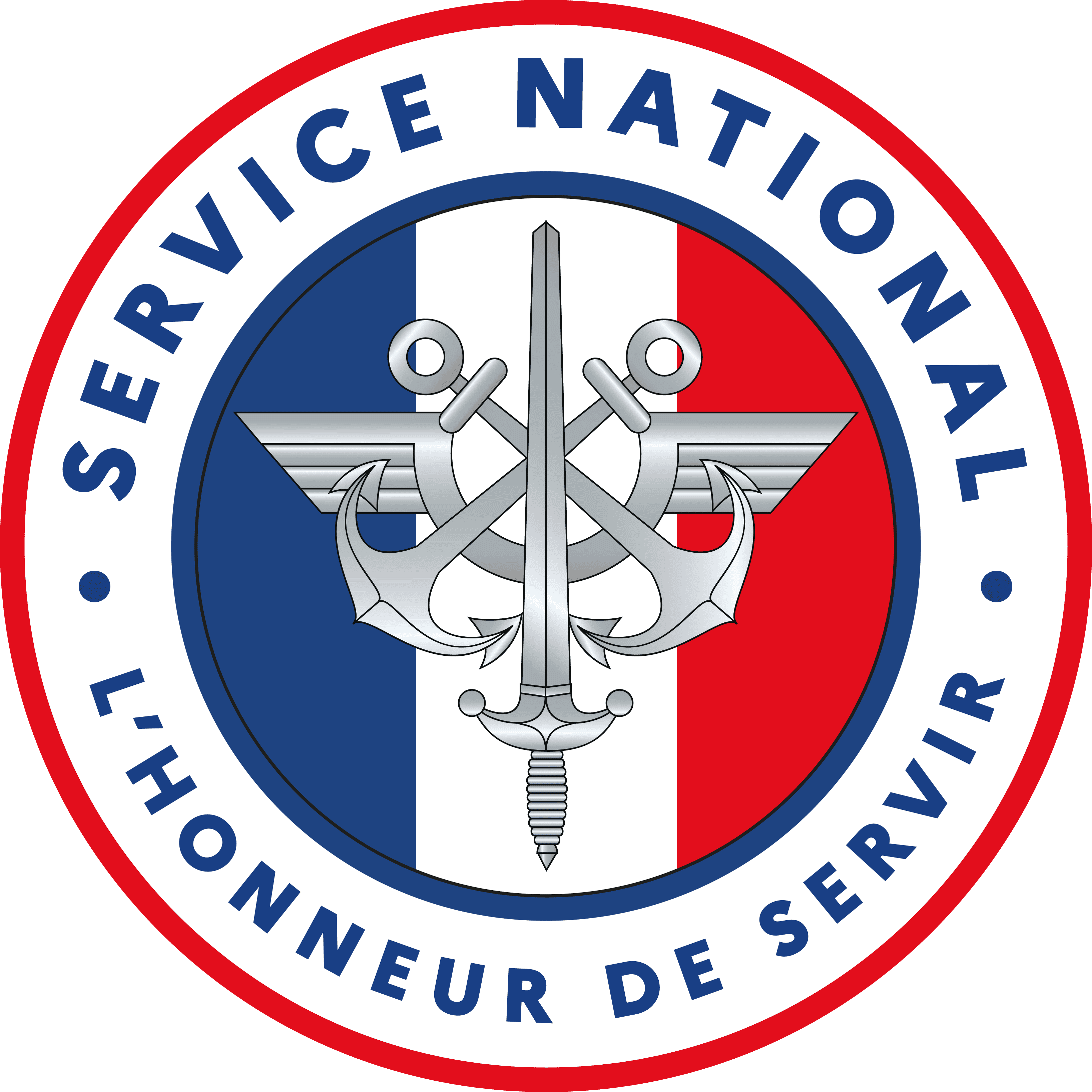Afrique - L'avenir incertain des armées africaines
Les mutineries de militaires qui ont eu lieu dans plusieurs pays africains depuis le début de cette année 1996, au Congo en février, en Guinée en février également, en Centrafrique en avril et mai, après la « révolte des bidasses » en Côte-d’Ivoire en 1990, ou les ravages provoqués par les soldats des forces armées régulières au Zaïre en 1993, apparaissent comme des révélateurs préoccupants de l’évolution des forces armées africaines. Celles-ci, en particulier les hommes de troupe et les sous-officiers, multiplient de fait leurs réactions brutales, comme un appel désespéré destiné à montrer au grand jour la dégradation de leurs situations morale et matérielle.
Malgré leurs faibles moyens, les armées africaines ont presque toutes, depuis les indépendances, connu une situation privilégiée ; les unes parce qu’elles se sont installées au pouvoir pour combler, par défaut, un vide politique, les autres parce qu’elles ont pu bénéficier de la crainte d’un putsch de la part de régimes civils plus ou moins faibles, d’autres encore parce qu’elles ont été favorisées par des conflits. Craints, influents, omniprésents, les militaires africains ont, durant trois décennies, évolué dans une position qui leur a permis d’obtenir la satisfaction de leurs revendications.
Durant la période de la guerre froide, ils ont été en outre perçus comme des éléments de stabilité par la France, ou comme des éléments privilégiés de pénétration ou de résistance à celle de l’adversaire par l’ex-Union soviétique et les États-Unis. Ils ont, dans ce contexte, en particulier quand ils étaient au pouvoir, bénéficié d’une impunité quasi totale, aussi bien dans le domaine des droits de l’homme qu’en ce qui concerne la qualité de leur gestion économique. Mieux, jusqu’au début des années 90, les dépenses militaires étaient considérées comme un domaine tabou par les grandes puissances, dans lequel les institutions multilatérales d’aide au développement ne devaient en aucun cas intervenir, même si elles pouvaient apparaître, avec leurs effets pervers sur l’endettement ou le développement de la corruption, comme un obstacle notable à la bonne gestion de l’économie.
Depuis la fin de la guerre froide et la vague de démocratisation, survenues dans un environnement de forte pénurie financière, la situation des armées africaines a rapidement évolué et pas vraiment à leur avantage. N’ayant plus pour les grandes puissances une utilité politico-stratégique aussi grande qu’auparavant, devenant une cible privilégiée des nouvelles élites politiques et des populations défavorisées, elles ont été éloignées du pouvoir, rejetées de la politique, de plus en plus oubliées dans la redistribution des richesses. Les fortes contraintes économiques et financières auxquelles sont soumis les nouveaux régimes élus, les nouvelles pressions et conditions des bailleurs de fonds enfin politiquement libérés par la fin de la guerre froide pour intervenir dans ce domaine des dépenses militaires, ont multiplié leurs effets. Les armées ont été victimes des nouvelles exigences de transparence et d’assainissement des dépenses publiques, des mouvements de réduction des effectifs de la fonction publique, des politiques de blocage des salaires…
Les programmes de réduction des effectifs, de restructuration, de démobilisation se sont multipliés, mais jamais, même dans les cas extrêmes de pays en conflit ou dangereusement instables, comme l’Angola ou le Rwanda et le Tchad, accompagnés de moyens financiers suffisants. Pire, pour de bonnes raisons comme la mise en place d’armées républicaines respectueuses de l’État de droit, ou la lutte contre la criminalité, on a financièrement favorisé certaines unités de gendarmerie ou de police, créant une forme dangereuse de discrimination envers d’autres éléments délaissés des forces armées. Dans certains cas enfin, on n’a pas assez mesuré l’importance de l’utilité politique de l’intégration dans les forces armées nationales d’éléments de mouvements d’opposition armés : milices, rébellions, factions politiques, expressions violentes d’ethnies défavorisées, laissant se déployer les pressions pour une réduction des forces, donc des dépenses dont les effets pervers pouvaient pourtant être prévisibles.
En Guinée, début février 1996, quelques centaines de soldats se répandent dans les rues de la capitale et assiègent, puis se lancent à l’assaut du palais du chef de l’État. Revendication clairement formulée des mutins : le paiement de leurs salaires en retard et l’amélioration de leurs conditions. Les militaires savaient depuis plusieurs mois que les crédits prévus pour le paiement de leurs arriérés étaient disponibles, mais que malgré de discrètes mises en garde, ces crédits n’avaient pas été affectés à leur solde.
La confusion née de la mutinerie, et la faiblesse de la garde présidentielle restée fidèle au président Lansana Conté étaient telles que les mutins auraient pu, semble-t-il, s’emparer du pouvoir. Ce qu’ils n’ont pas fait. Leur mouvement en tout cas n’a pas été conçu au départ comme un complot ou un coup d’État ; et dans cette confusion, à la suite d’un accord sur la satisfaction de leurs revendications, les mutins ont mis fin à leur révolte, sans pour autant que, par la suite, la situation ait été assainie, puisque le régime, une fois ressaisi, a visiblement opté pour la répression des responsables de la mutinerie. Cette révolte d’une partie de l’armée, dont les effectifs sont évalués à quelque 9 500 hommes pour une population d’environ 6,5 millions d’habitants, et qui est engagée directement, par sa présence en Sierra Leone et au Liberia, dans des zones conflictuelles frontalières, a sérieusement ébranlé le pays. Elle n’a pas manqué de susciter des prolongements politiques, puisque certains à Conakry ont avancé la thèse d’une manipulation des mutins par les partis de l’opposition, cette thèse ayant de fortes connotations ethniques. Ces événements illustrent clairement le danger que peut représenter une armée maltraitée pour la réussite d’un processus de démocratisation.
En Centrafrique, en avril 1996, ce sont également quelques centaines de soldats qui envahissent la capitale, vite rejoints par d’autres unités, qui se livrent à des pillages et se heurtent violemment à la garde présidentielle. Là encore les mutins réclament le paiement de leurs salaires, et mettent un terme à leur mouvement après un accord avec le président Patassé qui promet de satisfaire leurs revendications. Cependant, le 18 mai, 200 soldats se soulèvent de nouveau, s’attaquent à la radio et au palais présidentiel, sont rejoints par plusieurs autres unités, laissent la capitale livrée au pillage et s’installer dans le pays une situation qualifiée d’insurrectionnelle. Les forces françaises stationnées en Centrafrique sont renforcées et interviennent, par l’opération Almandin, pour protéger les ressortissants étrangers, rétablir l’ordre, puis prendre en charge la négociation politique avec les mutins pour la satisfaction de leurs revendications. Là encore, malgré les violentes critiques des soldats contre le régime, l’intention n’était pas de s’emparer du pouvoir.
La mutinerie de février 1996 au Congo concernait plus particulièrement des éléments d’anciennes milices qui devaient être intégrés dans les forces armées, conformément à un accord conclu en décembre 1995. Celui-ci, obtenu à la suite des ravages provoqués par les combats entre les milices proches du président Lissouba, celles proches de l’opposant Bernard Kolelas et de l’ancien président Sassou N’Guesso, prévoyait la dissolution de ces forces et l’intégration de 1 200 militaires dans la gendarmerie et la police, cette mesure devant être accompagnée d’une réorganisation des forces armées. Ce sont les miliciens de la mouvance présidentielle qui se sont révoltés, en revendiquant le paiement de leur solde et la confirmation de leur nouveau statut, montrant ainsi la difficulté d’effectuer, dans un contexte de démocratisation aussi instable qu’au Congo, la réorganisation d’une armée de quelque 25 000 hommes (dont deux tiers de gradés !), dont la majorité des officiers est originaire du nord du pays, la région de l’ancien président Sassou N’Guesso, et dont le nouveau régime a laissé la situation matérielle se dégrader au profit de milices fort coûteuses mais politiquement plus fiables.
Ces mutineries ont sonné comme un avertissement. Elles ont montré les risques graves que peut entraîner la révolte, même sans buts politiques calculés, de militaires amers et déçus. On peut raisonnablement penser que les nouveaux régimes élus et même les bailleurs de fonds seront désormais plus prudents et surveilleront avec attention le paiement des soldes des militaires africains. Il reste que les armées africaines sortent d’une longue période privilégiée sans avoir une vision claire de leur avenir, de leurs nouvelles missions éventuelles, sans même avoir, pour compenser la perte de leurs privilèges politiques et matériels, des assurances sur les moyens qui seront mobilisés pour leur transformation, ou même simplement une nouvelle ambition pour les valoriser, comme par exemple celle de participer désormais activement à la prévention des conflits et au maintien de la paix dans leur continent. ♦