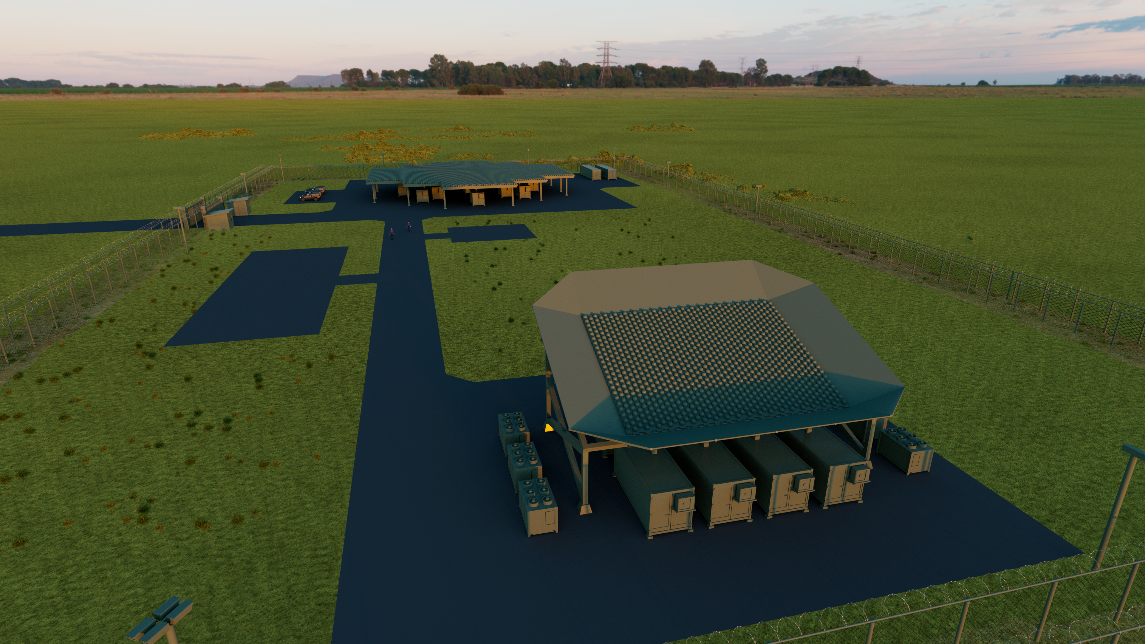Les crises internationales. De Pékin (1900) à Sarajevo (1995)
Il est inutile de présenter le colonel Jean-Louis Dufour aux lecteurs de cette revue, puisqu’elle a publié plusieurs de ses articles traitant des conflits régionaux et de la sécurité intérieure, et qu’elle a aussi présenté ses précédents ouvrages, à savoir : Les vraies guerres et la Guerre au XXe siècle, ce dernier écrit en collaboration avec le professeur Maurice Vaïsse. Ces deux livres s’étaient proposé d’analyser, à partir de l’étude de cas concrets, les spécificités politiques et stratégiques du phénomène « guerre » à notre époque, alors que le nouvel ouvrage de notre auteur entreprend de théoriser le phénomène « crise », c’est-à-dire cette situation qui surgit brusquement, comme un spasme, dans les relations internationales, lorsque les parties concernées hésitent entre la guerre et la paix pour régler leur différend ; ou plus exactement, entre l’emploi de la force militaire et la négociation, puisque, à notre époque, on ne déclare pas plus la guerre que l’on conclut la paix, au sens juridique qu’on donnait autrefois à ces deux termes.
Telle est notre définition personnelle de la crise, car, après avoir déploré, à juste titre, que le mot « crise » soit maintenant galvaudé, comme l’est d’ailleurs – c’est nous qui l’ajoutons – le mot « stratégie », Jean-Louis Dufour nous rappelle opportunément que la « crise » est un phénomène précis, en principe bref et potentiellement dangereux, mais aussi porteur d’occasions, et qui nécessite pour être « maîtrisé » des décisions prises dans l’urgence. Il nous rappelle aussi, et à juste titre également, puisque porteuse de spécificité, l’étymologie grecque de ce mot qui évoque la notion de « décision », comme il nous dira plus loin, et là encore utilement, que le caractère chinois correspondant évoque l’idée d’« opportunité ». Il note ensuite que l’intérêt des analystes des relations internationales pour ce concept date de la crise de la guerre froide par excellence, celle des missiles de Cuba d’octobre 1962, qui est en effet particulièrement riche en enseignements, et notamment au sujet de processus de décision, comme nous avons eu l’occasion de le développer ailleurs, à la suite de nos recherches personnelles. Après avoir encore noté quelques définitions d’analystes français qui ont retenu son attention, Jean-Louis Dufour va nous présenter sa définition personnelle de synthèse, qui est trop longue pour que nous la citions ici, mais à laquelle nous ne trouvons rien à redire.
Poursuivant ensuite sa typologie du phénomène, et, partant lui aussi de l’analyse de la crise des missiles de Cuba – laquelle, soit dit en passant, a fait l’objet d’une étude française qui a été commentée dans cette revue –, notre auteur distingue quatre phases dans le déroulement d’une crise : la pré-crise, l’escalade, la détente, et enfin ce qu’il appelle « l’impact », c’est-à-dire les modifications qu’elle apporte par rapport à la situation antérieure. Cependant, si la crise n’est pas « maîtrisée » – car c’est bien sa « maîtrise » qui doit être recherchée, et non pas sa « gestion » comme on le dit, à tort, chez nous dans le langage courant –, elle risque de déboucher sur un conflit armé, que Jean-Louis Dufour appelle encore « guerre ». Il nous présente à ce sujet les résultats d’une étude statistique portant sur 217 cas de crises survenues entre 1929 et 1985, dont il ressort que 65 % d’entre elles ont été maîtrisées, alors que 12 % seulement furent suivies d’une « guerre » ; les 23 % restants concernent des crises survenues au cours d’une guerre et ne sont donc pas significatives pour notre propos. Puis, affinant encore sa typologie, l’auteur va distinguer différentes catégories, en les qualifiant de « soudaines », « voulues » ou « fortuites » ; et dans une autre perspective, de « crises conduites », « crises engrenages », « crises calculées », ou « crises accidentelles ». Enfin, il va en analyser le déroulement en distinguant le déclenchement, les modalités de la prise de décision, le comportement des acteurs, la fin de la crise, et enfin ses résultats immédiats.
Telles sont donc les « grilles de lecture » que nous propose Jean-Louis Dufour pour effectuer l’analyse raisonnée d’une crise des relations internationales. Il va l’entreprendre lui-même au long de près des deux cents pages suivantes de son livre, sur cinquante-trois crises qu’il a sélectionnées à cet effet, et cela depuis celle qui a résulté de la révolte des Boxers en 1900, jusqu’à celle qu’a close (momentanément) l’ultimatum de l’Otan concernant Sarajevo en février 1994. Son ouvrage nous offre ainsi, outre un important apport pédagogique, un recueil de références jusqu’à présent inégalé et par suite fort utile. On peut cependant s’interroger sur l’intérêt qu’il y avait du point de vue des enseignements pratiques à en tirer pour le présent et l’avenir, d’être remonté aussi loin dans l’histoire des crises. En effet, le phénomène guerrier dans les relations internationales a été profondément modifié par l’apparition du concept de dissuasion nucléaire, qu’on peut dater de janvier 1954 lorsque le secrétaire d’État américain rendit public l’adoption par son pays de la « stratégie des représailles massives », laquelle, par la menace d’une riposte « terrorisante » – comme le rappellent mieux que la nôtre les expressions anglo-saxonne, allemande et même russe –, rend désormais la guerre irrationnelle entre les acteurs principaux ; et cela tout en la tolérant entre leurs clients respectifs, mais seulement hors du théâtre de confrontation principal et à la condition qu’elle reste « limitée ». C’est ainsi qu’apparut la complémentarité stratégique « dissuasion-action extérieure », si brillamment mise en valeur au milieu des années 1960 par notre « complice » du centre de prospective et d’évaluation, l’alors colonel Poirier. Il s’ensuivit un renouveau de la réflexion stratégique sur la nature et l’efficacité de la menace de la force militaire, au lieu de son emploi réel, c’est-à-dire d’une « gestuelle » des armes, qu’on a appelée à tort « gesticulation » car cela tendait à la ridiculiser. C’est cette problématique d’ensemble que nous avions entrepris personnellement d’étudier en profondeur, ne serait-ce que parce qu’un de ses aspects, la « diplomatie navale », nous paraissait pleine de virtualités étant donné les capacités accrues à l’égard de la terre des systèmes d’armes navals, et l’évolution positive de la liberté d’agir militairement dans les espaces maritimes, reconnue par la nouvelle Convention internationale sur le droit de la mer.
Cependant, tout cela était clair au temps de la guerre froide, qui avait peu à peu fait admettre entre les partenaires d’une crise les règles d’une nouvelle pratique du phénomène guerrier. Qu’en reste-t-il aujourd’hui, s’il en reste quelque chose ? telle est la question qui mérite d’être approfondie, alors que la nature des relations internationales a été si profondément modifiée, que nous ignorons encore si la dissuasion nucléaire est exportable, et que, surtout, la nature des crises à envisager est très différente de ce qu’elle était hier, avec, en particulier, la montée du syndrome « identitaire » et le risque qu’il entraîne d’un terrorisme insaisissable. Dans le même temps, la légitimité de l’emploi de la force est de plus en plus contestée, sous l’emprise d’une universalité, toute théorique, des droits de l’homme et de l’économie de marché. Par ailleurs, les démocraties n’acceptent plus la perspective d’utiliser leur force militaire si cela doit comporter pour elles des risques de pertes humaines ; et leurs réactions – provoquées le plus souvent par l’émotion ou la mauvaise conscience qu’ont suscitées les images imposées par les médias à leurs opinions publiques – se limitent généralement à des gestes « alibis », tels que l’aide humanitaire ou la sanction économique, lesquels n’ont généralement aucun résultat politique. Un homme d’État français a pu dire, il n’y a pas très longtemps : « À notre époque, on ne peut répondre à la violence que par la négociation ». Effectivement, un des problèmes majeurs de notre époque est bien de rechercher si on peut encore employer la force, et alors comment, pour maîtriser la violence, que ce soit sur le plan intérieur ou dans les relations internationales ? Ce sont donc les stratégies à imaginer à cette fin dont il convient que nous nous préoccupions.
Dans le livre dont il vient d’être question, son auteur évoque en deux pages seulement l’avenir des crises, et il n’a pu ainsi que résumer quelques considérations générales, d’ailleurs pertinentes, sur les trois types de crises internationales que, d’après lui, pourrait bien connaître cette fin de siècle ; à savoir les « crises de conscience » et les « crises d’intérêts » (économiques), outre celles « de sécurité », dues alors à la montée des intégrismes religieux, à une éventuelle prolifération nucléaire et aux actions de groupements terroristes. Toutefois, ce n’est pas tant à la description prospective des crises futures qu’il conviendrait de nous attaquer, mais, là encore, aux stratégies concevables pour les maîtriser. C’est là une recherche à laquelle nous nous consacrerions volontiers aux côtés du colonel Dufour… si seulement nous avions vingt-cinq ans de moins ! ♦