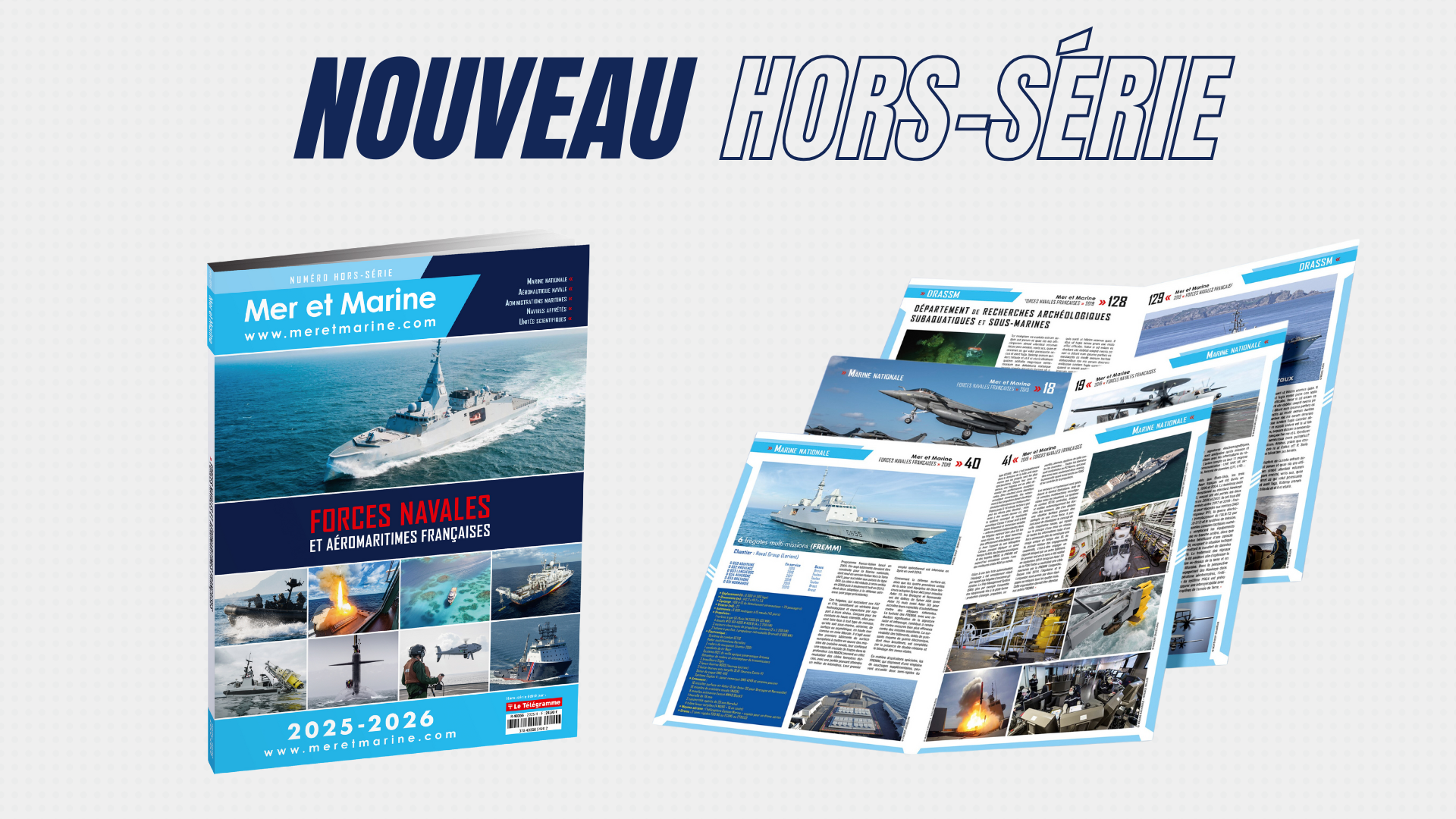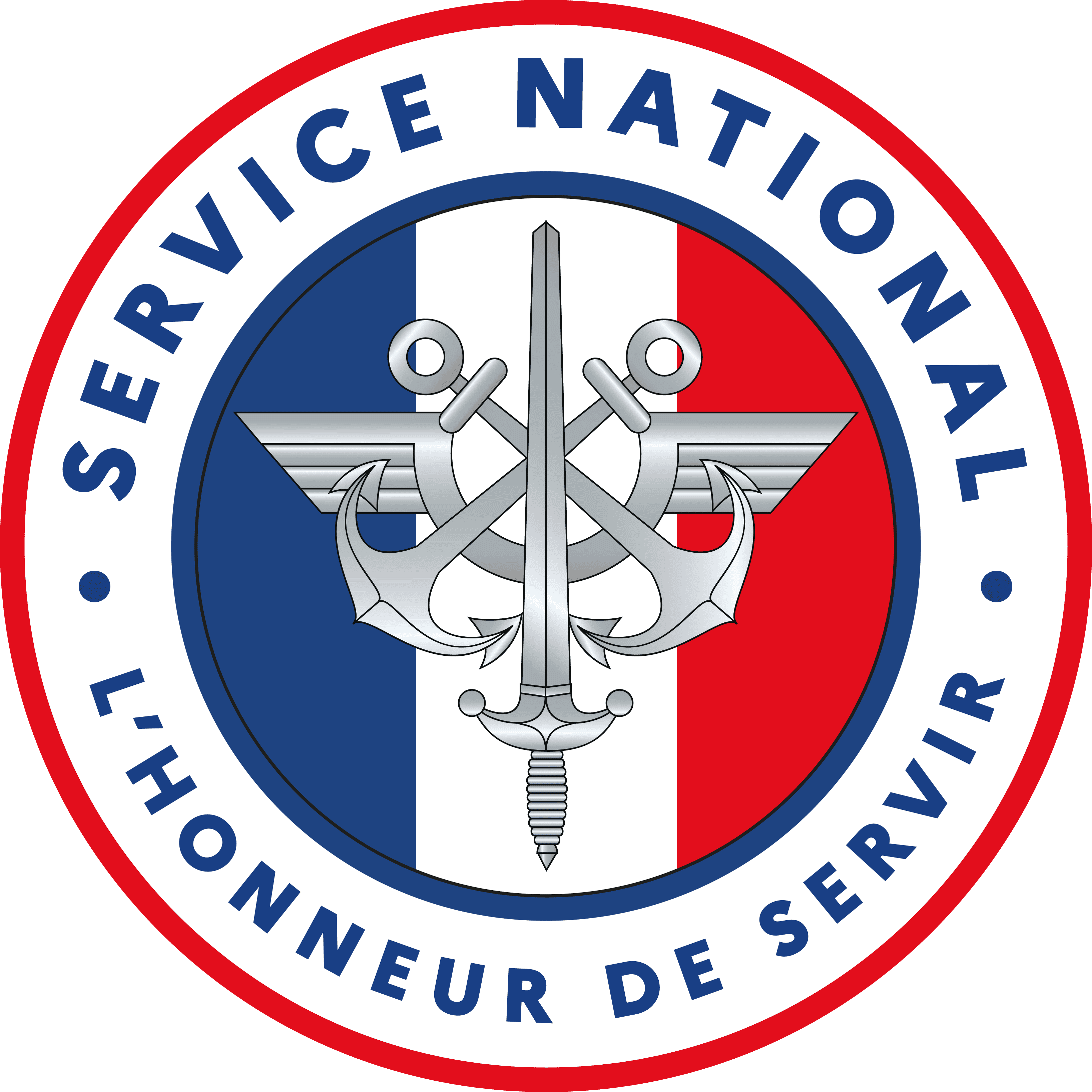Actions internationales - La Mission d'observation des Nations unies en Géorgie (Monug)
Portée par la perspective d’un nouvel ordre international, l’Onu s’est engagée pendant la période 1992-1993 dans de multiples opérations de maintien de la paix. Des forces d’interposition ont été déployées en Yougoslavie, en Somalie, au Mozambique, au Cambodge, puis en 1993 en Haïti et au Rwanda. L’intervention de l’Onu en août 1993 correspond cependant à une nouvelle approche des opérations de maintien de la paix. Comme au Liberia en septembre 1993, l’Organisation a envoyé une force d’observateurs militaires non armés, qui effectue son mandat en liaison avec une force multinationale régionale. Ces expériences laissent cependant paraître une certaine désillusion sur l’efficacité réelle de ce type d’opération.
La crise géorgienne entre dans le phénomène de recomposition des États contrôlés par l’ancienne Union soviétique. Face à ce nouveau conflit sanglant, l’Onu a tenté d’apporter une solution à la fois par les négociations et par le déploiement d’une force de maintien de la paix composée d’observateurs.
La crise abkhaze
Ce conflit a en effet commencé durant l’été 1992 en raison de la volonté abkhaze de se séparer de la Géorgie. Occupant la partie occidentale de la Transcaucasie avec un débouché sur la mer Noire, la Géorgie comprenant 5 500 000 habitants dont 70 % de Géorgiens, est composée des républiques autonomes d’Abkhazie, d’Adjarie et de la région autonome d’Ossétie du Sud. De nombreuses autres minorités existent, parmi lesquelles des Russes, des Arméniens et des Azéris. Quant à l’Abkhazie, dont la capitale est Soukhoumi, 44 % de ses 540 000 habitants sont géorgiens et seulement 17 % abkhazes. Les séparatistes sont donc très minoritaires. Cependant, sa large façade sur la mer Noire intéresse en particulier la Russie. De même, l’implication de cet État dans ce conflit sous des formes indirectes entre dans la stratégie du maintien de l’influence russe dans cette zone traditionnelle en jouant sur les clivages ethniques.
Il reste 82 % de l'article à lire
Plan de l'article