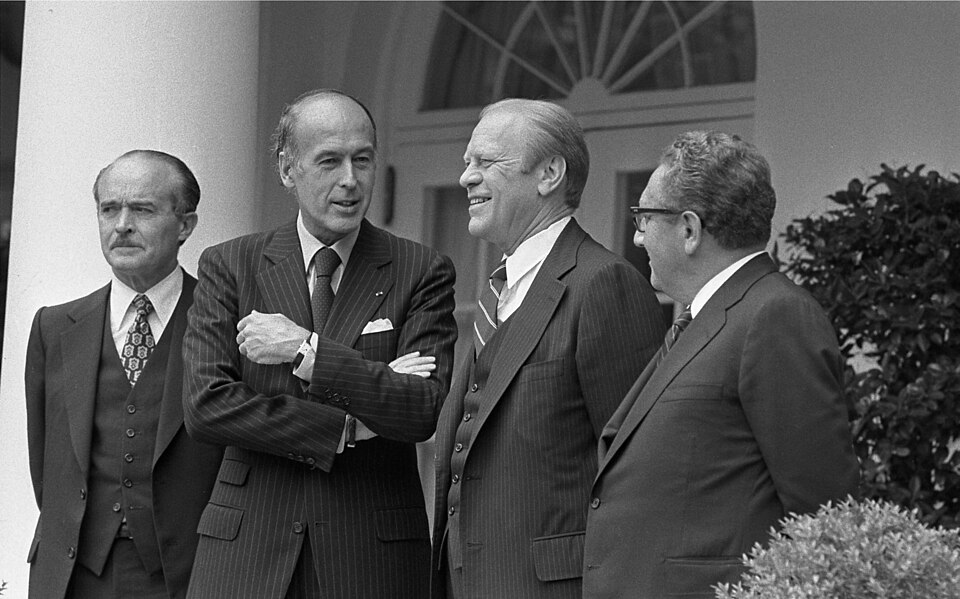Gendarmerie - Les missions judiciaires de l'inspection technique de la Gendarmerie
Exigence aussi juridique que fonctionnelle, le contrôle de l’action publique revêt une dimension particulière s’agissant des composantes de la force publique. En effet, la faculté de recourir à des moyens de contrainte légitimés et codifiés suppose, au regard des fondements mêmes de l’État de droit, un contrôle vigilant, presque soupçonneux sur tout agent public investi, par le Code de procédure pénale, du pouvoir d’arrêter ses concitoyens, d’enquêter sur leur vie privée, de perquisitionner leur domicile ou même de recourir à leur encontre à une force physique éventuellement mortelle. Cet impératif de contrôle de l’action du policier ou du gendarme, qui est relayé par la diffusion de règles déontologiques, donne lieu à l’intervention d’une pluralité d’acteurs, qu’il s’agisse du contrôle interne à l’institution considérée (par l’exercice du contrôle des pairs et de la hiérarchie, ainsi que par la mise en place de structures spécifiques) et du contrôle « sociétal » (par l’action de la justice, de la presse, des syndicats ou encore de certains groupes de pression comme les associations de protection des droits de la personne).
Pour ce qui est de la gendarmerie, ce contrôle interne a connu récemment une évolution importante compte tenu de l’extension du domaine d’intervention de l’inspection technique de la gendarmerie. À la différence de l’inspection générale des armées-gendarmerie qui relève du ministre de la Défense, cette inspection est directement subordonnée au directeur général de la gendarmerie, pour exécuter, sous son autorité, des missions d’information, de contrôle et d’études concernant l’organisation de l’institution, son service, ses personnels, son infrastructure et ses moyens. Officier général, l’inspecteur technique de la gendarmerie exerce ses missions de contrôle, sur pièces et sur place, selon une périodicité fixée ou de manière inopinée, en bénéficiant, bien évidemment, du libre accès aux documents, aux services et aux locaux. Au-delà de ses attributions traditionnelles (contrôle de gestion, vérification des comptes, surveillance administrative, contrôle de l’application de la législation et de la réglementation relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail), l’inspection technique s’est vu reconnaître une véritable fonction judiciaire ; en effet, selon les dispositions du décret du 19 septembre 1996, cet organisme « peut être saisi par l’autorité judiciaire de toute demande d’enquête relative aux infractions susceptibles d’avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par le personnel militaire de la gendarmerie nationale ».
Pour l’exercice de cette fonction d’investigation, l’inspection technique s’est dotée d’un bureau des enquêtes et des contrôles (BEC), composé actuellement de six personnes (deux officiers et quatre sous-officiers) habilitées à exercer les prérogatives liées à leur qualité d’officier de police judiciaire (OPJ). Ce bureau qui, par ailleurs, peut se voir confier par le directeur général de la gendarmerie, à la demande de la hiérarchie (commandants de circonscription), des enquêtes de commandement, prend en charge, sur saisine de l’autorité judiciaire (réquisition du procureur de la République ou commission rogatoire du juge d’instruction), le traitement des affaires pénales concernant les militaires de la gendarmerie dans deux hypothèses : pour les affaires graves, complexes ou de nature à avoir un retentissement dans l’opinion publique ; lorsque les investigations à conduire paraissent de nature, pour l’unité initialement saisie, à nuire à son bon fonctionnement, à compromettre la qualité des relations de service ou la bonne exécution de ses missions prioritaires (1). Il ne s’agit donc pas pour le personnel de ce bureau de se substituer aux unités de recherche compétentes, ni aux échelons locaux de commandement, mais plutôt d’effectuer, à titre exceptionnel, et dans un souci de légalisme, de neutralité et d’efficacité, certaines enquêtes manifestement préjudiciables à la fois au service et au prestige de la gendarmerie, qu’il s’agisse de présomptions, par exemple, de corruption, de prévarication ou encore de violences illégitimes. Il en serait de même dans le cas d’un gendarme soupçonné d’être impliqué, en dehors du service, dans une affaire d’homicide ou de trafic de stupéfiants, et cela compte tenu alors de l’absence — si spécifique de la condition militaire — de véritable frontière normative et culturelle entre les domaines privé et professionnel.
Au regard de cet impératif de contrôle de l’action du gendarme précédemment évoqué, notamment lorsque ce dernier est impliqué personnellement dans une affaire judiciaire d’importance, il est permis de s’interroger sur le bien-fondé de cette intervention de l’inspection technique de la gendarmerie, dans la mesure où il serait possible de craindre, à la lumière des tendances à l’esprit de corps, à la solidarité, au secret et à la dissimulation caractéristiques de toute « subculture » policière, que l’enquête effectuée par des gendarmes sur des faits mettant en cause d’autres gendarmes ne présente pas, potentiellement, toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité, de diligence et de sévérité qu’il convient d’attendre, si ce n’est d’exiger, en pareille circonstance. Face à ce type d’objections que l’observateur comme le citoyen d’ailleurs peuvent être amenés à formuler, il convient toutefois de souligner que, en ce domaine, les personnels de l’inspection technique agissent, certes en conformité avec leur appartenance statutaire à la gendarmerie, mais, plus fondamentalement, et au regard de la règle de droit et du travail d’enquête, comme d’authentiques auxiliaires de la justice, opérant sous l’autorité et le contrôle des magistrats, selon les règles du Code de procédure pénale et, et le cas échéant, du Code de justice militaire. Les dispositions concernant l’information des autorités hiérarchiques de la gendarmerie paraissent parfaitement significatives de cette situation particulière. En effet, si les OPJ de l’inspection technique sont tenus d’informer du motif de leurs investigations l’échelon du commandement approprié dans les affaires les plus importantes, en toute hypothèse, le résultat de leurs enquêtes ne peut être communiqué, à moins de porter atteinte aux règles de secret professionnel et du secret de l’instruction, à ces autorités hiérarchiques qu’après accord du magistrat compétent. Si cette situation de subordination du gendarme enquêteur à l’autorité judiciaire, traduction logique du principe de séparation des pouvoirs, présente un caractère général dans l’exercice des missions de police judiciaire, elle revêt malgré tout une signification toute particulière dans le cas présent, de sorte que le gendarme, pas plus qu’un autre citoyen, ne peut prétendre espérer ou se voir imposer, le cas échéant, un traitement différencié en sa qualité de justiciable. ♦
(1) Circulaire n° 2050 du 28 mars 1997 relative aux missions judiciaires de l’inspection technique de la gendarmerie.




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)