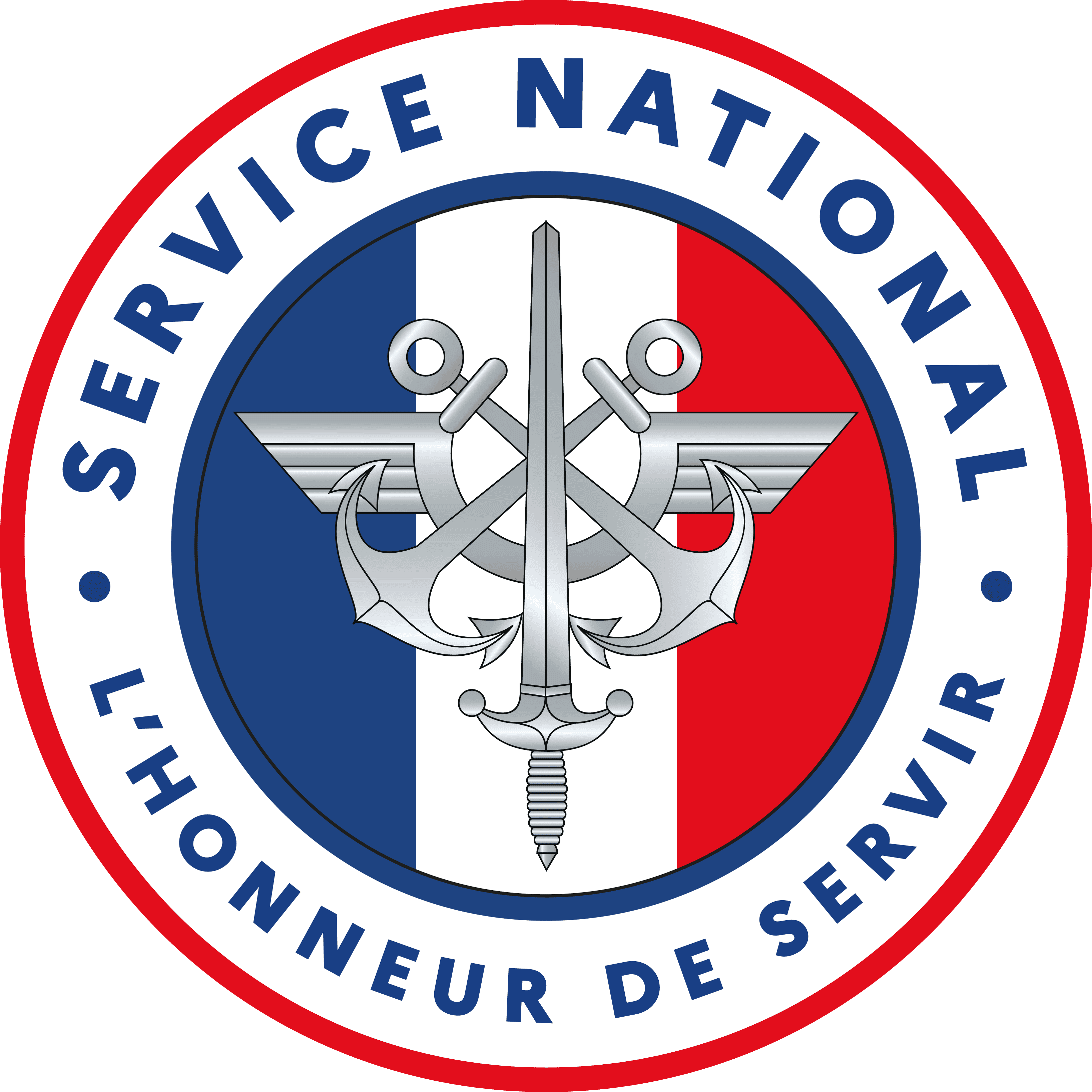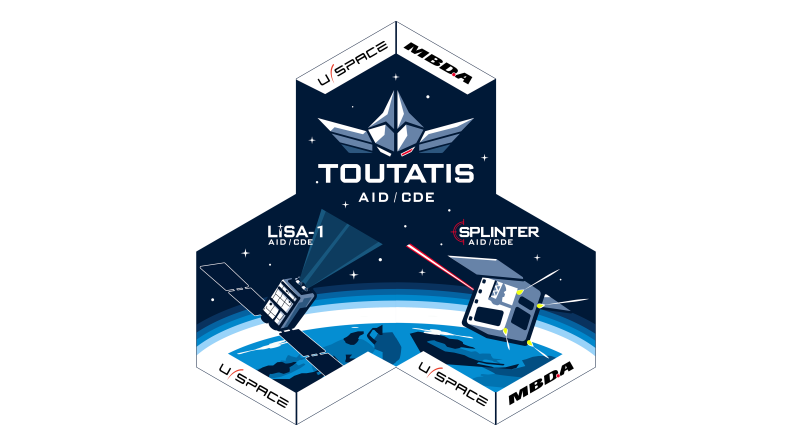Cette réflexion sur le secret, sa relation aux libertés individuelles et collectives et à la protection de la sûreté des États éclaire l’ambiguïté de l’action de ceux qui ont lancé la dynamique de divulgation de Wikileaks.
Wikileaks ou le paradoxe de la transparence
Le grand public a découvert Wikileaks lors des fuites de l’année 2010, concernant notamment la diplomatie et l’armée américaine (1). Cet épisode sans précédent, non par sa nature mais par son ampleur, a eu des répercussions importantes dans les opinions des différentes Nations ayant accès au Web.
En février 2012, cette organisation récidive avec la publication de millions de courriels de la société privée de renseignement Stratfor. Une citation du Time Magazine reprise en page d’accueil du site de Wikileaks, nous laisse entendre que ce site serait aussi important que le Freedom of Information Act (2) du 4 juillet 1966 qui oblige l’administration des États-Unis à fournir des informations au public. Cependant, il existe des dérogations pour les cas de sécurité nationale, de secret de défense, de politique étrangère, etc. Ainsi, cette phrase résume toute l’ambiguïté de Wikileaks qui se présente comme un outil démocratique alors qu’il ne l’est manifestement pas. Les conséquences des divulgations de documents classifiés ne sont pas neutres et plus largement, se pose le problème du blanchiment d’information.
La célébration de la transparence fait débat
Wikileaks est souvent présenté comme un outil démocratique permettant la transparence de l’État, et ainsi renforçant le contrôle des citoyens. Julian Assange serait un « Robin des bois » du cyberespace qui viendrait reprendre la richesse informationnelle des riches États, confisquant des trésors non accessibles aux citoyens. En quelque sorte, les États mentiraient par action, un peu et par omission, souvent. D’ailleurs, les informations fournies par Wikileaks ne sont-elles pas aussi utiles pour les chercheurs, les journalistes ? La très grande majorité des médias reprend du reste, directement ou indirectement, des informations, contextualisées ou non, issues des fuites (Le Monde, The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, etc.). Avec Wikileaks, certains commentateurs nous annonçaient, à l’été 2010, la fin du secret et ce pour le bien de l’humanité.
Du côté des États, les analyses et les réactions ne sont évidemment pas les mêmes. Les autorités françaises ont qualifié les fuites, à plusieurs reprises, d’irresponsables. L’administration américaine a condamné les actions de Wikileaks. Fin 2010, Hillary Clinton, Secrétaire d’État, affirmait même que ces publications mettaient des vies en danger, menaçaient la sécurité nationale américaine et sapaient les efforts américains de coopération internationale déployés pour résoudre des problèmes en commun (3). Des éditorialistes de grands médias, du Figaro ou de Libération par exemple, se sont exprimés contre les méfaits d’une trop grande transparence.
Cela montre une ambivalence médiatique face à Wikileaks et traduit un questionnement éthique et déontologique tout à l’honneur de ces médias. Ainsi, le secret serait-il un mal pour les démocraties ?
Le secret est-il nécessaire dans une démocratie ?
Le secret ne serait pas nécessaire aux États pour fonctionner, selon l’argumentaire de Wikileaks. Cette vision oscille entre une naïveté sur l’utilisation ultérieure de l’information et un fond de paranoïa ressortissant de la « théorie du complot ». Elle est partiellement recevable, si l’on veut bien considérer que les citoyens ont effectivement besoin d’informations pour exercer leur part de souveraineté et que tout ce qui est considéré comme secret par l’administration ne l’est peut-être pas toujours autant que prétendu.
Néanmoins, tant les États, les organisations, les entreprises que les citoyens ont besoin de secret : familial, médical, défense, bancaire, correspondances, sources journalistiques, etc. Raisonnons par l’absurde. Si le secret ne sert à rien, allons jusqu’au bout du processus, publions : les comptes en banques, les dossiers médicaux, les codes de cartes bleues, les codes des ordinateurs des journalistes, les communications téléphoniques, les courriels privés ou échangés dans le cadre du travail, les positions GPS des Smartphones, les salaires des uns, les allocations des autres, les déclarations d’impôts, les secrets de fabrication des entreprises, les analyses ADN des individus… Cela ne serait pas acceptable dans une société démocratique, dans laquelle le citoyen délègue à l’État, par le vote et dans des conditions fixées par les lois, le droit de cacher certaines informations pour le bien commun.
Le secret permet de préserver, ne l’oublions pas trop vite, des libertés individuelles ou collectives. Il faut noter, au passage, que seules les démocraties occidentales, principalement les États-Unis, ont fait l’objet des attaques de Wikileaks. Aurait-on oublié des démocraties, l’Afrique du Sud ou le Brésil, ou des régimes autoritaires comme l’Iran ou la République populaire de Chine ? Quelle est la légitimité des membres de Wikileaks, inconnus ou presque, non élus et qui s’arrogent le droit de receler puis de diffuser des informations, au nom du peuple ? Ils violent certainement des principes démocratiques, avec l’intention affichée et louable de vouloir les renforcer. Ainsi, Wikileaks bafoue manifestement des droits de l’homme en attaquant les principes de liberté, de propriété (4), de sûreté, de souveraineté du peuple… Cela peut faire débat même si la lecture des déclarations des droits de l’homme éclaire ces propos.
Publier les secrets des uns et des autres, qui existent bel et bien, ne serait-ce pas illégal et choquant ? Alors dans ces conditions, pourquoi vouloir conserver un secret ?
Conserver ou non le secret ?
La nécessité de conserver l’information peut paraître paradoxale, en nos temps de pillage informationnel sauvage. Il faut tout de même se souvenir qu’historiquement l’information cruciale des États a plus souvent été cachée que mise à disposition de tous. Le secret était la norme en ce qui concerne les données sensibles des États. Cela le devient pour nombre d’entreprises. Le développement des technologies de l’information et l’apparition d’acteurs non étatiques, comme Wikileaks ou Anonymous, dans les relations internationales, remettent en cause cette situation, au moins en apparence. Dans ces conditions, pourquoi garder un secret qui sera rendu public dans peu de temps ?
Cette question peut amener des réponses hétéroclites au niveau de la stratégie de chaque État. Pour certaines opérations ou actions, dont les objectifs stratégiques sont clairement exprimés, l’exigence de transparence semble parfois plus importante que le principe de secret systématique : dire ce qu’on va faire et faire ce qu’on a dit reste une démarche à portée stratégique. Cependant, certaines informations ne peuvent en aucun cas être diffusées pour des raisons de sécurité ou de légalité. Il est donc possible d’appliquer le principe suivant : toute information, qui n’atteint ni la sécurité, ni le Droit, peut être diffusée. Cela implique que ce qui est caché doit le rester, sauf à vouloir clairement nuire à celui qui le détient !
Un blanchiment d’information ?
L’information divulguée par Wikileaks dans les médias est présentée comme sûre. Pourtant, rien n’est moins sûr que cela. En effet, le piratage des données a non seulement atteint la confidentialité des informations, ce qui est le but, mais rien ne garantit l’intégrité des fichiers mis en ligne. Comment faire confiance au voleur d’information ? Dans le lot des milliers de fichiers apparemment légitimes, pourquoi des fichiers modifiés n’auraient-ils pas été introduits ? D’ailleurs, ces fichiers sont-ils tous authentiques ? Wikileaks se serait-il imposé dans le monde des médias (au sens large) comme un tiers de confiance !
Par ailleurs, les informations diffusées n’ont pas été vérifiées. Malgré la qualité du travail mené par certains grands journaux, les sources ne sont pas évaluées. Un tampon top secret n’est pas un label de véracité mais une mesure de classification de la diffusion des données qui protège l’information et les procédés de son acquisition. Or, plus la classification est élevée, plus il semble que les uns et les autres apportent de l’importance à l’information. Pour décrire les pratiques des bureaux « renseignement » des états-majors, les informations reçoivent une cotation qui permet d’évaluer la fiabilité de la source et la valeur du renseignement. Elles sont évaluées a posteriori par rapport aux informations déjà obtenues. Or, les informations confidentielles de Wikileaks peuvent difficilement être recoupées car leur diffusion simultanée et globale entraîne des reprises dans les médias et de faux recoupements dans les travaux universitaires.
De même – ce n’est pas un scoop – les diplomates et les militaires lisent les journaux. Admettons qu’une rumeur apparaisse dans des médias et qu’elle soit faussement confirmée par d’autres sources (personnes) qui s’appuient sur ces mêmes médias. Dans ce cas, un diplomate, par exemple, pourra coucher l’information sur un compte rendu classifié et en rendre compte à sa hiérarchie qui va l’évaluer dans d’autres documents que celui initialement utilisé et peut-être invalider la rumeur. Or, si le document initial du diplomate est diffusé par une organisation comme Wikileaks, ce document sera considéré comme fiable car secret. Ainsi, cette rumeur aura été blanchie en information officielle. Ce processus de blanchiment d’informations non fiables et parfois fausses peut avoir des conséquences à court terme sur les opérations et actions en cours (difficilement évaluable), à moyen terme sur les relations internationales et à long terme sur la connaissance historique d’une période.
La transparence ou le totalitarisme décentralisé ?
En définitive, la transparence ne renforce pas la démocratie mais le secret. Il est bien évident que les États qui ont fait les frais des révélations de Wikileaks ont renforcé leur protection du secret par des mesures techniques et d’organisation. D’ailleurs, le Department of Defense des États-Unis, dans sa Strategy for operating in cyberspace, du 14 juillet 2011, précise que les « Insiders » sont potentiellement une menace très importante contre les réseaux de défense. Comment ne pas voir une réaction à l’affaire Manning, nom du jeune soldat accusé d’être à l’origine de fuites vers Wikileaks ?
Par ailleurs, la transparence pourrait rapidement devenir despotique. Qui a élu les membres de Wikileaks pour avoir accès à toutes sortes d’informations ? En vertu de quel principe peut-on voler des informations à autrui ? Qui décide ce qui doit être diffusé et ce qui ne peut l’être (5) ? Quelle est la légitimité d’un pirate pour surveiller les agissements d’une organisation, d’une entreprise et d’un individu ? Selon quel principe de responsabilité, peut-on donner les noms de militaires en opérations, de leurs sources et de leurs procédés légaux utilisés ? Ces questions n’ont pas de réponses, sauf à promouvoir une démocratie despotique, de la volonté de tous contre celle de quelques-uns, comme l’a décrit Emmanuel Kant dans son Projet de paix perpétuelle. La transparence totale pourrait s’apparenter à un totalitarisme décentralisé, avec les meilleures intentions du « Meilleur des mondes ».
Le renforcement du contrôle de l’État par les citoyens ne doit pas se transformer subrepticement en renforcement du contrôle de l’État par des citoyens sans légitimité et s’accaparant sans aucun mandat la souveraineté de peuples. ♦
(1) Mise à jour d’une réflexion publiée en mai 2011 dans les Cahiers de la Société française des Sciences de l’Information et de la Communication (www.sfsic.org).
(2) ‘‘Could become as important a journalistic tool as the Freedom of Information Act’’ in Time Magazine (www.wikileaks.lu/).
(3) Jim Garamone et Lisa Daniel, ‘‘Hillary Clinton: Wikileaks’ release attacks international Community’’ in American Forces Press Service, 29 novembre 2010 (www.defense.gov/).
(4) Le principe de propriété, présent dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (préambule constitutionnel en France), ne l’est plus en tant que tel dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme, reconnue par la plupart des pays de l’ONU.
(5) Wikileaks, en juillet 2010, publiait simultanément 76 000 documents sur la guerre en Afghanistan. En octobre 2010, le site récidivait et publiait 400 000 rapports sur la guerre en Irak (à raison d’un document par 10 mn, cela représente une décennie d’exploitation des documents). En novembre 2010, sur plus de 250 000 documents annoncés pour ce Cablegate, seuls 243 avaient été publiés par le site. Alexandre Piquard, « Wikileaks, une transparence qui fait débat », in Le Monde.fr, 30 novembre 2010.