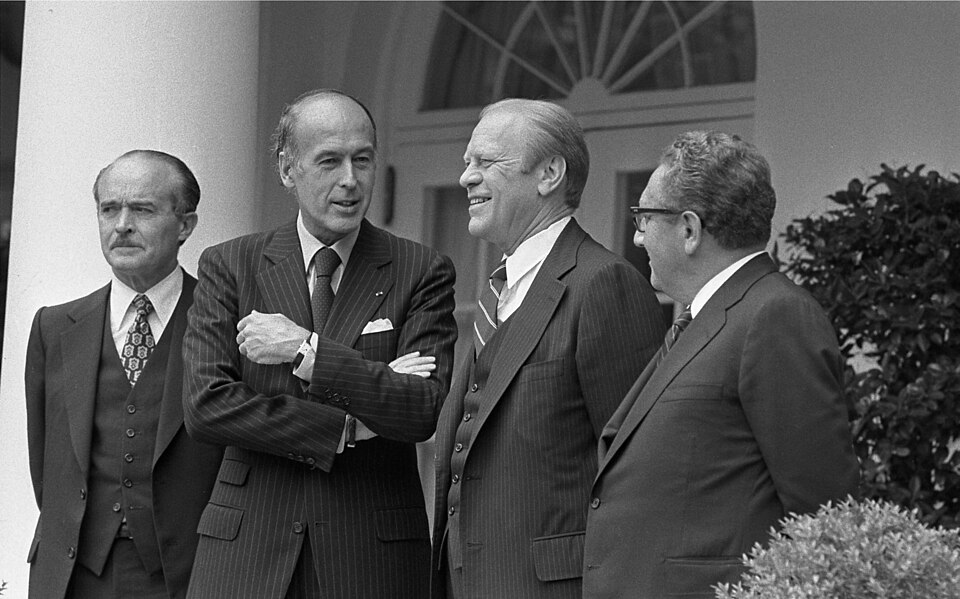Les relations internationales
Agrégé de droit public, professeur à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien recteur des universités d’Aix-Marseille, l’auteur signe la 5e édition, mise à jour, d’un remarquable ouvrage paru en 1975. Sur une scène caractérisée par « l’aspiration à un nouvel ordre mondial », l’auteur campe les différents « acteurs », avant de nous livrer le fruit de ses réflexions, ses certitudes mais aussi ses incertitudes sur leur « jeu ». Plan classique, certes, mais développé d’une manière rigoureuse et brillante.
Parmi les acteurs, c’est l’État qui se trouve « au centre des relations internationales », pour reprendre l’expression de Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle. La multiplication des organisations internationales s’impose cependant à l’observateur. Participent-elles vraiment au jeu international ? Tentant d’apprécier leur « poids incertain », Charles Zorgbibe examine, en particulier, l’exemple de l’ONU qu’il qualifie de « centre de relations internationales contradictoires ». En 1982, son déclin est tel que le secrétaire général, Perez de Cuellar, déplore ouvertement « l’érosion de l’autorité et du prestige des institutions intergouvernementales mondiales ». Cinq ans plus tard, l’Organisation apporte une contribution efficace à l’apaisement de nombreux conflits régionaux (Namibie, Afghanistan, Cambodge, guerre Iran-Irak). « L’impact de la diplomatie reaganienne est ici considérable ». L’autre facteur décisif relève de l’influence de la « nouvelle pensée » diplomatique soviétique, le ralliement de la Russie de Gorbatchev à une éthique universelle et sa prise en compte de l’unité du système international. En 1993, c’est « la relance » de Boutros Boutros-Ghali. Dans son rapport, il précise les différentes formes d’action des Nations unies : diplomatie préventive, système d’alerte rapide, mise à la disposition du Conseil de sécurité de forces armées permanentes. « Le système international connaîtra-t-il de nouveaux schismes ou restera-t-il réunifié ? » se demande l’auteur, avant d’examiner les forces transnationales, le dernier acteur. Parmi les plus influentes, il souligne les « puissances d’opinion », comme l’Internationale socialiste, le Conseil œcuménique des Églises, les internationales humanitaires, la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Les autres correspondent à l’irruption de nouveaux pouvoirs économiques, occultes et incontrôlés, dans la société internationale, dont ils « perturbent sérieusement » l’organisation : ce sont l’entreprise multinationale et les centrales syndicales internationales.
La deuxième partie de l’ouvrage, consacrée au jeu des acteurs, est articulée en quatre chapitres. Avec le dépérissement de la guerre froide en « paix froide », les contradictions éclatent au sein de chaque système, ouvrant l’ère des convictions éphémères : c’est « La fin des certitudes ». L’auteur étudie tout d’abord les structures de l’Alliance atlantique et ses objectifs. Il rappelle les trois types de solutions qui ont été préconisés pour rétablir une certaine égalité entre ses membres : la consultation des Alliés ; la planification stratégique commune ; le partage des armes qui est, en fait, le seul vrai remède. On connaît, à ce sujet, l’échec des différents projets ou expériences de création de forces collectives. Charles Zorgbibe en retrace ici brièvement l’historique et élargit sa réflexion aux problèmes de la construction d’une défense européenne commune, qu’il appelle d’ailleurs de ses vœux.
En août 1968, l’affaire de Tchécoslovaquie et la doctrine de la souveraineté limitée « redessinent » les fonctions du Pacte de Varsovie : le maintien de la discipline du camp socialiste et la définition de l’État socialiste « orthodoxe ». Après le bond en avant de la perestroïka et de la glasnost en 1987, un véritable « effet Gorbatchev » existe en Europe de l’Est, mais comment libéraliser l’empire tout en le gardant ? En ce qui concerne enfin « l’afro-asiatisme », l’auteur se demande s’il n’est pas en fin de compte porteur d’une nouvelle morale internationale et s’il ne faudrait pas lui reconnaître un certain « rôle pédagogique ».
L’annonce de la rencontre au sommet américano-chinoise (qui se tiendra en février 1972) symbolise la dissolution de l’ordre bipolaire né à Yalta et l’instauration d’une diplomatie triangulaire fondée sur des relations d’antagonisme entre Washington, Moscou et Pékin : c’est « La redistribution des forces ». La dissymétrie des antagonismes explique les ouvertures de l’Union Soviétique vers l’Occident qui ont permis de développer les rapports paneuropéens et de préciser les interactions soviéto-américaines. Chacun des trois partenaires, craignant la formation d’une coalition des deux autres contre lui, doit les empêcher de pousser trop loin leur éventuelle collusion. Pour achever ce panorama, l’auteur nous décrit la nouvelle scène asiatique avec la « rentrée » de la Chine et sa déception dans ses rapports avec l’Occident, sur les plans économique, politique et stratégique. La Chine manifeste beaucoup de prudence face à l’Union Soviétique, car, pour Pékin, celle-ci ne renoncera jamais à son offensive stratégique globale. « Par leur rupture avec Moscou, les Chinois ont rendu une soudaine fluidité au jeu international. Modernes praticiens de l’équilibre, ils ont souhaité la constitution d’une alliance de revers avec l’Occident contre l’URSS. À l’heure de la montée des périls, ils préfèrent se placer en position d’attente entre les deux alliances à vocation mondiale ». L’auteur termine son chapitre par le Japon, en analysant l’évolution de son concept de sécurité. Il souligne le renforcement de ses capacités défensives, proportionnellement à sa puissance économique, et son accession à la maturité diplomatique et militaire.
Dans le chapitre intitulé « Vers un monde ordonné », l’auteur rassemble ses réflexions sur la manière de « surmonter le paradoxe d’un monde où coexistent l’arme de destruction absolue et l’État de souveraineté absolue ». Il écarte d’emblée la solution la plus « radicale » mais « utopique » de l’organisation d’un État mondial. À défaut, d’autres courants peuvent être distingués, qui sont autant de « tâtonnements » vers une plus grande unité : la paix par le désarmement ou le contrôle des armements, qui tend moins à l’impossible abolition de l’armement qu’à sa domination ; la paix par la convergence, doctrine fondée sur la prédiction du déclin des idéologies et du rapprochement des systèmes politiques, économiques et sociaux ; la paix par un nouvel ordre économique, qui tend à combler le fossé séparant les nations riches et les peuples prolétaires.
La « Réunification du système international » constitue le chapitre d’actualisation de l’ouvrage. Il débute d’ailleurs par cette citation de Bismarck : « Quel univers magnifique ! Tout est maintenant la tête en bas et les pieds en l’air… ». Nous assistons, depuis 1989, au renouvellement total de la scène internationale et aux tentatives de reconstruction d’un ordre mondial. L’auteur passe en revue « l’effet Gorbatchev », les révolutions d’Europe de l’Est avec la chute du communisme, la fin de la doctrine Brejnev et du Pacte de Varsovie, avant d’analyser les défis de l’après-communisme, le processus de réunification de l’Allemagne et ses lendemains. Il examine enfin l’après-guerre froide en Afrique, en Asie et en Amérique latine. L’Afrique est marginalisée ; elle n’est plus un enjeu géopolitique entre l’Est et l’Ouest. Les tensions se sont apaisées en extrême Asie, ce qui a permis de régler nombre de contentieux régionaux. « L’Amérique latine quitte l’affiche », chassée par « le cataclysme survenu en Europe de l’Est ». La fin des tensions Est-Ouest et la disparition du modèle communiste y ont permis un extraordinaire essor de la démocratie de type libéral-occidental. De ce vaste tour d’horizon, l’auteur ne pouvait pas omettre les problèmes relatifs à la prolifération dans le Tiers-Monde des armes de haute technologie, qu’il passe en revue par catégorie.
L’ouvrage s’achève par une réflexion intitulée « À la recherche d’une nouvelle architecture européenne ». « Le chemin de la paix » est, décidément, « difficile à suivre » : le tissu européen est déchiré, de toutes parts, à l’est et au centre de l’Europe, où trois fédérations ont éclaté dans des conditions fort diverses. Est-ce le retour à l’Europe de Sarajevo, s’interroge-t-il ? La chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide ont enlevé son moteur et sa rationalité historique à l’intégration européenne telle qu’elle fut conçue et engagée dans les années 1950. Une nouvelle définition des valeurs, des projets, des institutions collectives, s’impose à l’ensemble du continent. L’auteur envisage trois scénarios pour l’avenir : l’accentuation de l’anarchie paneuropéenne de l’après-guerre froide ; la réapparition d’un « nouvel ennemi global », euphémisme désignant une Russie redevenue agressive, aboutissant à la reconstitution d’une structure bipolaire avec, cependant, un renversement total de la situation stratégique ; la recomposition pacifique de l’espace paneuropéen. Cette dernière s’effectuerait autour de trois acteurs principaux : la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ; l’Alliance atlantique, avec « l’inconnue de l’impact que pourrait revêtir une véritable structure européenne de défense » ; la nouvelle Russie enfin qui pourrait se voir confier un rôle en Asie centrale, avec la possibilité de création d’une organisation de sécurité collective regroupant « ceux des membres de la Communauté des États indépendants (CEI) qui le souhaitent ». La stabilité de l’immense espace eurasiatique, ce pivot du monde selon Mackinder, est en effet « indispensable à celle du nouveau système paneuropéen ».
En conclusion, le livre de M. Charles Zorgbibe est une somme. C’est un ouvrage de référence, un véritable « traité » pour qui veut approfondir l’étude des relations internationales, en prenant le recul nécessaire par rapport à l’histoire « événementielle ». La richesse de la bibliographie accompagnant chacun des chapitres constitue une aide particulièrement précieuse pour le chercheur. Enfin, la finesse et la rigueur des analyses et des synthèses, la pondération des jugements émis, la diversité et le réalisme des hypothèses sur lesquelles ils reposent, ne peuvent qu’entraîner l’adhésion du lecteur. ♦




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)