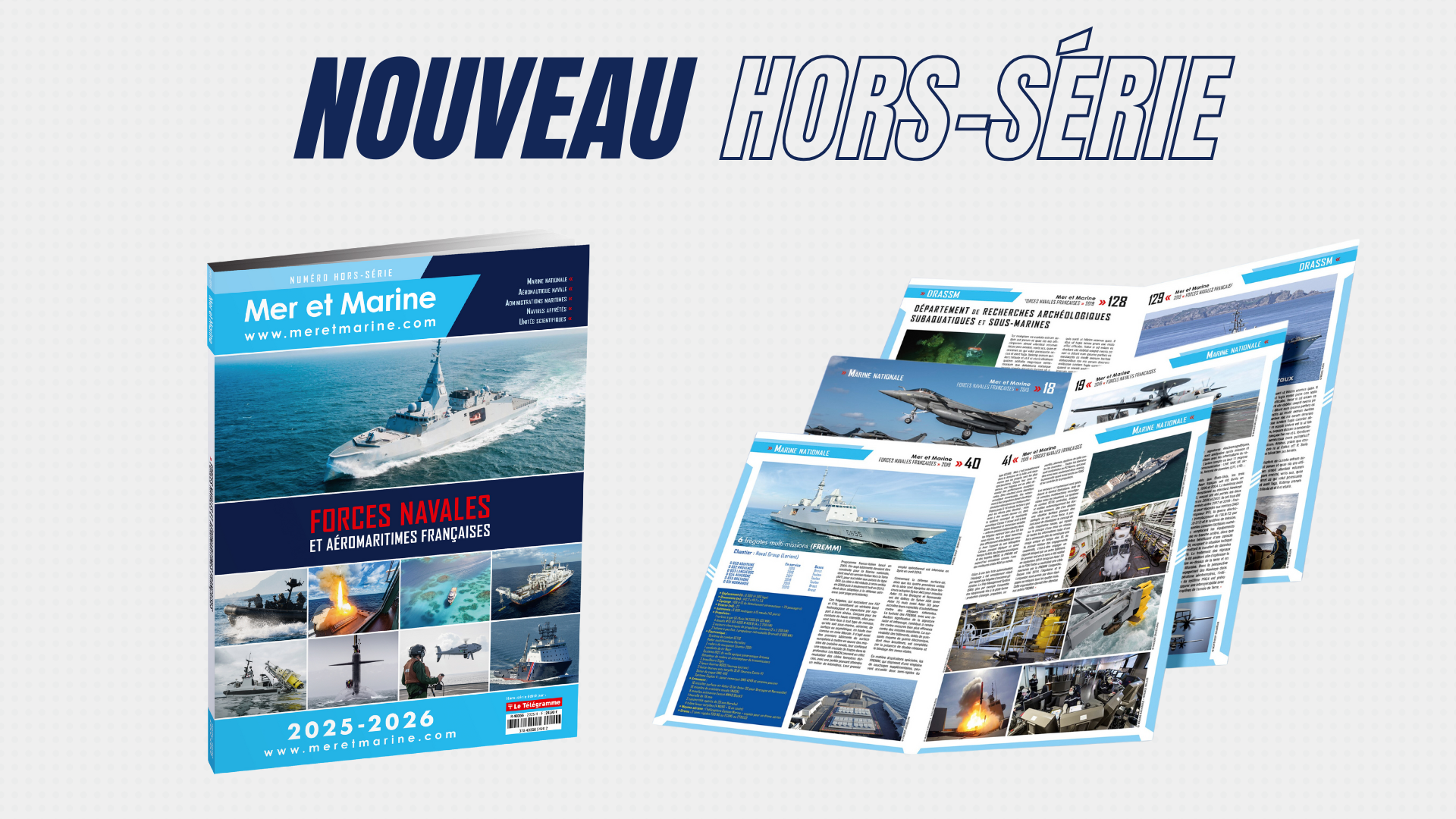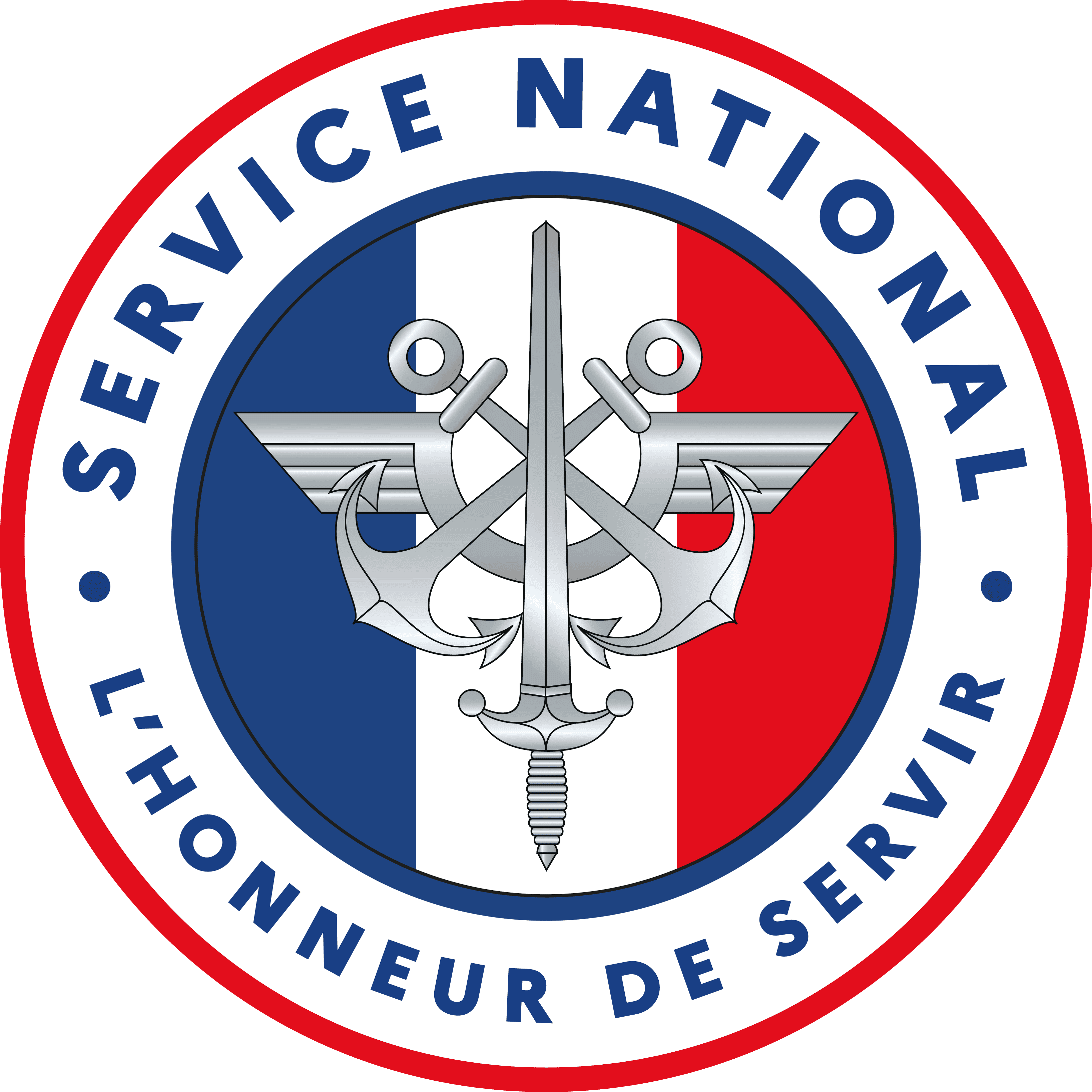L’Europe et la crise de Cuba
Ce livre, qu’on pourrait trouver hors saison, a trois justifications : il aborde la crise de Cuba de l’œil des Européens ; il bénéficie, avec le recul du temps, de l’ouverture de quelques sources américaines (dont les procès-verbaux des réunions des dirigeants américains le 16 octobre et de celles de l’Executive Committee of the National Security Council le 27 octobre, deux journées capitales) ; il réunit les points de vue de treize témoins ou spécialistes éminents et divers (un Allemand, trois Américains, un Anglais, cinq Français, deux Italiens et un Turc). Certes, on déplore que l’équipe ne compte pas de Russe et que les archives soviétiques de 1962 restent fermées… comme celles de Turquie et d’Italie, mais la contribution de l’amiral Duval, familier de la gestion des crises, montre avec talent tout le parti qu’on peut tirer des « archives orales », et du memory jogging (expression dont l’amiral souligne la saveur) regroupant à Harvard, en 1987, témoins et chercheurs. Quand enfin on saura que l’ouvrage est le fruit d’un colloque organisé en octobre 1992 par le Grefhan (Groupe d’études français sur l’histoire de l’armement nucléaire), auquel nous devons déjà L’arme nucléaire française, pourquoi et comment ? (1), on sera assuré de son sérieux.
Le pourquoi de l’initiative de Nikita Khrouchtchev et ses conséquences, telles sont les deux grandes questions que l’on se pose à propos de la crise de 1962. En dépit des éléments nouveaux que les auteurs étudient, on ne trouvera pas ici de réponses fermes, et le mystère demeure, emporté dans la tombe par les deux K et qui permet à chacun de se livrer à ses supputations.
Les trois mobiles le plus souvent prêtés à Khrouchtchev sont la prévention d’une attaque américaine sur l’île, la situation de Berlin dont il voulait modifier le statut, ce qui ne se pouvait qu’en position de force, le missile gap enfin, celui-ci étant en défaveur non pas des États-Unis, comme Kennedy voulut le faire accroire, mais bien de l’Union soviétique. Sur le premier point, l’attaque directe de Cuba n’était pas, aux États-Unis, à l’ordre du jour. Sur le second, le lien avec Berlin ne convainc pas davantage, sinon dans une perspective pessimiste d’extension de la crise, dont aucunes prémices n’apparurent. Le rétablissement de la situation stratégique de l’URSS, fort défavorable à l’époque, par le déploiement à portée du territoire américain de quelques SS-4 et SS-5 est une hypothèse plus crédible, à laquelle donne du corps le possible marchandage missiles cubains-Jupiter turcs (voire italiens). Sur ce point essentiel les auteurs, honnêtes universitaires pour la plupart, n’apportent pas d’éléments décisifs. Rien n’effacera que les Jupiter turcs, comme italiens, étaient obsolètes, non certes techniquement, mais au plan stratégique. Armes de première frappe, ils s’inséraient mal dans la stratégie nouvelle de riposte graduée : leur remplacement par des Polaris embarqués, notamment en Méditerranée, était prévu avant la crise, comme lui est antérieure l’adoption de la flexible response.
Ces ambiguïtés, on le sait, ont nourri en leur temps la polémique Gallois-Aron. Il est bien plaisant de la retrouver ici, sous la plume du général lui-même et de l’historien Georges-Henri Soutou parlant pour Raymond Aron. On connaît la sévérité de Pierre M. Gallois à l’égard du Président américain, de son inexpérience, de son indécision, et à l’inverse l’américanisme nucléaire de Raymond Aron. Les deux adversaires, curieusement, se rejoignent – presque – sur un point de doctrine : Gallois tient les Jupiter et les Thor pour plus dissuasifs que les Polaris, ce qui est tout à fait juste mais assez peu « galloisien » ; Raymond Aron va plus loin et, selon M. Soutou, se réjouit de ce que « la riposte graduée rétablisse une relation clausewitzienne entre la guerre et la politique », ce qui est une position, il faut le dire, fort inconvenante et quasi sacrilège.
Livre lu, on serait tenté de ne retenir de la crise, avec le général Gallois, que son aspect pédagogique. Par la décision inconsidérée de Khrouchtchev, les deux dirigeants se trouvent placés au pied du mur, le découvrent immense et chargé d’énormes menaces qu’ils s’évertuent à détourner. La découverte fut si rapide et si évidente que l’éventualité d’une guerre nucléaire fut vite écartée, bien que sans cesse évoquée, et le général de Gaulle, qu’on présente, non sans raison, comme le grand vainqueur de la crise, ne s’y est jamais trompé. Pourtant la leçon qu’ont tirée de l’événement les deux superpuissances fut bien incomplète : téléphone rouge et circonspection, sans doute, mais aussi poursuite d’une course aberrante aux armements.
Que les alliés européens, enfin, aient été tenus pour rien dans la crise, il n’y a pas à s’en étonner : le nucléaire, c’est le nucléaire, dont la responsabilité ne se partage pas. Le monopole – et le secret – fut bien gardé, dont l’exemple le plus frappant est la connivence entre techniciens anglais et américains, le Bomber Command britannique se plaçant en alerte sans que son gouvernement en soit informé.
Aujourd’hui où paraît, faussement, se clore l’ère nucléaire militaire ouverte en 1945, le survol est éloquent des crises qui la jalonnent : guerre de Corée, Dien Bien Phu, campagne de Suez 1956, Cuba 1962, euromissiles au début des années 1980. Dans cette succession, la crise de Cuba marque une prise de conscience que reconnaît, avec une naïveté britannique. Lord Mountbatten, alors chef d’état-major de la défense anglaise : « Eh bien ! qu’est-ce que nous aurions fait si les Russes ne s’étaient pas retirés ? Est-ce que nous le savons ? » ; et le rapporteur d’ajouter : « À ce genre de question, il n’y a pas de réponse ». ♦
(1) Marcel Duval et Yves Le Baut, SPM, 1992 ; voir Défense Nationale, août-septembre 1992.