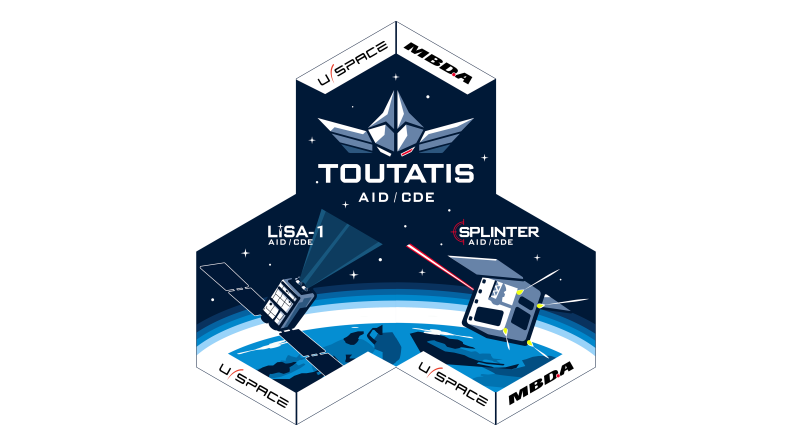Mémoire adressé à Monsieur le Premier ministre sur la guerre, l’économie et les autres passions humaines qu’il s’agit de gouverner
Voici un ouvrage dont le titre devrait retenir l’attention des tenants de la défense globale. En apparence, il rejoint les préoccupations du « Prince » auquel le Mémoire est adressé, puisque M. Raymond Barre, on s’en souvient, a pris pour thème d’une conférence prononcée en septembre 1976 à l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale) les rapports de l’économie et de la défense militaire. En fait, Philippe Simonnot se tient bien au-dessus de ces comparaisons et vise, visée sans cesse reprise et sans cesse déçue, à saisir les origines de la violence collective et de la guerre.
Philippe Simonnot est l’auteur de plusieurs ouvrages d’économie et a écrit en 1977 un livre qui a fait choc, « Le Monde » et le pouvoir. Celui qu’il nous offre maintenant tient à la fois de l’érudition et du dilettantisme, agréable mélange. De l’érudition en ce qu’il convoque au débat les maîtres-penseurs de la guerre et ceux de l’économie : Clausewitz bien sûr, flanqué de son poisson-pilote Raymond Aron ; Machiavel, comme il se doit ; mais aussi Alain (celui de Mars ou la guerre jugée) et Michel Foucault (le penseur de la violence structurelle) ; et puis Malthus, Marx, Adam Smith, Keynes et bien d’autres moindres seigneurs. Du dilettantisme en ce que son propos est un cheminement historique, occasion de réflexions lumineuses, mais fort peu une thèse, comme le voudraient et l’auteur et son titre. Du moins cette thèse sera-t-elle difficilement suivie par le lecteur non spécialiste, pris entre la pensée des maîtres-penseurs cités plus haut, les commentaires de l’auteur et les propres idées de celui-ci.
Si thèse il y a, elle est en forme de question : de l’intérêt et de la passion, lequel est le fauteur de guerre ? Question plus précise : est-il juste de faire de l’intérêt « le dompteur des passions » et, partant, le garant d’un pacifisme efficace ? La réponse n’est pas claire. On s’y attendait, et il faut voir dans cette obscurité non une absence de rigueur dans la pensée de l’auteur, mais son honnêteté toute scientifique face aux aléas immaîtrisables du comportement humain… et de ses interprétations. Voici les économistes du XIXe siècle pour qui l’intérêt bien et nouvellement compris garantit la paix. Arrive la Grande Guerre, et son grandiose démenti ! Scrute-t-on l’intérêt à cœur ? Le voilà pris au sens large de l’âge classique, qui y incluait la totalité des aspirations humaines. Et le voici ensuite, fut-il entendu au sens moderne strictement matériel, considéré lui-même comme passion. En sorte que ce nouvel ouvrage d’un économiste confirme ce que son auteur dit des autres : « l’incohérence est la marque des livres d’économie… bibles où tout le monde peut trouver son compte ».
Mais on conviera le lecteur moins à suivre le fil d’une thèse qu’à se réjouir des aperçus brillants et stimulants que l’auteur, chemin faisant, dévoile. On lira avec plaisir, dans l’introduction, l’analyse sans concession qui est faite de la fin de la guerre, à partir de la formule de Clausewitz, quitte à regretter la mauvaise querelle qu’on lui cherche sur sa philosophie politique. La définition de la politique n’est pas l’affaire de Clausewitz, à qui il suffit que cette politique soit définissable et donc implique le besoin éventuel de soumettre l’ennemi à notre volonté. Il faut rappeler qu’il a très nettement avoué les limites de sa réflexion politique, abandonnant in fine la conclusion au philosophe (De la guerre, Éditions de Minuit, p. 551).
Avec Machiavel, sage stratège du juste milieu, nous voyons la cause profonde de la guerre « dans la nature humaine, désolée par la misère, dégoûtée par le bien-être, dans cette fureur pour la nouveauté, même si cette nouveauté est reconnue à l’avance comme un leurre ».
À propos d’Alain, dont le pacifisme a été bien cruellement traité par les faits du vivant même du célèbre essayiste, la topographie corporelle de Platon (tête, cœur et ventre) nous fournit encore la clé passionnelle de la guerre : « le siège de la guerre n’est ni dans la tête, ni dans le ventre. Il est en ce lieu où, selon une tradition millénaire, l’âme se rattache au corps, en ce lieu où naissent et se nourrissent les passions : le cœur ».
Et cette phrase encore, qui est à la fois contre Clausewitz, contre les stratèges modernes et contre le gauchisme français : « Comme une mauvaise herbe, le concept d’intérêt a envahi (au XVIIe siècle) tout le jardin de la pensée – cela est arrivé de nos jours pour celui de pouvoir… ».
On tirera enfin agrément et profit de l’analyse subtile que fait Philippe Simonnot du capitalisme (chapitre IV), solution de survie dépassée par sa réussite, et de ses commentaires sur l’apparition redoutable de la prévisibilité, outil qui nous est proposé pour le meilleur et pour le pire. À partir de là, et pour réconcilier l’auteur avec Aron-Clausewitz, et peut-être avec lui-même, on observera que le pilotage serré à quoi tendent les organisations modernes n’est pas un moyen tout à fait sûr d’annuler les risques d’affrontement. Ces organisations font métier de penser la conjoncture, et le simple fait de la penser la rend redoutable, quels que soient l’innocence et le bien-fondé des intentions. La rencontre d’une pensée irrémédiablement génitrice et de structures contraignantes mais toujours partielles crée les conditions de l’explosion. C’est peut-être ici la seule raison acceptable de la prévention des peuples modernes contre le pouvoir. ♦