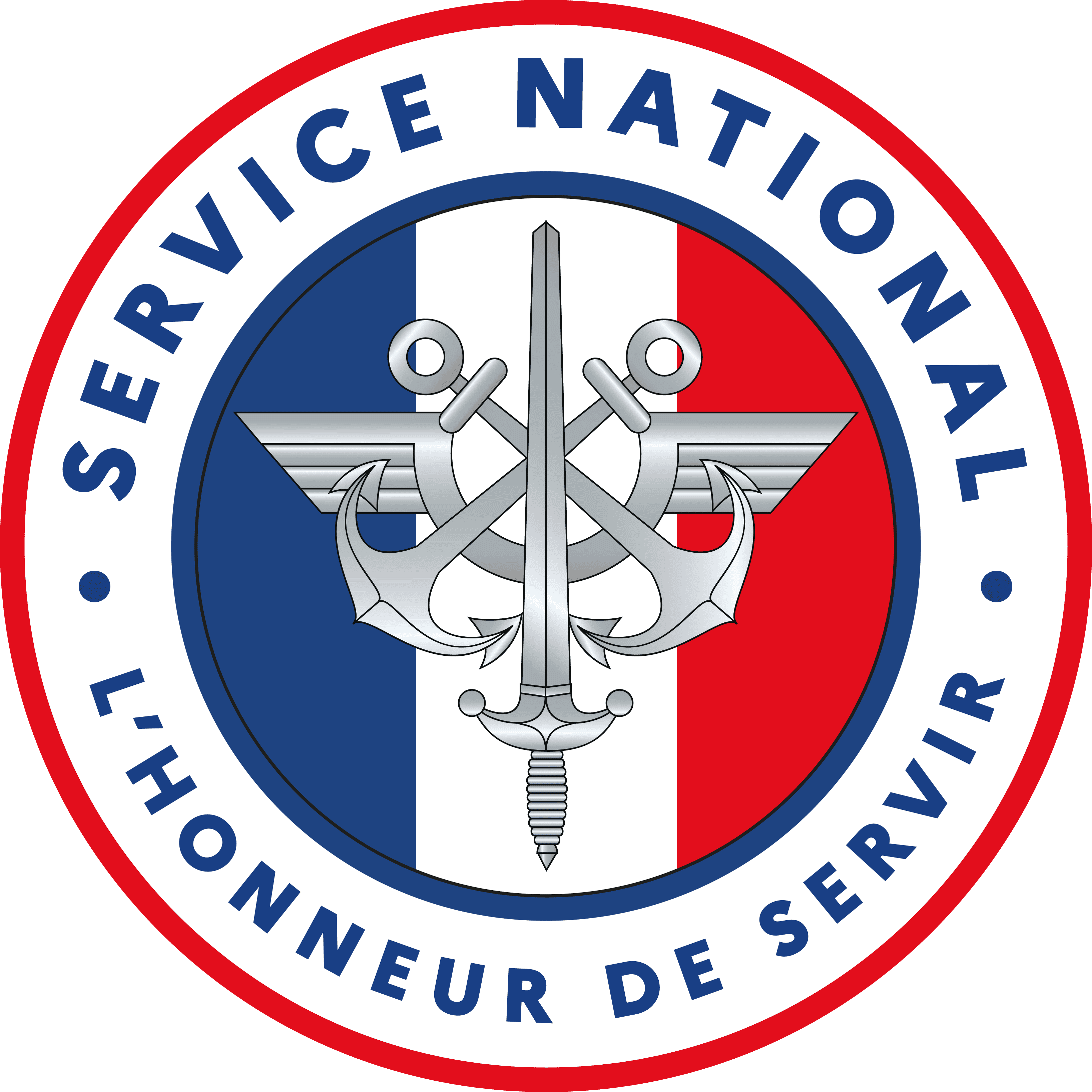Wellington
Pendant 22 ans, de 1793 à 1815, l’Angleterre et la France ont été presque continuellement en guerre l’une contre l’autre. Les armées impériales, si longtemps victorieuses, ont connu l’insuccès dans l’Espagne insurgée après 1809, dans l’immensité russe en 1812, dans l’Europe coalisée de 1813, dans la campagne par trop inégale contre les envahisseurs de 1814 ; mais ce sont deux chefs militaires anglais qui leur ont porté les coups décisifs : Nelson à Trafalgar et Wellington à Waterloo.
Ce dernier était-il meilleur stratège que l’Empereur qu’il a battu le 18 juin 1815 ? Napoléon était persuadé du contraire : « ses troupes ont été admirables », écrit-il de son adversaire, « mais ses dispositions furent pitoyables : sa gloire est toute négative, ses fautes sont immenses ». Certes, il se peut que le commandant des forces britanniques, hanovriennes, germaniques et néerlandaises ait été surpris le 16 juin et qu’il ait frisé la défaite que connaissait ce même jour à Ligny son allié prussien. Peut-être, si l’Empereur avait attaqué plus tôt le 18, les 70 000 Français auraient-ils finalement battu les 63 000 hommes de Wellington avant l’arrivée des 30 000 et bientôt 80 000 Prussiens de Blücher que les 30 000 soldats de Grouchy ne surent pas tenir éloignés du champ de bataille. Ce qui paraît certain, c’est que le chef anglais a su choisir en avant des forêts de Bruxelles, comme 5 ans plus tôt à Torres Vedras, une excellente position, difficile à aborder par son assaillant et bien reliée sur les côtés à son allié et sur les arrières à ses bases et ports. Ce qui est tout à fait évident, c’est que la volonté opiniâtre du « duc de fer », son flegme imperturbable et son coup d’œil lucide ont fait merveille sur le terrain dans ce qu’il appelait lui-même, le lendemain, « une sacrée aventure, une course sacrement serrée, une affaire dont je ne pense pas, Nom de Dieu ! qu’elle ait pu être enlevée si je ne m’y étais pas trouvé ! ».
Plusieurs années plus tard, il dira d’elle : « Admettons que j’ai été surpris ; j’ai tout de même gagné la bataille ». Ce mot du vainqueur de Waterloo s’apparente à celui, bien connu, du vainqueur de la Marne, Joffre, né l’année même où mourut Wellington. Il est d’ailleurs amusant de noter qu’à l’un comme à l’autre les amateurs de récits épiques font les mêmes étranges reproches d’avoir triomphé en raison de leur fermeté de caractère plutôt que de leur habileté, d’avoir recouru à l’organisation méthodique davantage qu’à l’intuition et à l’inspiration, de s’être quelque peu égarés dans les affaires de la guerre en marge de leurs métiers de diplomate pour l’Anglais et d’ingénieur pour le Français, ce qui est oublier complètement l’excellente formation militaire due par l’un et l’autre à leurs campagnes antérieures. La comparaison s’arrête là entre deux hommes si différents par l’éducation, le tempérament et l’allure.
Sachons gré à l’observateur très fin, averti et perspicace que fut Jacques Chassenet de nous avoir donné avant de disparaître ce portrait très vivant d’un grand chef militaire, parfait gentleman et excellent public servant, amateur de mondanités, de sport, de musique et de politique, aimant les chevaux, les femmes, les chiens, les belles demeures de briques et les allées plantées d’arbres centenaires, pénétré de ses devoirs envers la Couronne, la gentry et le pays, aussi à l’aise au Cabinet de Sa Majesté, au Parlement, « premier club de gentlemen du royaume », dans son ambassade, au milieu des congrès européens, au cours des bals et des chasses à courre, que sous la tente ou au fort des combats, parfait échantillon des qualités solides et brillantes « encore qu’un peu bizarres » que l’Angleterre au cours des siècles sait trouver en ses meilleurs serviteurs. ♦