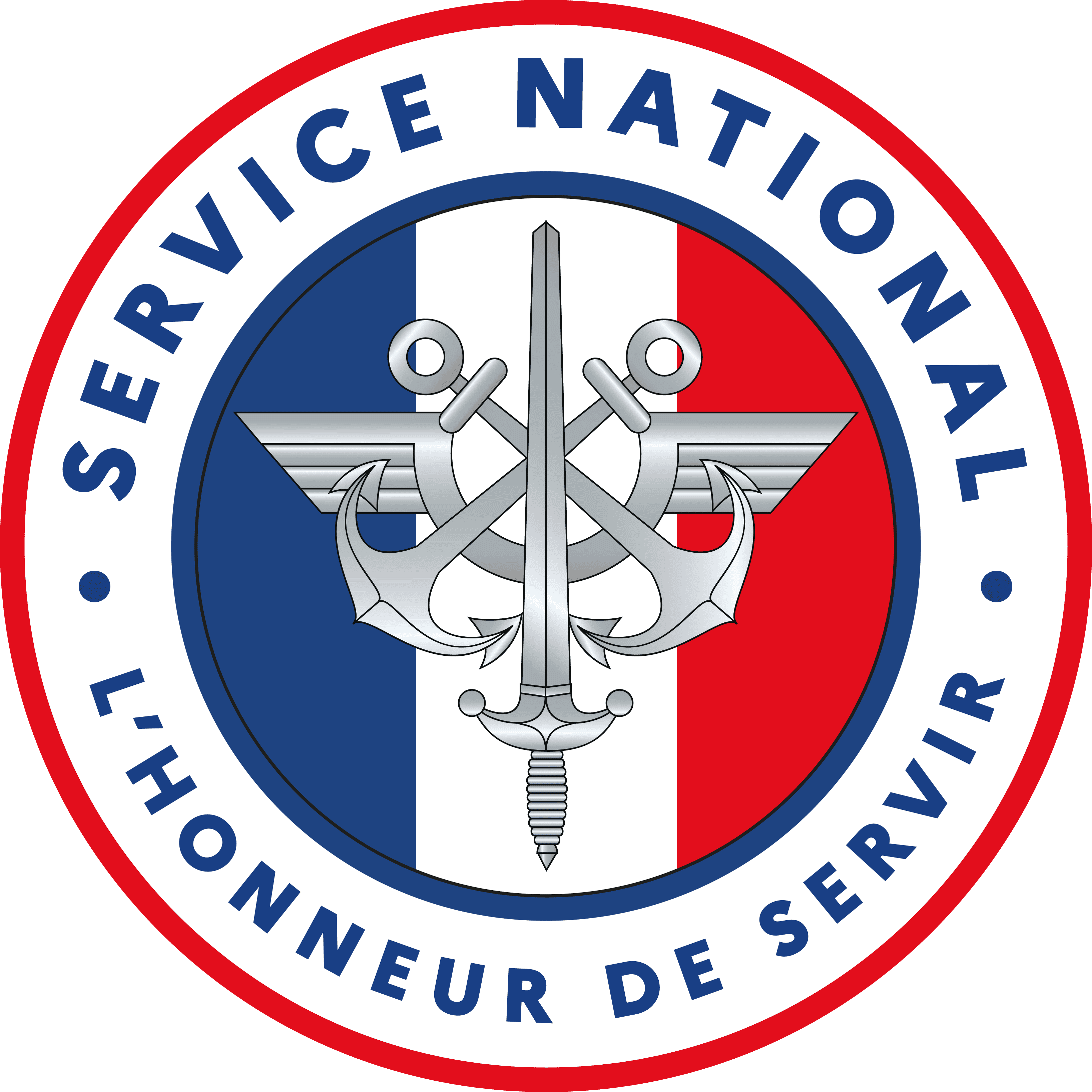L’Éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle
De même que les progrès de la science économique ont favorisé l’essor de l’histoire économique, de même les acquis de la sociologie de l’éducation ont inspiré les recherches de trois universitaires qui livrent ainsi le fruit de leur travail sur l’éducation en France pendant les derniers siècles de l’Ancien Régime.
Ce qui frappe d’emblée, c’est que l’école est par définition « confessionnelle ». À l’époque de la Réforme protestante et catholique, le maître est autant agent de christianisation que dispensateur de connaissances. Cependant, dans les campagnes, il n’y a pas autant d’écoles que de paroisses : les habitants, à qui revient la charge de payer le maître, rechignent souvent à laisser leurs enfants en classe pendant les gros travaux agricoles, a fortiori pendant les crises frumentaires. Les villes plus favorisées ont plusieurs types d’école mais les plus originales sont sans conteste les fameuses « écoles de charité », établies par les réformateurs scolaires (Charles Démia et Jean-Baptiste de La Salle). On connaît assez bien la façon dont les enfants étaient scolarisés : groupés en classes différentes, ce qui est nouveau, ils recevaient des rudiments d’instruction tout en apprenant à vivre en société à une époque où les curés de leur côté s’efforçaient de discipliner leurs ouailles pendant les offices religieux. Ces tentatives de scolarisation massive menées sous l’égide de l’Église ne vont pas sans résistances, d’abord de la part des nouveaux convertis, après 1685, et ensuite des élites politiques et intellectuelles qui aux XVIIe et XVIIIe siècles craignent un dépeuplement des campagnes et un abandon des tâches « mécaniques ». Leur crainte était vaine puisqu’à la veille de la Révolution, deux couples sur trois ne savent pas signer devant le curé leur acte de mariage.
L’éducation « secondaire » et « supérieure » est encore plus diverse et sélective. Les grands collèges, aux mains des congrégations, accueillent à peine 50 000 élèves au XVIIIe siècle, et les plus prestigieux (La Flèche, Juilly) sont réservés à l’élite. Les collèges visent à former des clercs et des notables : l’instruction dispensée met l’accent sur la maîtrise du raisonnement, de la parole et du geste, qualités nécessaires pour se distinguer, du haut de la chaire, dans les conseils et les tribunaux. Du reste, l’université forme surtout des théologiens et des juristes. Déjà, Paris reçoit ceux qui se destinent aux plus hautes fonctions, tandis qu’en province les étudiants ne peuvent espérer que des emplois locaux. Les structures traditionnelles répondent donc incomplètement aux besoins de la société. L’instruction pratique est, à quelques cas près, inexistante et la formation sur le tas est la règle générale. Une minorité de filles, peut, en dehors du milieu familial, se préparer à bien paraître dans le monde. Le dauphin et quelques princes peuvent prétendre à une éducation préceptorale soignée, c’est bien le moins, en vue de leurs charges futures. Et enfin l’éducation de la noblesse est assurée pour beaucoup dans les Académies qui, au XVIIe siècle, préparent notamment au métier des armes. Richelieu et Mazarin tentent d’établir des collèges de nobles, pépinières de serviteurs de l’État monarchique. En fait les écoles militaires auront au XVIIIe siècle beaucoup plus de succès. Les besoins de l’armée ont été en effet un moteur du progrès éducatif, bien avant la fondation de l’École Polytechnique. L’itinéraire du jeune Bonaparte illustre l’excellence du système dont le programme résolument moderne a été élaboré par le Comte de Saint-Germain. Cet aspect novateur ne doit pas faire oublier que les structures scolaires de la France sont inadaptées à l’époque : après l’expulsion des Jésuites sous Louis XV, les milieux parlementaires échafaudent des projets destinés à uniformiser l’espace scolaire et à assurer le contrôle de l’État sur l’école. C’est dire qu’au moment où la Révolution se met en branle, l’école est en pleine mutation.
L’un des mérites de cet ouvrage est de bien poser les étapes et les limites d’une évolution triséculaire. Bien d’autres apparaissent à la lecture : l’étude des rouages éducatifs, l’analyse du recrutement des collèges et des universités, les progrès relatifs de l’alphabétisation montrent, s’il en était besoin, que la société d’Ancien Régime était profondément inégalitaire et que les méthodes d’éducation visaient en définitive à perpétuer le statu quo. Autre mérite, le recours fréquent aux statistiques, à la cartographie qui permettent d’affiner les analyses comparatives au niveau régional, voire local. La variété des sources utilisées, l’exploitation critique des données amènent des développements assez longs, parfois ardus mais toujours utiles. Ce livre qui accumule citations, chiffres et références est une bonne illustration de ces ouvrages d’universitaires qui ne cèdent jamais à la facilité. ♦