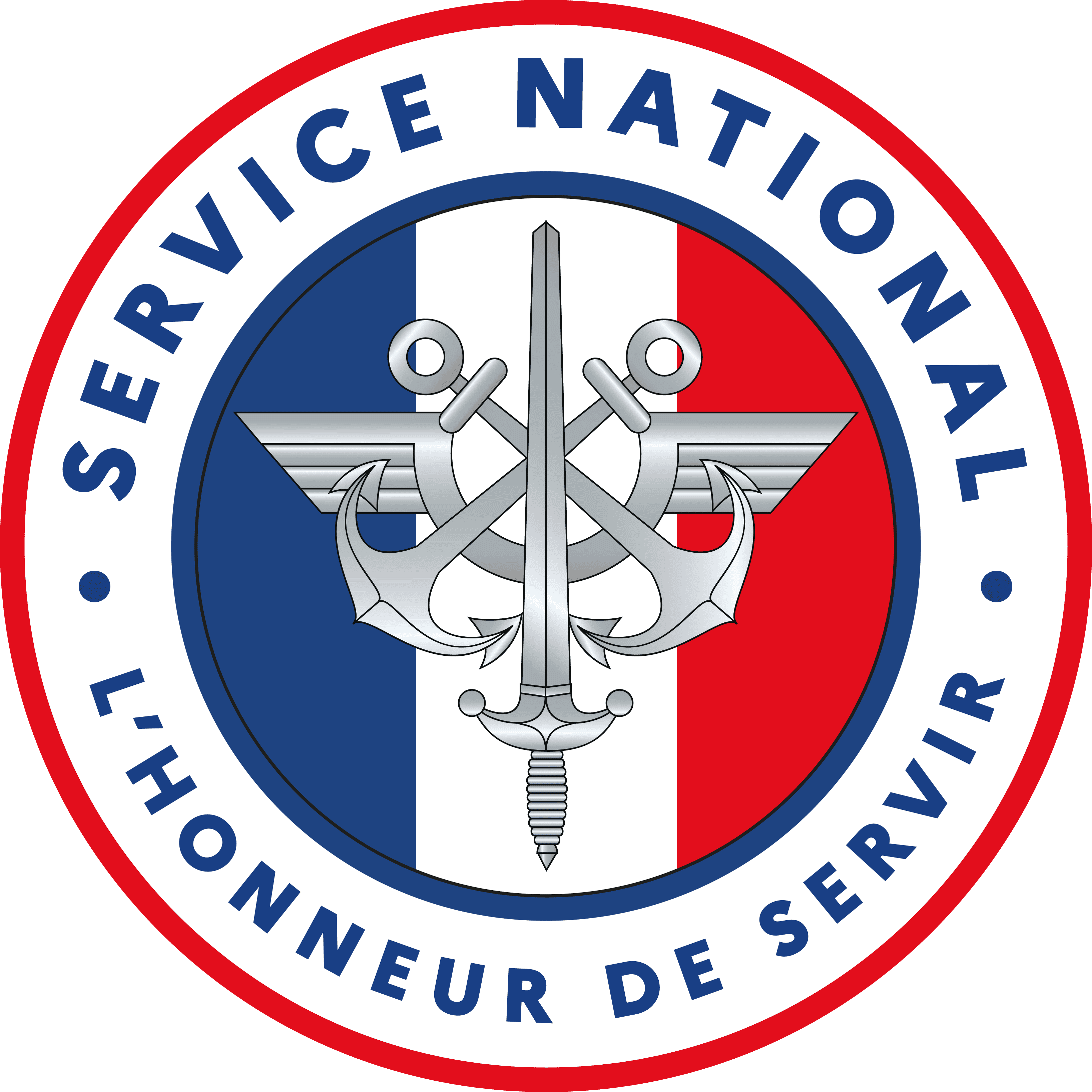Patton – Carnets secrets
Admiré par les militaires, quelque peu déconsidéré par les politiciens, le général Patton n’en est pas moins une figure légendaire de l’histoire. Sans en avoir les ambitions politiques, il aimait à se comparer à Napoléon et faisait de Pershing son maître.
Ses lettres, ses rapports et les extraits de son journal à partir de septembre 1940 nous permettent de suivre les grands moments de sa carrière et de retrouver les principaux traits de son caractère versatile.
Sa jeunesse, sa participation à la Première Guerre mondiale et les années passées à Fort Benning ne sont qu’évoquées. On le regrette un peu, car la connaissance de documents de cette première étape de sa carrière aurait permis de mieux appréhender le personnage, même si les années 1940-1945 sont celles de sa consécration effective.
Le général Patton apparaît comme un personnage violent et truculent tout à la fois, excessif, aimant la discipline par-dessus tout, alliant une certaine vulgarité et le goût de l’exhibitionnisme à un dévouement et une générosité extrêmes. Son instabilité était, selon certains, inhérente à son manque de confiance en lui-même et il attendait des autres le même effort de maîtrise de soi que celui pour lequel il luttait personnellement. Ainsi s’explique sa cruauté à l’égard de soldats incapables de surmonter, comme lui, l’épreuve nerveuse de la guerre. L’affaire des gifles, dont il frappa certains d’entre eux en Sicile, traduit cette incapacité de maîtriser sa colère face à ceux qui ne maîtrisent pas leur peur.
Son irascibilité est attribuée à la présence d’un hématome sous-dural. En dépit de ces défauts, c’était néanmoins un grand seigneur dans son métier, la guerre : « comparées à la guerre, toutes les autres activités humaines semblent futiles », disait-il, tout en reconnaissant qu’elle était une « sale besogne » : « Nous avons tué 5 000 Allemands et fait 30 000 prisonniers, c’est une vie magnifique, mais un peu poussiéreuse ».
Par ailleurs, si la mort des autres lui arrache parfois des paroles d’une grande froideur, la vue des blessés le touche davantage. Son insensibilité, ou sa maîtrise de soi, pouvait avoir des limites : « C’était un horrible spectacle auquel je ne me suis pas attardé, ne voulant pas que des sentiments personnels puissent par la suite m’empêcher d’envoyer des hommes au combat, ce qui serait particulièrement désastreux pour un général ». Et ailleurs : « Cela me rend malade de les regarder ».
Mais par-dessus tout c’est sa haute compétence professionnelle qui domine. Sa détermination personnelle, liée à une confiance illimitée, est les clefs de son succès. La mobilité, la surprise, la manœuvre, l’encerclement, la poursuite, sont ses principes : « La seule façon de gagner une guerre, c’est d’attaquer », et « Ne jamais se mesurer à la force de l’ennemi, mais à sa faiblesse ». Le soutien du moral des soldats par un contact personnel lui semble également primordial.
Il considère jalousement sa carrière. Il déclare par exemple en Sicile : « Les troupes ont besoin de sang : en outre ce serait meilleur pour ma carrière future ». L’ascension de Eisenhower et de Clark l’inquiète. Il est également jaloux des Anglais : « Nous nous faisons manœuvrer par les Anglais comme des enfants », dit-il à la conférence de Casablanca. Son orgueil paraît sans limites : « À la réflexion, qui me vaut ? Je ne vois personne ». Cette fierté, d’ailleurs, il l’applique à son pays : « Les États-Unis doivent remporter la victoire, non en tant qu’Alliés, mais en tant que conquérants à part entière » ; « Nous sommes les premiers soldats du monde ». Il tient en piètre estime les autres nations, alliées ou adversaires : il est convaincu de la « stupidité » de l’armée italienne et de l’« incapacité de se battre » des Français. Quant aux Russes, il admire leur discipline mais les traite de véritables sauvages, « que nous pourrions battre à plate couture » !
Ses opinions politiques contrastent en effet de plus en plus, à mesure que le conflit évolue, avec celles des « politiciens » qui mènent la guerre et que d’ailleurs il méprise. Son antisémitisme, puis son désaccord avec la politique de dénazification et le traitement infligé aux criminels de guerre font l’objet de nombreuses critiques publiques, tout comme autrefois sa violence à l’égard des soldats malades. Son seul souhait est de restaurer l’Allemagne en « État-tampon », se battre contre les Russes, « ces Mongols », puis en Chine. Il craint que toute l’Europe ne devienne communiste et il critique la politique du gouvernement américain en Bavière : « Si ce que nous sommes en train de faire est “liberté”, alors donnez-moi la mort ». Si l’avènement de la bombe atomique ne le surprend guère, il conteste cependant l’intelligence de « ceux qui veulent l’utiliser comme un moyen de rendre notre pays sans défense ».
L’accident d’automobile auquel il succombera en décembre 1945 atteint un homme déjà déçu par les lendemains politiques d’une guerre au succès de laquelle il a pris une part incontestable. La gloire qui l’entoure le flatte (« C’est très agréable d’être célèbre »), mais il n’est plus d’accord avec la politique du gouvernement américain et songe à la retraite. Sa femme, confidente éloignée et dévouée de tous ses soucis, recueillera à sa mort tous ces hommages et ces souvenirs, et contribuera à entretenir la mémoire de cet homme fait pour le métier de la guerre, ce qui lui valut, en dépit de ses énormes travers, d’être tant aimé de ses soldats. ♦