37 Quai d’Orsay - Diplomatie française 2012-2016
37 Quai d’Orsay - Diplomatie française 2012-2016
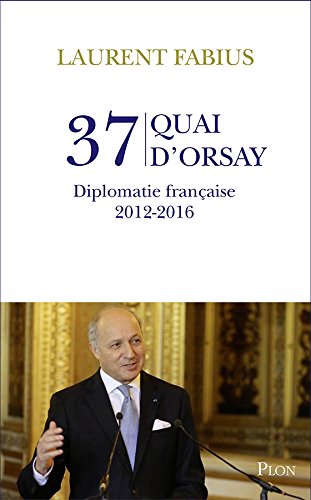 Ancien Premier ministre (1984-1986), Laurent Fabius a été, de mai 2012 à février 2016, ministre des Affaires étrangères de François Hollande qui l’a nommé, par la suite, président du Conseil constitutionnel. Il relate sur un ton relativement dépassionné dans un style clair, précis et percutant, ses quatre années passées au Quai d’Orsay, à la tête de la diplomatie française. Il dresse le bilan de son action et livre une réflexion globale sur les problèmes internationaux et les contributions que la France peut apporter à leurs résolutions.
Ancien Premier ministre (1984-1986), Laurent Fabius a été, de mai 2012 à février 2016, ministre des Affaires étrangères de François Hollande qui l’a nommé, par la suite, président du Conseil constitutionnel. Il relate sur un ton relativement dépassionné dans un style clair, précis et percutant, ses quatre années passées au Quai d’Orsay, à la tête de la diplomatie française. Il dresse le bilan de son action et livre une réflexion globale sur les problèmes internationaux et les contributions que la France peut apporter à leurs résolutions.
Il s’en explique d’emblée. « Ce livre évoque plusieurs aspects importants de la diplomatie française pendant la période où je l’ai conduite, de mai 2012 à février 2016. Sur le moment, je n’ai pas pris de notes : je n’en avais ni le temps ni le goût. Mais une fois quitté le “37 Quai d’Orsay”, je me suis dit – et d’autres avec moi – qu’il serait dommage que ne subsiste sur la politique extérieure de la France au cours de ces années aucun récit présenté par son principal responsable gouvernemental, avant que le temps ne vienne déformer ou effacer mes analyses et mes souvenirs. D’autant plus que ces quatre ans ont été riches en événements internationaux, heureux ou malheureux : l’accord mondial sur le changement climatique, les négociations sur le nucléaire iranien, la tragédie syrienne, les questions européennes. À travers ce récit qui mêle analyses de fond, portraits personnels et scènes prises sur le vif, je montre quel rôle la France a joué et comment j’ai dirigé le Quai d’Orsay, avec pour maître-mot : l’indépendance ». Ajoutons, c’est l’un de ses mérites, qu’il a contribué à l’évolution indispensable du Quai d’Orsay, le « Département » comme le nomment ses agents vers une « diplomatie globale » pour maintenir le prestige de la France dans le monde du XXIe siècle. À côté de la diplomatie stratégique et politique, il s’agit, d’après lui, de développer activement une diplomatie économique et culturelle : création d’une Direction des entreprises et de l’économie internationale au sein du ministère ; réorganisation des relations entre le Quai d’Orsay et Bercy ; aide au développement mondial ; promotion du tourisme français ; renforcement des médias français internationaux et de la francophonie ; « Nuit des idées » au Quai d’Orsay ; lancement d’une réflexion appelée MAEDI 21 (ministère des Affaires étrangères et du Développement international du XXIe siècle).
Parmi les succès de la diplomatie française figure au tout premier rang l’Accord de Paris sur le climat pour lequel il s’est investi et qui lui a laissé échapper de véritables larmes d’émotion. La notion de « communauté internationale » est plus souvent invoquée qu’appliquée. À cet égard, l’Accord de Paris sur le climat a constitué une heureuse et importante exception. Le 12 décembre 2015, le monde a en effet parlé d’une seule voix : 195 pays – 196 parties avec l’Union européenne – ont décidé de s’unir pour lutter contre le dérèglement climatique et faire entrer le monde dans le développement décarboné. La tâche était très complexe, non seulement en raison de la grande diversité des situations et des positions nationales mais aussi parce que ces sujets engagent l’avenir des pays pour des décennies. Dans son livre, il analyse comment nous sommes parvenus à ce succès et aborde la question de savoir si la méthode employée à Paris est reproductible à d’autres secteurs. Cette méthode, quelle est-elle ? La COP21 a permis l’émergence d’une forme nouvelle de multilatéralisme, qui n’a plus grand-chose à voir avec l’approche qui prévalait auparavant, par exemple lors du Congrès de Vienne en 1815, symbole de la diplomatie du XIXe siècle. L’Accord de Paris a été obtenu grâce à un multilatéralisme à la fois universel (la totalité des États se sont réunis), transparent (nous avons négocié sous le regard du monde), inclusif (chaque État a été non seulement entendu mais écouté), ouvert (puisque les acteurs non étatiques que sont les entreprises, les collectivités locales, les ONG, la société civile ont été associés et ont joué un rôle important dans la dynamique collective). Il insiste sur ce dernier point : face au défi global du dérèglement climatique, la construction d’alliances avec le secteur privé, la mobilisation des collectivités locales, celle des acteurs financiers, des chercheurs, des milieux académiques, des sociétés civiles, deviennent décisives pour les gouvernements nationaux. Cette méthode pourrait probablement être transposée à des domaines aussi essentiels que l’eau, la santé, l’accès aux données ou les migrations. Il paraît nécessaire de fonder dans plusieurs domaines les négociations internationales sur trois piliers, chacun d’eux renforçant les deux autres : un accord international, la collection des engagements volontaires des États, la construction d’alliances avec la société civile. De ce point de vue aussi, la Conférence de Paris a ouvert des horizons nouveaux. Même si beaucoup de ces avancées sont désormais suspendues à la décision américaine d’honorer ou au contraire d’abandonner les engagements pris avec le monde et pour le monde. Pourtant un point subsiste qui demanderait à être éclairci. Aux toutes dernières minutes de la négociation, l’accord a failli capoter, car le texte comportait disséminé un peu partout le verbe shall, signifiant « doivent », et non should, « devraient », seule formulation acceptable par les États-Unis afin d’éviter lors de la ratification de l’accord d’en avoir à passer par le Sénat où l’approbation n’allait pas de soi. Laurent Fabius, attribue cette méprise à une seule erreur matérielle, ce qui semble peu probable, tout négociateur rompu au vocabulaire onusien (comme l’auteur de cette recension) fait aisément la distinction. Néanmoins, il en conclut que l’Accord de Paris est « juridiquement contraignant », du moins autant qu’il peut l’être compte tenu des contraintes politiques. Merveille de l’ambiguïté diplomatique !
Il évoque bien entendu l’épisode malheureux d’août 2013 et explique pourquoi la volte-face américaine a eu des conséquences négatives non seulement sur la suite du conflit syrien mais sur l’ensemble de la situation régionale et internationale. En 2012, le président Obama, souhaitant montrer sa détermination, avait publiquement déclaré que si Bachar el-Assad utilisait des armes chimiques, cela constituerait une « ligne rouge » – ce furent ses termes – dont le franchissement conduirait les États-Unis à réagir militairement. Un an après, on apprenait que Bachar el-Assad a utilisé massivement des armes chimiques contre des civils dans la plaine de la Ghouta, en banlieue de Damas, causant près d’un millier de morts. Les services français ont vérifié immédiatement puis ont confirmé ce recours au chimique. La France s’est apprêtée à réagir par des frappes contre le régime syrien, afin de dissuader puis d’amener un Bachar affaibli à ce que le régime négocie vraiment. Mais le président Obama, quelques heures avant le déclenchement précisément planifié de l’opération, le 31 août, fait volte-face – en faisant valoir que nous ne pourrions pas bénéficier de l’appui unanime du Conseil de sécurité des Nations unies, en raison d’un probable veto russe. Ce renoncement permit à Bachar de continuer ses exactions, affaiblit l’opposition syrienne modérée et alimente le chaos. Ses conséquences ont dépassé le cadre syrien. Le chef de la diplomatie française en tire une grave conclusion qu’il appartiendra aux historiens de corroborer : l’irrésolution américaine d’août 2013 a influé sur la future position russe concernant l’Ukraine, la Crimée et d’autres territoires.
On trouve dans ce livre quelques anecdotes savoureuses. Durant les négociations de l’Accord Minsk II sur l’Ukraine, le 12 février 2015, Angela Merkel montre à Vladimir Poutine la photo d’un colonel russe présent dans les régions « rebelles » de l’Est de l’Ukraine. Et Poutine, du tac au tac de répondre : « Le colonel a probablement perdu son chemin ! ». Pourtant, il ne semble pas toujours apprécier l’humour incisif du maître du Kremlin, qui, à une remarque de François Hollande indiquant que la Russie avait des intérêts dans cette région, lui rétorque : « La Russie a des intérêts partout ! ». Doit-on y voir forcément une de ces « pulsions néo impériales » que l’on prête trop volontiers à la Russie et non plutôt une forme de fierté retrouvée, de réassurance de ce que la Russie est de nouveau écoutée et plus encore respectée. À propos de la crise ukrainienne, l’ancien chef du Quai d’Orsay passe très vite sur la venue des quatre ministres des Affaires étrangères, le 21 février 2014 ; il estime que leur présence a permis d’éviter ce qui aurait été probablement une véritable guerre civile, mais il ne mentionne pas du tout que cet accord conclu avec le président Ianoukovitch a été violemment rejeté par la rue, et que celui-ci a été contraint de quitter précipitamment le pays. Scénario instrumentalisé ou non – toute la vérité n’a pas été faite – que la Russie qualifie de coup d’État et qui est à la base de tout l’affrontement entre la Russie et les Occidentaux qui a suivi.
Se situant dans la fameuse ligne gaullo-mitterrandienne, chère à Hubert Védrine, Laurent Fabius s’explique sur l’indépendance qui a constitué le principe essentiel déterminant l’action extérieure, la vision de la France au cours des années 2012-2016. Elle est une composante majeure de notre identité sur la scène mondiale. Même à l’époque de la guerre froide où « l’ordre » international était fortement structuré, la France a veillé à ne pas être alignée, tout en restant solidaire de ses alliances. L’indépendance fait partie de notre histoire et de la vision que nous avons de notre propre rôle international. Aujourd’hui, c’est notamment cette indépendance qui fait que nous sommes une nation écoutée. Dans le monde mouvant qui sera celui des prochaines décennies, nous devrons plus que jamais préserver à la fois notre faculté de travailler avec les autres et notre autonomie. Certes, l’essor des pays émergents – dont certains, en réalité, ont déjà émergé – fera mécaniquement diminuer le poids démographique et économique de la France en termes relatifs. Pour autant, peu de pays possèdent notre capacité d’agir enn réseau mondial tout en conservant une indépendance d’analyse, de décision et d’action : cet alliage constitue un bien précieux. Nous sommes aussi l’un des rares pays à disposer de tous les attributs de la puissance et de l’influence qu’ils procurent : place dans les institutions internationales, attractivité, rayonnement économique, culturel et scientifique, rôle de nos principes, dissuasion nucléaire, capacités de défense et de projection militaire. L’indépendance n’est ni automatique ni acquise pour l’éternité, mais nous disposons d’atouts puissants pour protéger la nôtre dans le monde changeant et dangereux de demain. ♦






_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)

