Russie : vers une nouvelle guerre froide ?
Russie : vers une nouvelle guerre froide ?
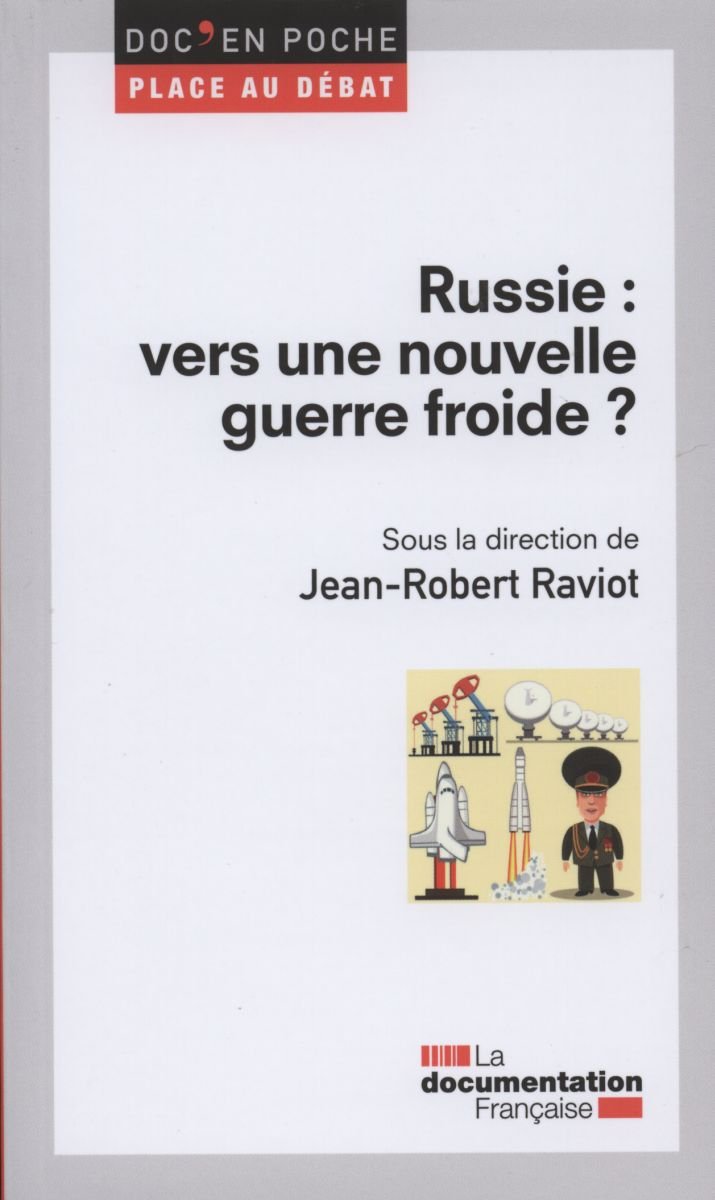 L’ouvrage ici présenté répond de façon indirecte à la question posée dans le titre en exposant en creux certaines des causes de la crise des rapports entre la Russie et les pays occidentaux. C’est en effet cette crise que le titre convoque et qui revient obstinément dans chacun des chapitres, aux thématiques pourtant bien distinctes. Le collectif d’auteurs choisit d’appuyer sa démarche sur des éclairages qui traitent de la « grande politique » (relations avec l’Occident depuis 1989, politiques menées dans le voisinage, redéploiement au Moyen-Orient) ou d’un volet particulier de la « nouvelle » puissance russe (cyber, soft power). Ils mettent ainsi en lumière les multiples sources de l’incompréhension et de la tension qui caractérisent les relations russo-occidentales.
L’ouvrage ici présenté répond de façon indirecte à la question posée dans le titre en exposant en creux certaines des causes de la crise des rapports entre la Russie et les pays occidentaux. C’est en effet cette crise que le titre convoque et qui revient obstinément dans chacun des chapitres, aux thématiques pourtant bien distinctes. Le collectif d’auteurs choisit d’appuyer sa démarche sur des éclairages qui traitent de la « grande politique » (relations avec l’Occident depuis 1989, politiques menées dans le voisinage, redéploiement au Moyen-Orient) ou d’un volet particulier de la « nouvelle » puissance russe (cyber, soft power). Ils mettent ainsi en lumière les multiples sources de l’incompréhension et de la tension qui caractérisent les relations russo-occidentales.
L’ouvrage insiste sur une divergence de fond entre Moscou et les pays occidentaux qui, probablement, a guidé le développement ultérieur de toutes les autres : les Russes estiment avoir subi un « refus des dirigeants occidentaux de mener avec eux un dialogue de fond sur l’architecture de la sécurité européenne » (p. 13). Le chapitre 1 épingle les lectures caricaturales faites par chacun des intentions de l’autre. Les auteurs déplorent en substance une certaine facilité du débat occidental sur la Russie quand ils soulignent que « l’hostilité de la Russie [est] systématiquement présentée comme le produit de l’installation d’un régime autoritaire en Russie » (p. 33), et suggèrent, selon une formule certes un peu tranchée, que « [le] retour de la volonté de puissance exprimée par les dirigeants russes et incarnée par Vladimir Poutine trouve son origine dans le tournant unilatéraliste de la politique extérieure américaine » (p. 36). Quant à la Russie, sa grille de lecture auto-centrée et excessivement axée sur « l’impérialisme américain », dont elle déplore l’incompétence (par exemple au Moyen-Orient, p. 114), lui fait sous-estimer certaines réalités, telles les évolutions du lien transatlantique post-guerre froide (p. 40).
D’autres enjeux sont venus alimenter la méfiance réciproque. Il en va ainsi de la difficulté manifeste qu’éprouve la Russie à se définir comme « post-Empire » (chapitre 3). Accepter pleinement la souveraineté des « nouveaux États indépendants » voisins constitue pour elle un exercice viscéralement délicat. En témoignent son jeu sur les conflits de minorités, sa tendance à user de leviers coercitifs et les erreurs considérables commises dans la relation avec l’Ukraine. Tout ceci rend complexe l’analyse de la stratégie des puissances occidentales vis-à-vis de ces mêmes pays : politique de sauvegarde de leur souveraineté ou politique de neo-containment de la Russie ? C’est évidemment dans ces derniers termes que celle-ci se représente les choses, même si le débat interne russe montre une plus grande propension à reconnaître certains échecs, notamment en Ukraine (p. 101). Le livre montre aussi combien il était illusoire d’escompter que la Russie s’éloignerait longtemps de ses « fondamentaux » en politique étrangère – la revendication d’une voix singulière et indépendante dans le jeu mondial appuyée sur « une forte volonté de puissance » (p. 19), ingrédients qui refont surface dès 1996 avec l’arrivée à la tête de la diplomatie russe d’Evgeniï Primakov. Celui-ci s’attachera, entre autres, à relancer la politique russe au Moyen-Orient, y portant – ici comme ailleurs – « une voix dissonante de celle de l’Occident » (p. 111).
Heureusement, montre l’ouvrage, le débat critique qui existe de part et d’autre permet d’espérer qu’il est encore possible d’éviter les pièges d’un débat sur-idéologisé. Pour l’instant, les perceptions mutuelles dégradées, porteuses de « deux grands récits » irréconciliables (p. 178), appuient fortement la rhétorique officielle russe articulée autour du triptyque « puissance, victoire et survie » (p. 53), s’ajoutant aux autres « ressorts essentiellement négatifs – suspicion, désillusion et peur du lendemain » qui fondent l’allégeance au pouvoir en place : ainsi, « la majorité de la société russe accepte une domination politique qu’elle juge, faute de mieux, la moins inadéquate » (p. 68). On peut se demander s’il s’agit là d’un des facteurs de la stabilité de la popularité de Vladimir Poutine, dont les auteurs rappellent qu’elle est visiblement « indépendante de la situation socio-économique » (p. 56). En tout état de cause, le « poutinisme » influence la place de la Russie dans le monde dans le sens où « Vladimir Poutine et son “directoire” s’imposent comme les seuls interlocuteurs, et ce dans tous les domaines, vis-à-vis de tous les partenaires extérieurs », contrôlant « tous les leviers que la Russie peut utiliser pour négocier sa place dans le monde globalisé » (p. 62-63).
Ainsi, l’ouvrage ne rejette pas l’idée d’un lien direct entre la nature du pouvoir en place en Russie d’une part et, d’autre part, la teneur de la politique extérieure russe et la situation internationale. Le chapitre 2 tente d’expliquer, dans une analyse assez fine, le « poutinisme » – « un système politique plébiscitaire où prime un exécutif fort contrôlant les principaux leviers du pouvoir » mais « également une idéologie politique populiste et conservatrice » (p. 51), un « populisme d’État » qui voit le Président « se dissocier de la politique du gouvernement et… se poser en rempart des intérêts du peuple contre les élites » (p. 58). On peut se demander si le fait que, comme le mentionnent les auteurs, cette idéologie trouve à rayonner de manière « limitée mais bien réelle » (p. 51) en Europe et en Amérique du Nord (avec l’appui de l’action des médias russes en langues étrangères) ne contribue pas à la tension Russie-Occident en révélant les vulnérabilités des sociétés occidentales. Des vulnérabilités sur lesquelles le Kremlin ne se prive pas d’insister pour étayer son idée que le monde aborde désormais un moment « post-occidental ». Cela ne fait probablement, par ricochet, que nourrir la tendance à la diabolisation de la Russie assez répandue dans le débat public en Occident. En tout état de cause, aujourd’hui, « la “question démocratique” est un enjeu majeur de la guerre de l’information » (p. 63). Sur ces enjeux, comme au travers de ses actions offensives dans l’espace numérique et dans ses médias en langues étrangères (chapitres 5 et 6), l’objectif de Moscou est sans doute d’obtenir un « impact psychologique » (p. 145) par la dramatisation et la confusion.
La revendication par la Russie d’une voix indépendante dans le jeu mondial s’illustre directement dans certains des leviers de la puissance dans lesquels (au-delà du seul facteur militaire) elle s’est investie massivement – cyberespace, soft power. Dans le cyber-espace s’expriment pleinement son rejet de « l’hégémonie occidentale » (elle échappe à « la mainmise du GAFA » ; p. 137) et son aspiration à défendre sa souveraineté « comme valeur cardinale de la vie internationale » (p. 132), ce qui passe par le contrôle des États sur le Net (p. 137). Ce chapitre 5 explique aussi que, dans ce champ comme dans d’autres, les Russes et les Occidentaux ne se comprennent pas. Leurs conceptions de la sécurité du cyberespace divergent « sensiblement » du fait de leurs « visions radicalement différentes du monde numérique » (p. 131), dont la Russie a fait un vecteur important de son influence dans l’espace post-soviétique (au travers du Runet, dont l’histoire singulière est retracée, expliquant bien que son existence ne doit pas, loin s’en faut, qu’à des considérations politiques).
Dans beaucoup des thèmes traités, l’on perçoit aussi en creux que la Russie, tout en se sentant soumise à une forte pression extérieure et en déplorant la mauvaise image d’elle qui est véhiculée dans les médias étrangers, notamment occidentaux, cherche à « entretenir… la réalité d’une certaine menace, du moins d’une capacité de nuisance de la Russie – venant en appui de stratégies politiques et diplomatiques » (p. 147). Cela est-il compatible avec les finalités du soft power (chapitre 6) que la Russie essaie de mettre en œuvre depuis le milieu des années 2000 – un « soft power d’État » qui cherche à « mieux intégrer la Russie dans la globalisation en remodelant son image » dans une « dynamique concurrentielle à l’égard de l’Occident et dans une logique de ralliement des publics étrangers aux positions et aux valeurs défendues par l’État russe » (p. 152-153), et à renforcer son influence dans l’ex-URSS de manière prioritaire via la fidélisation de la diaspora ? Peut-être que oui, puisque cette miagkaïa sila (soft power) vise en définitive, depuis 2013, davantage « à sanctuariser l’influence de la Russie qu’à optimiser son potentiel d’attraction » (p. 172).
On appréciera les repères pédagogiques et souvent originaux proposés dans les encadrés qui émaillent ce travail rédigé avec clarté. L’ouvrage, dont la bibliographie et les nombreuses citations sortent des sentiers battus (les auteurs ne craignant pas de regarder l’altérité russe en face), met en valeur des chercheurs confirmés et des talents montants qui représentent un paysage de la recherche française sur la Russie plus dynamique et diversifié qu’il n’y paraît. ♦







