Les Vainqueurs - Comment la France a gagné la Grande Guerre
Les Vainqueurs - Comment la France a gagné la Grande Guerre
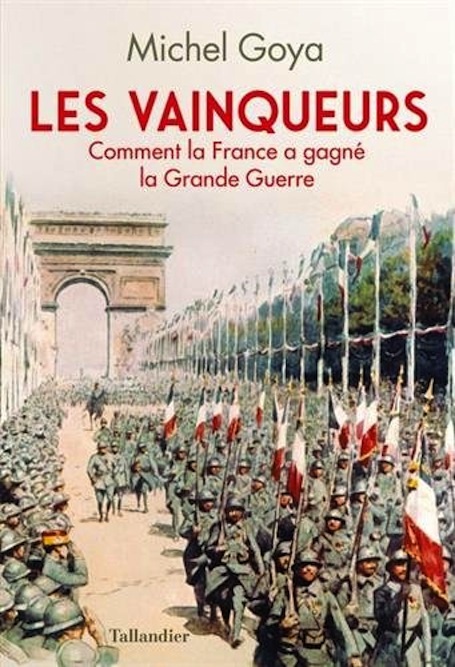 Face à une historiographie anglo-saxonne dominante, qui fait la part belle à la contribution de l’armée britannique, puis de l’armée américaine, lesquelles se seraient substituées à une armée française épuisée par les épreuves, il était nécessaire de redonner aux événements de 1918 leur juste appréciation. L’intention du colonel Goya dans Les vainqueurs est ainsi de « décrire la contribution réelle de l’armée française dans la victoire », grâce à « une analyse des tactiques, un champ largement négligé en France jusque-là, une description de la manière dont les combats sont conjugués en opérations, un autre aspect si peu décrit en France, et les effets stratégiques enfin de ces opérations ».
Face à une historiographie anglo-saxonne dominante, qui fait la part belle à la contribution de l’armée britannique, puis de l’armée américaine, lesquelles se seraient substituées à une armée française épuisée par les épreuves, il était nécessaire de redonner aux événements de 1918 leur juste appréciation. L’intention du colonel Goya dans Les vainqueurs est ainsi de « décrire la contribution réelle de l’armée française dans la victoire », grâce à « une analyse des tactiques, un champ largement négligé en France jusque-là, une description de la manière dont les combats sont conjugués en opérations, un autre aspect si peu décrit en France, et les effets stratégiques enfin de ces opérations ».
En 1914, l’armée française part en guerre en pantalon rouge et capotes bleues. Elle combat encore trop souvent en ordre serré face à un adversaire qui la surclasse en artillerie lourde et en mitrailleuses. Malgré tout, ses chefs tireront très vite les conclusions de ses échecs initiaux et l’armée se transformera en profondeur. C’est précisément cette transformation qui fit l’objet en 2004 de La chair et l’acier, sous-titré fort pertinemment L’invention de la guerre moderne, le premier livre du colonel Goya. Près de quinze années après, l’auteur revient sur cette année 1918, point culminant de cet effort humain sans équivalent.
Quelles sont donc ces transformations qui ont conduit l’armée française à la victoire ? La plus urgente consista en la création d’une puissante artillerie lourde. Celle-ci fut adossée à un système de réglage perfectionné dans le cadre de la « préparation scientifique des tirs ». Ces innovations, formalisées dans l’Instruction du 19 novembre 1917 sur le tir de l’artillerie, permettaient d’effectuer des tirs précis d’emblée, même de nuit ou par mauvais temps. À la fin de la guerre, nous rappelle Goya, équipée désormais de matériels modernes et puissants, et « avec un effectif qui se rapproche de celui de l’infanterie, l’artillerie française attire la majorité des ressources financières, industrielles, techniques et logistiques du pays ». Mais l’arme qui a connu le développement le plus spectaculaire fut toutefois l’aviation.
En 1914, la France n’avait que 134 appareils en ligne ; en novembre 1918, elle dispose de la plus puissante aviation du monde avec 3 600 avions. Sous l’égide du général Duval, nommé chef de l’aéronautique aux armées en août 1917, près de 25 000 appareils sont construits dans les dix derniers mois de 1918, soit plus que depuis le début de la guerre ! La France a ainsi pu fournir 10 000 appareils à ses alliés, dont 4 000 aux Américains. La mission d’observation-réglage d’artillerie se développe rapidement avec la fixation du front et grâce à ces deux innovations majeures que sont la TSF et la photographie embarquée. Après des débuts plutôt laborieux, la chasse et l’artillerie antiaérienne, deviennent vite indispensables. Avec 400 pièces, cette dernière abat autant d’avions allemands en 1918 que pendant toutes les années précédentes. Malgré tout, nous rappelle le colonel Goya, « le phénomène tactique le plus nouveau et le plus important de la période est l’engagement en masse des chars » du côté allié. Fin septembre 1918, l’armée française dispose déjà de 21 bataillons de chars légers. Un tiers de tous les engagements de chars français survient dans les quarante-cinq derniers jours de combat. Les chars restent cependant des engins fragiles au rayon d’action limité, même si leur durée moyenne d’emploi a doublé depuis le mois de juillet… passant de un à deux jours !
Toujours sur le plan tactique, on peut noter un effort exceptionnel dans le domaine de la mobilité. Ainsi, le service automobile français passe de 9 000 véhicules en 1914 à 88 000 en 1918, contre à peine 40 000 en Allemagne à la même époque. À la fin de la guerre, la « réserve générale d’artillerie », créée en janvier 1918 et confiée au général Buat, disposera de 584 batteries automobiles. De même, l’organisation des unités élémentaires se rapproche peu à peu de ce que nous connaissons aujourd’hui, avec des unités plus petites mais dotées d’une puissance de feu bien plus importante. La section à trois groupes de combat fait son apparition. L’armée française de 1918 est alors la plus moderne du monde. Beaucoup d’armées alliées sont d’ailleurs équipées par la France (les armées belge, roumaine, serbe, grecque et américaine surtout). « L’arsenal des nations, c’est alors la France », peut écrire Goya.
Face aux trois offensives de Ludendorff, analysées en détail dans le livre, c’est à chaque fois l’armée française qui sauve la situation « grâce à ses hommes, toujours moins nombreux mais solides, aux équipements modernes et multiples que donne l’industrie et à une nouvelle génération de chefs excellents, les Fayolle, Maistre, Debeney, Gouraud, Degoutte, entre autres ». Contrairement à ce que prétend l’historiographie anglo-saxonne, l’armée américaine n’est encore qu’« une collection de divisions dont seule l’ardeur des combattants compense l’inexpérience… Elle n’organise ses propres opérations, encore avec maladresse, qu’à partir de septembre 1918 ». Ainsi, la réduction du saillant de Saint-Mihiel, les 11 et 12 septembre 1918, représente le premier engagement d’importance du corps expéditionnaire américain. Cet événement est souvent monté en épingle par certains commentateurs pour démontrer le caractère décisif qu’aurait eu l’action des troupes américaines. Michel Goya relativise quelque peu cette assertion en montrant notamment que 80 % des chars, avions et canons qu’utilisent les Américains ont été fournis par les Français, souvent avec leurs servants ou leurs équipages. La France donne également deux états-majors d’artillerie de corps d’armée. L’opération est donc loin d’être une opération purement américaine comme on le lit souvent et ce, d’autant plus que les plans initiaux prévoient l’engagement de dix divisions françaises aux côtés des quatorze divisions américaines. En outre, l’attaque a surpris des forces allemandes affaiblies et en plein repli. Il est donc difficile d’en tirer des leçons en considérant de plus que l’armée américaine a connu pendant l’action quelques graves problèmes de coordination.
Les grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale sont donc, finalement, et avant tout, les soldats français. Cent ans après, cette leçon semblait quelque peu oubliée. Il convenait de la rappeler et c’est tout le mérite du livre du colonel Michel Goya. Ce n’est pas, loin de là, son seul mérite, car il présente l’immense avantage sur le reste de la littérature historique publiée à l’occasion du centenaire de la victoire de porter la marque du spécialiste de l’histoire des tactiques, depuis La chair et l’acier en 2004, jusqu’à Sous le feu en 2015, en passant par ses analyses des guerres d’Irak et de la guerre israélienne contre le Hezbollah de 2006. Cet éclairage unique confère aux Vainqueurs le statut d’un ouvrage de référence sur la dernière année de la Première Guerre mondiale, tout en en rendant la lecture passionnante.
Un dernier chapitre projette dans l’avenir l’armée française de 1918, armée victorieuse qui cessera d’évoluer. En mars 1936, au moment de la réoccupation de la Rhénanie par l’Allemagne, le général Gamelin, chef d’état-major interarmées avoue ainsi au gouvernement son incapacité d’agir militairement avant que ne soient mobilisés 1,2 million d’hommes. Goya conclut : « L’armée la plus mobile du monde en 1918 est devenue immobile moins de vingt ans plus tard. » ♦






_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)

