Histoire de la CIA - Les fantômes de Langley
Histoire de la CIA - Les fantômes de Langley
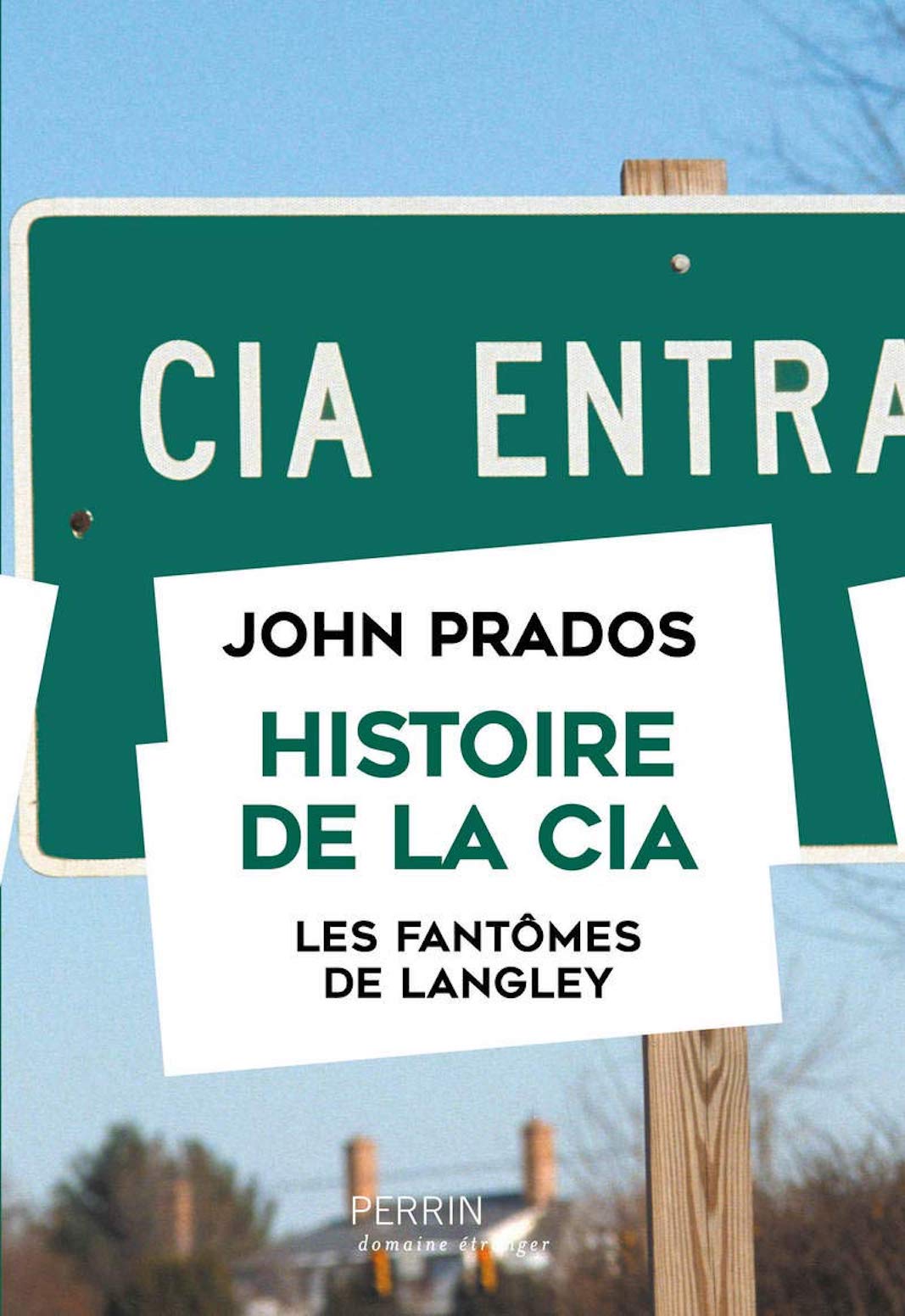 L’ambition affichée par John Prados dans son dernier livre était de nous expliquer comment une organisation créée de bric et de broc en 1947 à partir de divers services de renseignement américains (OSS, National Intelligence Authority, Central Intelligence Group), hébergée jusqu’en 1962 dans des préfabriqués insalubres dans le parc du Lincoln Memorial à Washington, en est venue à jouer un rôle si important dans les affaires du monde, notamment par ses opérations de changement de régime. Malheureusement, malgré l’évocation d’un certain nombre d’opérations emblématiques (de la Pologne à la Hongrie de 1956, en passant par l’Indochine, l’Iran, les Contras, sans oublier la baie des Cochons, les activités de propagande de Radio Free Europe et la lutte contre le terrorisme) le lecteur en restera quelque peu sur sa faim.
L’ambition affichée par John Prados dans son dernier livre était de nous expliquer comment une organisation créée de bric et de broc en 1947 à partir de divers services de renseignement américains (OSS, National Intelligence Authority, Central Intelligence Group), hébergée jusqu’en 1962 dans des préfabriqués insalubres dans le parc du Lincoln Memorial à Washington, en est venue à jouer un rôle si important dans les affaires du monde, notamment par ses opérations de changement de régime. Malheureusement, malgré l’évocation d’un certain nombre d’opérations emblématiques (de la Pologne à la Hongrie de 1956, en passant par l’Indochine, l’Iran, les Contras, sans oublier la baie des Cochons, les activités de propagande de Radio Free Europe et la lutte contre le terrorisme) le lecteur en restera quelque peu sur sa faim.
Prados, en effet, auteur de nombreux ouvrages sur ce même sujet et spécialiste attitré de cette institution, a choisi de mettre l’accent cette fois-ci sur le personnel de l’Agence, et sur son organisation interne (quelques organigrammes auraient d’ailleurs été les bienvenus pour mieux en cerner la structure), plutôt que sur le déroulement de ses opérations extérieures. Cela explique le caractère non chronologique du plan, s’appuyant sur quelques grandes figures de l’organisation (Allen Dulles, Helms, Gates, Tenet…) et sur quelques thèmes transversaux (le rôle de la direction juridique, les rapports avec le Congrès, la recherche de la parité hommes/femmes…) ou conjoncturels (la torture dans les prisons secrètes de la CIA après le 11 septembre 2001).
Lorsqu’il évoque malgré tout quelques opérations secrètes, l’auteur reste souvent évasif et ne nous livre finalement que peu de révélations. Ainsi, lorsqu’il mentionne incidemment, au détour d’une phrase, un « programme de contrôle mental » ayant causé des décès, mais ne s’y appesantit pas. De même, lorsque Prados évoque l’affaire des « prisons de la CIA » après le 11 septembre, sans préciser leurs localisations, alors qu’il s’agit depuis quelques années d’un secret de polichinelle. L’auteur semble parfois louvoyer afin d’éviter de donner au lecteur trop de précisions. On apprendra malgré tout que 5 % des fonds versés par les pays européens dans le cadre du plan Marshall furent reversés à la CIA pour financer les activités de cette organisation dans ces mêmes pays. Pour le reste, la plupart des affaires évoquées sont déjà connues du grand public.
Un grand nombre de ces opérations secrètes se terminent d’ailleurs par un fiasco où l’image de l’Agence est loin de sortir grandie. On pense évidemment à l’invasion manquée de Cuba (échec du débarquement de la baie des Cochons en avril 1961), mais aussi à l’affaire « Iran-Contras » qui consistait à vendre des armes à l’Iran pour financer une opposition armée contre les Sandinistes alors au pouvoir au Nicaragua. On y découvre également une organisation dont les langues étrangères ne sont décidément pas le point fort (lorsque les événements de 1956 éclatent, l’Agence parvient à grand-peine à réunir une équipe de sept agents parlant hongrois ; le même problème surviendra dans les années 1990 en ex-Yougoslavie), ce qui n’empêchera pas la CIA de fournir des armes aux rebelles kosovars en 1999.
L’ouvrage se garde d’évoquer des événements trop contemporains et ne dépasse guère la seconde partie des années 2000, mentionnant toutefois que les analyses de la CIA « contribueront à l’invasion désastreuse de l’Irak, en produisant des données visant à plaire à ceux qui les demandent. » Le rôle éventuel de la CIA dans les révoltes du Printemps arabe est ainsi ignoré.
John Prados préfère nous relater comment l’Agence, au fil du temps, « a résisté au contrôle de l’Administration et du Congrès avant de s’y soustraire totalement », d’où les chapitres consacrés aux différents directeurs juridiques de la CIA et à leur action. Pour certains dirigeants de l’Agence, avoue Prados, le terme même de « Direction juridique » de la CIA est d’ailleurs un oxymore : « Le but premier de la direction juridique consiste à faire en sorte que la CIA opère en dehors de tout cadre juridique. » Casey, l’un des anciens directeurs de la CIA disait ainsi souvent à son directeur juridique : « Ne me dites pas que ce n’est pas légal, trouvez-moi un moyen légal de le faire. »
On retiendra de ce gros ouvrage quelques points saillants. Le premier est cette compétition interne que connaît la CIA, tout au long de son histoire, entre ses deux activités principales : le renseignement et les opérations clandestines. Le deuxième est la notion de « déni plausible » qui régit les relations entre l’Agence et le président des États-Unis : « Contrairement à une idée très répandue, la CIA ne chasse jamais pour son propre compte… Tout est la conséquence directe de l’idée que se font certaines personnes de l’Agence de ce que désire le Président (et qu’il ne peut exprimer clairement) »… Car « rien ne doit jamais pouvoir attester du fait que le Président a eu connaissance des détails d’une opération ». En honnête homme, Prados s’offusque ainsi en permanence du fait que les dirigeants de la CIA se permettent de mentir devant les commissions parlementaires qui les auditionnent régulièrement. Cela nous conduit au troisième apport du livre, certainement le plus intéressant, l’analyse des relations entre la CIA et la Maison-Blanche.
Restent finalement, au fil des pages, quelques interrogations lancinantes exprimées par l’auteur. Ainsi, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme : « La situation actuelle est des plus étranges : malgré le nombre d’organisations terroristes démantelées et d’individus capturés ou tués, les agences de renseignement continuent de soutenir que le niveau de menace est haut, voire qu’il s’élève. Mais est-ce véritablement le cas ? »
En conclusion, cet ouvrage constitue une bonne introduction à l’histoire de la Central Intelligence Agency pour les non-spécialistes, même s’il semble avoir été écrit plus pour un public américain que pour le reste du monde, et pâtit d’une traduction parfois un peu rapide (le President’s Chief of Staff n’est pas un « chef d’état-major présidentiel », mais simplement le « chef de cabinet » de la présidence !). ♦







