La Guerre du Pacifique a commencé en Indochine : 1940-1941
La Guerre du Pacifique a commencé en Indochine : 1940-1941
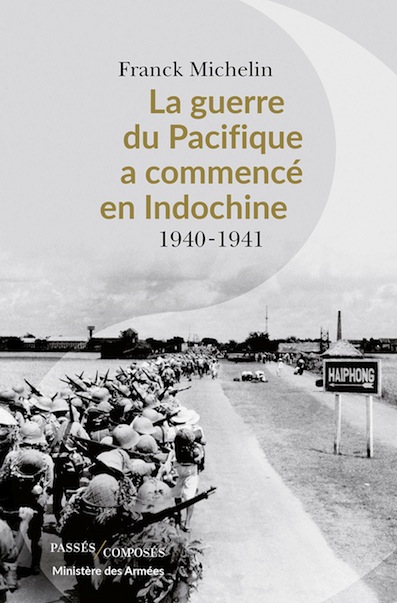 M. Franck Michelin offre une histoire complète des premiers conflits dans l’Indochine française sur le point de passer à l’heure japonaise. Elle couvre les mois séparant la défaite de la métropole en 1940 et l’orée de la guerre dans le Pacifique. Elle est féconde, enrichie de sources japonaises raisonnées, et dit comment l’occupation du sud de l’Indochine, en juillet 1941, fut pour l’empire japonais un point de non-retour, alors qu’une insoluble crise interne lui avait fait choisir le camp des pays totalitaires auprès desquels se noua une alliance fatale. Un mouvement expansionniste débordant de la guerre de Chine affirma son ardeur et, entre les dirigeants japonais, des factions rivalisèrent pour en prendre la tête. L’auteur dit que c’est à l’occasion de la stratégie choisie pour l’Indochine et à mesure que la guerre du Pacifique approchait qu’une réunion se fit en haut de l’État dans la voie de l’évolution totalitaire que l’on sait, pour que finalement l’empire japonais fédère une partie de l’Asie. Dans les faits que rapporte avec soin cet ouvrage, il y a d’abord un coup-de-poing sur la frontière (une frontière internationale surveillée par toutes les nations : l’Armée impériale s’en repentira) puis le stationnement de forces en Indochine du Sud (alors on voit nettement la fatalité de la guerre).
M. Franck Michelin offre une histoire complète des premiers conflits dans l’Indochine française sur le point de passer à l’heure japonaise. Elle couvre les mois séparant la défaite de la métropole en 1940 et l’orée de la guerre dans le Pacifique. Elle est féconde, enrichie de sources japonaises raisonnées, et dit comment l’occupation du sud de l’Indochine, en juillet 1941, fut pour l’empire japonais un point de non-retour, alors qu’une insoluble crise interne lui avait fait choisir le camp des pays totalitaires auprès desquels se noua une alliance fatale. Un mouvement expansionniste débordant de la guerre de Chine affirma son ardeur et, entre les dirigeants japonais, des factions rivalisèrent pour en prendre la tête. L’auteur dit que c’est à l’occasion de la stratégie choisie pour l’Indochine et à mesure que la guerre du Pacifique approchait qu’une réunion se fit en haut de l’État dans la voie de l’évolution totalitaire que l’on sait, pour que finalement l’empire japonais fédère une partie de l’Asie. Dans les faits que rapporte avec soin cet ouvrage, il y a d’abord un coup-de-poing sur la frontière (une frontière internationale surveillée par toutes les nations : l’Armée impériale s’en repentira) puis le stationnement de forces en Indochine du Sud (alors on voit nettement la fatalité de la guerre).
Le gouvernement japonais fit ajouter sa signature au Pacte tripartite à Berlin, le 27 septembre 1940. L’Armée japonaise avait le virus, mais dans la Marine impériale le trio dirigeant (1) renâclait. Le ministre de la Marine, l’amiral Yoshida Zengo (2), a démissionné. Au même moment on devait arriver à convenir avec les Français du passage par l’Indochine d’une armée japonaise en mauvaise position au Guangxi (guerroyer avec Chiang Kai-shek à partir du sud de la Chine était vain), et d’ailleurs fort incommodée par les guérillas. Un groupe d’activistes de l’état-major général des armées (EMGA) conspira pour faire occuper le Tonkin, tout simplement. Depuis Nanning, Satô Kenryô administra la bavure, mais la Marine impériale enraya cette opération. L’état-major fut confondu par la preuve que des corps avaient eu en main des ordres sans date. Cet événement figure dans les livres d’histoire des collèges japonais qui citent incontinent un télégramme diplomatique du général Nishihara, de Hanoi, s’adressant à Tokyo et disant : « Le désordre qui se passe à l’EMG nous fait perdre la confiance des autres, et même la nôtre. »
Le tenno (l’empereur japonais) ordonna une purge qu’on ne devait pas oublier dans les forces armées. L’affaire fit que l’Indochine française resta pendant plus de quatre ans au régime des Affaires étrangères au lieu du régime d’occupation (les effectifs japonais envoyés au nord n’ont été pendant longtemps que ceux de la surveillance des transports vers la Chine, et l’Indochine vendit son riz au lieu de le voir réquisitionné). De son côté, l’Allemagne modérait le Japon, ce que l’auteur souligne. Les essais d’accords entre la Kriegsmarine et la Marine impériale ont ultérieurement fait voir que la première s’attendait que les marins japonais défendraient jusqu’au golfe Persique les raiders allemands porteurs de caoutchouc indochinois.
Le commentaire qu’on lit fait observer que l’armée japonaise de Nanning avait reçu deux ordres d’opérations contradictoires et pourtant frappés du même visa impérial. C’est hérétique et cela fut admis sans ressentiment. Nous-mêmes comprenons mal comment pouvait être vécu ce grand écart, sinon il fallait être dans une logique telle que celle-ci dont le tiers exclu est omis : 1- Il faut un accord à la frontière internationale pour que les troupes du Nord passent en règle. 2- Celui-ci est a priori caduc (bref, nous ne voulons pas dire la vérité quant à ce passage plutôt honteux). 3- Voici donc établie la règle : on passe sans accord. Ces entrechats logiques sont tout bonnement ceux du syllogisme d’Eugène Onéguine (3).
Une question qui demeure est celle du choix de mots « expansion au sud » au lieu du terme japonais « avancée au sud » (expression préférée des états-majors lorsqu’avant mars 1941 on y débattait de « ressources » et pas de « stationnement » ni d’occupation). Pendant les quatre années de débordements japonais en Asie du Sud-Est, il n’y a eu d’expansion à proprement parler qu’aux Philippines, à Bornéo et à Singapour. Entendue d’abord dans un emploi contingent, cette « avancée » devint un « pas en avant » en juin 1941 quand la conscience de l’alliance militaire avec l’Allemagne contraignit les Japonais à bouger de concert, mais en voulant éviter la guerre, car celle de Chine suffisait. Au milieu d’avril 1941, une information opportune de leur ambassade à Washington les leurra, disant que les États-Unis n’étaient pas prêts à combattre même si eux recouraient aux armes – pour satisfaire leurs besoins d’approvisionnements stratégiques en Asie du Sud (c’était le produit extravagant de la mission des missionnaires Drought et Walsh présumant d’une attitude des États-Unis invérifiable). L’amiral Maeda, envoyé en mission en Thaïlande, décida que Saigon était le lieu géométrique central le plus convenable pour l’opération de « ressources naturelles », mais recommanda de faire vite, car, si les Anglais renforçaient en hâte Singapour, les Japonais ne pourraient plus occuper aisément Saigon. Aux yeux de l’armée, intervenir en Sibérie aurait mieux convenu à la situation.
Quand, au début de mai, on connut à Tokyo le moment de l’attaque allemande en Europe, l’EMGA jugeait, lui, qu’attaquer Singapour était saugrenu et préconisa de laisser le dossier en attente. L’avancée de 1941 en Indochine se fit alors dans un beau désordre, rapporté par des officiers de l’état-major impérial : les jeunes officiers proallemands rechignaient à la marche au sud, comme si on les avait envoyés en récréation à la place du combat de Sibérie. L’avancée au sud a été le minimum minimorum qu’on pût faire pour complaire aux Allemands, de même que le plus petit dénominateur commun entre les armées de terre et de mer.
Dans ce livre, les épisodes viennent en séquence rapide et les analyses affluent. Les personnages ne sont peut-être pas tous exacts. Parmi les caractères hâtivement présentés et jugés, notons le Premier ministre Konoe et le général Sumita. Konoe n’était pas imbu des fascismes d’Europe : c’était un joueur, moderniste, mais indécis, avec un penchant pour les théories de salon (un homme de Cour à défauts mondains) (4). Le général Sumita (5), choisi comme chef de la mission permanente pour complaire à Decoux, l’avait fréquenté à Paris en 1936, étant chargé d’enquêter sur la reprise des relations diplomatiques de la France avec l’URSS. Quant à Sato Kenryo, nous ne pouvions pas voir en lui un de ces colonels impétueux que le Centre envoyait en mission sur les théâtres délicats tels qu’Hattori Takushiro et Tsuji Masanobu, mais plutôt un tacticien de bureau. Le tenno a été mis en scène à plusieurs reprises dans l’ouvrage. Il y paraît moins engagé que ce qu’on en fait d’habitude et parfois même réprobateur. ♦
Jean Esmein
(1) Les amiraux Inoue Shigeyoshi, Yonai Mitsumasa et Yamamoto Isoroku.
(2) Ministre d’une Marine qui refusait l’alliance avec l’Allemagne, il était cependant séduit par les arguments de l’armée de terre soutenant que l’alliance épargnerait la guerre au Japon : dans cet écartèlement il songeait au suicide.
(3) 1- Les amoureux sont seuls au monde. 2- Elle est avec un autre. 3- Je décide qu’elle m’aime (Et l’on voit le héros se conduire en amant absolu).
(4) Le 14 septembre 1939, la question de l’alliance militaire avec l’Allemagne était à l’ordre du jour de la « conférence de liaison » (ou comité de gouvernement restreint) ; le prince profondément dévoué au tenno a pourtant cédé aux réclamations de Matsuoka et Tojo. Il connut sa honte de retour au palais et un chambellan a rapporté comment, le 26 septembre, on dut appeler un médecin pour le prince parce qu’il était à demi évanoui sur un canapé.
(5) Le père du gouverneur de la Banque du Japon (1984-1989), dont on a remarqué la sympathie pour les Français.








