Sporadically Radical
Sporadically Radical
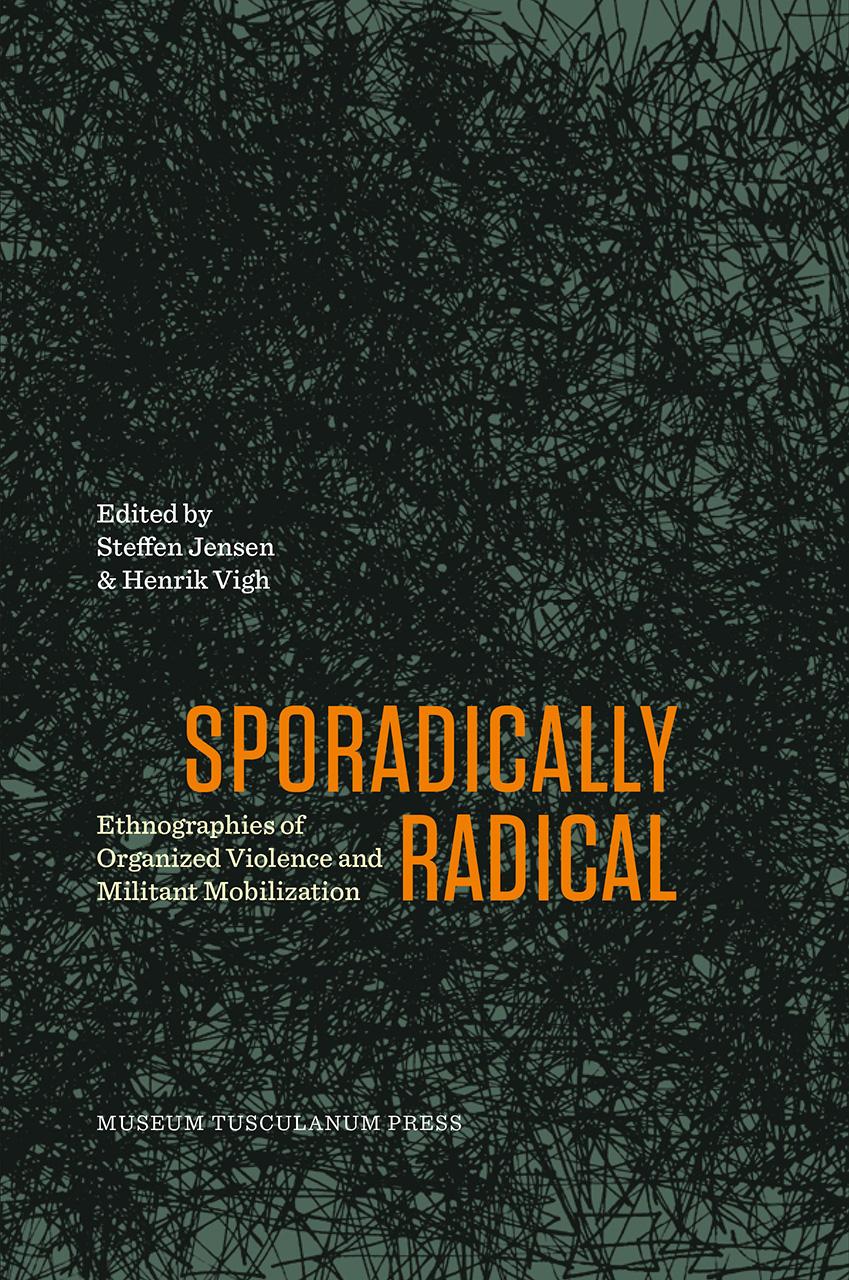 La question agite les observateurs après un attentat ou la découverte que tout un groupe d’amis a pris fait et cause pour l’État islamique : quand se sont-ils radicalisés ? Pour les auteurs de cet ouvrage collectif, le terme de radicalisation ne conduit à aucune analyse pertinente et il faut penser ces engagements en termes de mobilisation au sein de structures portées sur la violence, sachant que la mobilisation n’est pas forcément de tous les instants ni unilinéaire. L’approche des auteurs danois se veut ainsi dualiste et perspectiviste. Il y a ce qui caractérise les mobilisés (âge, sexe, génération, futurs imaginés) et ce que les organisations ont à leur offrir (des rituels et des secrets, ainsi qu’un mode de relation aux autorités). Les mobilisés naviguent entre les possibilités, recherchant revenus, statut et avenir.
La question agite les observateurs après un attentat ou la découverte que tout un groupe d’amis a pris fait et cause pour l’État islamique : quand se sont-ils radicalisés ? Pour les auteurs de cet ouvrage collectif, le terme de radicalisation ne conduit à aucune analyse pertinente et il faut penser ces engagements en termes de mobilisation au sein de structures portées sur la violence, sachant que la mobilisation n’est pas forcément de tous les instants ni unilinéaire. L’approche des auteurs danois se veut ainsi dualiste et perspectiviste. Il y a ce qui caractérise les mobilisés (âge, sexe, génération, futurs imaginés) et ce que les organisations ont à leur offrir (des rituels et des secrets, ainsi qu’un mode de relation aux autorités). Les mobilisés naviguent entre les possibilités, recherchant revenus, statut et avenir.
Le premier chapitre emmène le lecteur vers la Guinée-Bissau, où l’on suit d’anciens miliciens de la milice Aguenta (démobilisée en 1999 après la défaite du président Vieira lors de la guerre civile). L’un d’eux considère que l’islamisme radical peut être une solution d’avenir, sans pour autant être lui-même dévot. D’autres ont pu rallier l’Europe et s’insérer dans des réseaux criminels au Portugal tout en se tournant vers le rastafarisme. Le deuxième chapitre s’intéresse à la Sierra Leone, où des anciens soldats et miliciens tentent de gagner leur vie en étant embauchés par des entrepreneurs politiques dans les pays limitrophes. « Victimes de la paix », ils sont passés à la fin de la guerre civile de « quelqu’un » à « personne » (tension entre visible et invisible p. 87). Soupesant les risques et les gains potentiels, ils s’engagent ou non dans des actions clandestines, avec divers intermédiaires qui ne savent pas forcément eux-mêmes qui sont les clients. De ce fait, ce sont des relations purement techniques, sans attachement ni à un homme ni à une cause, mais où le secret a une valeur cardinale.
Le chapitre suivant nous transporte au Bangladesh, à l’université de Dacca. Pour obtenir un endroit où dormir dans les dortoirs de l’université, les primo-entrants sont dans l’obligation de choisir l’une des sections étudiantes des grands partis bangladeshis et sont contraints d’y militer. Les dortoirs peuvent être pris d’assaut à la faveur de résultats électoraux, et des étudiants perdent leur lit lors de conflits entre coteries d’un même parti. Mais pour certains, ce peut être le début d’une carrière politique. Où finit la coercition et où commence le plein gré ?
Le mouvement Mungiki (quatrième chapitre), héritier des Mau Mau des années 1950, est très actif au Kenya. Il se présente comme une société secrète à coloration religieuse (baptême, rituels, serments secrets, hiérarchie, tribunaux internes) qui prend la défense de la culture kikuyu et veut corriger les erreurs historiques qui contraignent une partie des Kikuyus à la pauvreté et à la marginalisation politique. Leur volonté de retrouver les anciens rituels kikuyus est une très claire attaque contre le Kenya né de l’indépendance, contrebalancée par un appel constant au renouvellement générationnel, une régénération littéralement (p. 143). Très souvent opposés au gouvernement de Nairobi, les heurts avec la police peuvent être meurtriers.
Le cinquième chapitre se déroule à Manille, au sein de la confrérie Tao Gamma Phi. Pour intégrer cette confrérie, il faut passer par un rituel qui inclut de se faire frapper par une batte de cricket. Pourquoi de jeunes hommes adhèrent-ils à cette confrérie de quartier pauvre, qui pourtant ne peut leur promettre une ascension sociale ou un réseau comme le pourrait une confrérie étudiante ?
Au Népal, la guérilla maoïste est rentrée dans le jeu institutionnel avec la fin de la guerre civile en 2006 (sixième chapitre). Guérilla devenue parti (au pouvoir dès 2008), il comprend une organisation de jeunesse qui cherche à mobiliser les énergies en faveur de changements politiques. Entre consumérisme, famille omniprésente et un écart encore très grand entre ville et campagne, la vie de jeune militant maoïste n’est pas de tout repos.
L’Ouganda est le dernier pays visité dans ce livre, avec les deux derniers chapitres. Le premier décrit le programme de « jeunes cadres » mis en place par le gouvernement ougandais dans la région de l’Acholiland (qui a connu la guerre civile entre 1986 et 2009). À la fin officieuse des hostilités, entre autres avec la Lord’s Resistance Army (LRA), le gouvernement de Kampala décide de se réimplanter dans le Nord. Pour les jeunes formés (majoritairement issus de camps de déplacés), il y a l’attrait d’une entité nébuleuse et féroce, l’État ougandais, et la possibilité de démarrer ainsi une carrière (mais avant tout de survivre). Le dernier chapitre du livre se place ensuite de l’autre côté, chez d’anciens insurgés revenus à la vie civile. Démobilisés (dure critique du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration p. 247-248), ils perdent leur statut, mais ne sont pas forcément libérés de leurs souvenirs (enlèvement d’enfants pour en faire des soldats, assassinats ciblés, attaques de villages, etc.) alors qu’ils sont en contact avec leurs victimes.
Ce livre présente donc une grande variété d’études ethnologiques, dont aucune ne s’intéresse au djihadisme, mais qui permettent néanmoins d’en approcher certaines réalités (la criminalité, p. 42). La critique du terme radicalisation (comme acte normatif d’un gouvernement) est claire, même si parfois les auteurs peuvent avoir du mal à en trouver un autre. Historiographiquement, les auteurs se situent du côté de la théorie dite critique (C. Mouffe et J. Butler, p. 17).
Les contextualisations sont bonnes, même si on peut se trouver en manque de détails dans certains articles (que font vraiment les confréries à Manille et pourquoi se battent-elles entre elles ?). Il faut aussi accepter le point de vue ethnologique, et de ne pouvoir vraiment généraliser à tout un groupe les informations obtenues. Pour les auteurs, parmi la pluralité des motifs qui conduisent à intégrer une organisation violente, celle de la survie prend souvent le pas sur l’adhésion idéologique. Comme chez O. Roy (cité p. 10), il y aurait ainsi d’abord mobilisation, puis éventuellement une coloration idéologique par après.
Mais peut-on comparer un déplacé ougandais qui cherche un moyen de subsistance à un Européen économiquement intégré qui veut rejoindre la Mésopotamie islamiste ? Le livre ne répond pas à cette question… ♦






_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)

