Pierre Messmer – Le dernier gaulliste
Pierre Messmer – Le dernier gaulliste
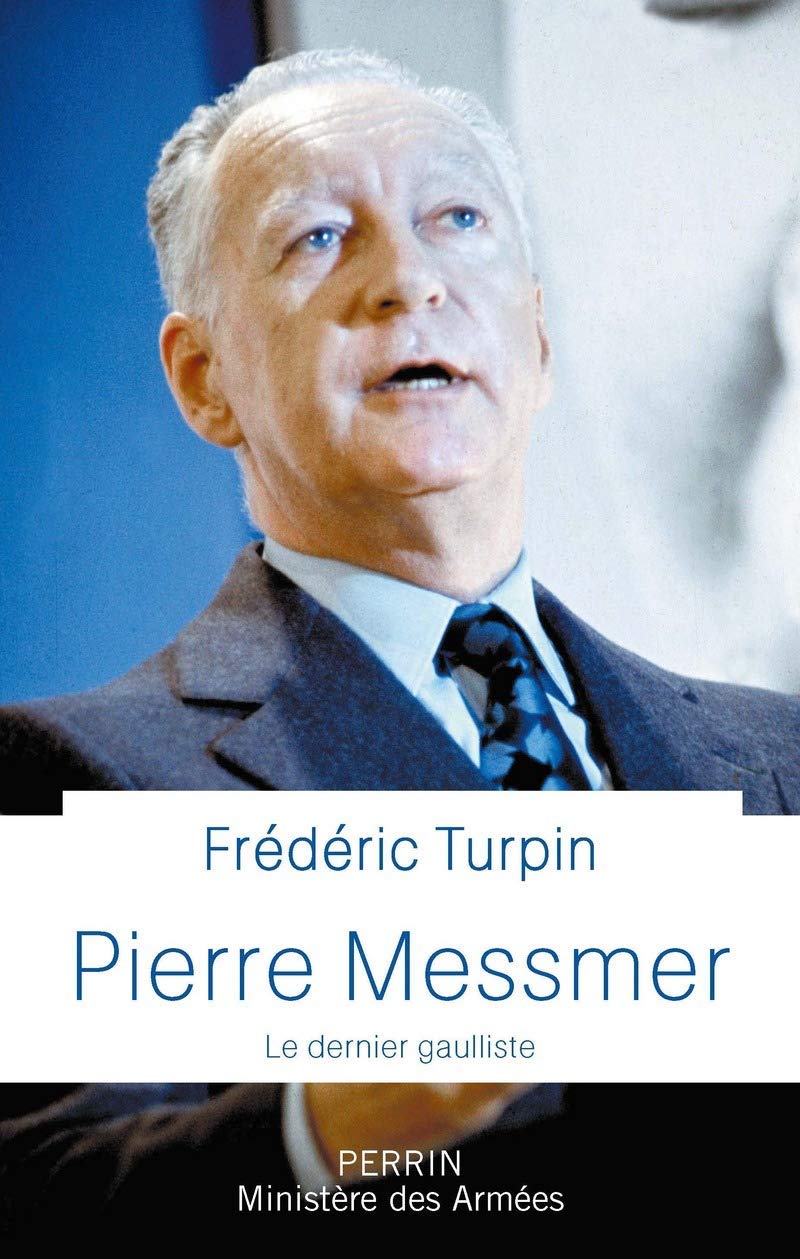 Quelle image les Français ont-ils gardée de Pierre Messmer (1916-2007) ? À l’évidence, et Frédéric Turpin le rappelle dans cette biographie extrêmement réussie, ce n’est pas l’austère second Premier ministre du président Pompidou qui s’est imprimé dans la mémoire collective. Est-ce l’élu lorrain, député (1968-1988) et maire (1971-1989) de Sarrebourg ? Ou encore le chancelier de l’Institut de France (1999-2005) ? Plus sûrement peut-être le ministre des Armées du général de Gaulle (1960-1969) et le combattant de Bir Hakeim, compagnon de la Libération… D’ailleurs, cet ouvrage est coédité par le ministère des Armées.
Quelle image les Français ont-ils gardée de Pierre Messmer (1916-2007) ? À l’évidence, et Frédéric Turpin le rappelle dans cette biographie extrêmement réussie, ce n’est pas l’austère second Premier ministre du président Pompidou qui s’est imprimé dans la mémoire collective. Est-ce l’élu lorrain, député (1968-1988) et maire (1971-1989) de Sarrebourg ? Ou encore le chancelier de l’Institut de France (1999-2005) ? Plus sûrement peut-être le ministre des Armées du général de Gaulle (1960-1969) et le combattant de Bir Hakeim, compagnon de la Libération… D’ailleurs, cet ouvrage est coédité par le ministère des Armées.
En treize chapitres, le professeur d’histoire contemporaine de l’université Savoie-Mont Blanc ressuscite un homme bâti pour l’action. Né au temps des colonies, Pierre Messmer se formera à l’École nationale de la France d’Outre-Mer. Témoin dans sa jeunesse de la montée du danger fasciste, le jeune Messmer se sent proche des socialistes avec lesquels il travaillera en bonne intelligence sous la IVe République. Mais la guerre et la défaite changent complètement le destin de jeune lieutenant qui, de Marseille, réussit à gagner l’Angleterre le 17 juillet 1940. Avec la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, il connaît l’épreuve du feu en mars 1941 au Tchad. Les combats le mènent en Érythrée où il fait face aux Italiens, puis en Syrie où des Français combattent d’autres Français. En 1942, ce sera Bir Hakeim. « Messmer est joyeux (…), écrit-il, d’être dans ce désert dont [il] rêve depuis [son] enfance » (p. 30). De ces affrontements avec les troupes de Rommel, Messmer est un « rescapé » (p. 35). La victoire éclatante, malgré son prix en vies, donne aux Français Libres une aura de gloire militaire si indispensable après tant d’épreuves depuis mai 1940. Pierre Messmer, alors commandant, entrera dans Paris le 24 août à la tête d’un détachement de FFI. Même s’il garde de la descente des Champs-Élysées le « souvenir du plus beau jour de sa vie », il partage le sentiment de son fidèle ami Hubert Germain pour qui « on a retrouvé la France, mais pas les Français ». Attaché à l’état-major du général Kœnig, Messmer obtient d’être renvoyé sur le front des Vosges dès octobre 1944. Le 11 novembre, il est décoré de la Légion d’Honneur par le général de Gaulle, place de l’Étoile.
Lors de ses obsèques, le 4 septembre 2007, ce sont des soldats de la 13e DBLE qui porteront son cercueil dans l’imposante cour des Invalides. Fidélité d’une vie marquée par ce premier et décisif engagement qui donnera à Pierre Messmer une gravité et une autorité exceptionnelles. Mais l’homme n’en fera jamais un titre de gloire et son courage au feu sera le gage d’une vraie humilité qui détonne dans le monde politique auquel il s’adjoindra dans la suite de sa carrière. Mais entre 1945 et 1960, c’est la France d’Outre-Mer qui est son horizon. D’Indochine où il est envoyé en mission d’observation (et où il sera fait prisonnier par le Vietminh), il reviendra convaincu de l’indispensable décolonisation. En Afrique, il administre le nord de la Mauritanie. En 1954, il devient gouverneur de la Côte d’Ivoire puis sera gouverneur du Cameroun (1956) avant d’être haut-commissaire de l’AEF (janvier-juillet 1958) puis haut-commissaire de l’AOF (juillet 1958 - décembre 1959). Mais entre février et mars 1956, il a été le directeur de cabinet du ministre de la France d’Outre-Mer, Gaston Defferre, et à ce titre l’un des rédacteurs de la loi-cadre qui devait dessiner l’évolution de l’empire colonial.
Quand le général de Gaulle lui confie le ministère des Armées, le conflit en Algérie bat son plein. Surtout, l’armée est un bouillon de culture tant les tensions, les ressentiments, les incompréhensions et les douleurs traversent tous et chacun des officiers et des soldats qui sont engagés dans un conflit extrêmement complexe. Par-delà la question algérienne, c’est une identité impériale de la France qui s’affaisse depuis 1940 peut-être, 1954 sans doute. L’homme d’autorité qu’est Pierre Messmer reçoit la mission à la fois d’imposer l’autorité politique aux militaires et en même temps de faire évoluer l’armée vers ses nouvelles missions dans un monde transformé qui n’est plus celui des grands empires coloniaux, mais celui de la bombe nucléaire que la France sait faire exploser à partir de septembre 1960. Le ministre aura à subir le putsch des généraux – il offrira sa démission au général de Gaulle – et à y rétablir l’ordre. Il le fera sans fléchir, mais non sans débats intérieurs. Mais chez lui, le devoir, qui est une manière d’obéir à sa conscience, s’impose.
« Louvois du général » : c’est par cette formule que Frédéric Turpin évoque le grand modernisateur de l’armée entre 1960 et 1969. Le chapitre, extrêmement précis et informé, laisse apparaître un grand administrateur et fait revivre une époque où la pensée géopolitique du chef de l’État s’applique à forger les instruments concrets de la puissance de la France. Messmer a même des élans visionnaires. Assez vite, il plaide pour une armée de métier et envisage une profonde réforme du service militaire voire sa disparition.
La démission de De Gaulle en avril 1969 conduit Messmer à s’éloigner du gouvernement. Il n’y revient qu’en février 1971 au ministère de la rue Oudinot (France d’Outre-Mer)… renouant avec sa compétence initiale. Il est aussi un gardien sourcilleux du gaullisme, instrumentalisé par Pierre Juillet et Marie-France Garaud pour étouffer le Premier ministre Chaban-Delmas. Lorsqu’il est nommé à Matignon en juillet 1972 (Pompidou, en 1968, avait déconseillé à de Gaulle de choisir Messmer qui, selon lui, « n’avait pas les qualités nécessaires, ni la fermeté ni le discernement », p. 197), Pierre Messmer va se trouver aux prises avec la montée en force de la gauche réunie dans son programme commun, les divisions du groupe gaulliste et l’affaiblissement progressif du président Pompidou qui ouvre la voie aux ambitions et aux ambitieux. Pierre Messmer a quitté Matignon sans regret après l’élection de Valéry Giscard d’Estaing et la nomination de Chirac. Il a essuyé non plus le vrai feu qui tue, mais les manœuvres politiciennes lors de la semaine qui suit la mort de Pompidou en avril 1974. Vingt ans plus tard, revenant sur ces moments, il dira combien il a été sage de ne pas briguer la présidence de la République pour laquelle il n’était pas fait ! Combien aujourd’hui auraient cette sagesse ?
Après 1974, il demeure présent dans le débat parlementaire et reste soucieux de défendre une relation entre la France et l’Afrique, plus saine et plus respectueuse de ce que veut dire l’indépendance des nations africaines. À cet égard, son grand adversaire est Jacques Foccart qui, de De Gaulle à Chirac, en passant par Pompidou, aura forgé sa « Françafrique » dont on doit légitimement se demander si elle a servi l’intérêt national ou des intérêts privés… Toujours lucide sur les questions de décolonisation, il plaide en faveur de l’indépendance de Djibouti (1977) et interviendra sur la Nouvelle-Calédonie à partir de 1985. Soutien de Jacques Chirac – dont il doute cependant de son gaullisme – il est naturellement critique à l’égard de la présidence de Giscard d’Estaing et carrément hostile à celle de Mitterrand.
Après sa défaite électorale de 1988, il devient un académicien assidu (Sciences morales et politiques, et Académie française) et met son prestige au service de l’Institut. Le chancelier Messmer a beaucoup modernisé le fonctionnement de l’institution et a su lui attirer des financements opulents et nombreux.
Frédéric Turpin signe une biographie complète qui parfois entre dans son intimité (il fut marié deux fois de 1952 à 1991 avec Gilberte Duprez et de 1998 à sa mort avec Christiane Bataille-Terrail). Il fait revivre un homme plus complexe que ce que la presse, au temps de son action politique, en disait, un administrateur qui fut soldat et qui redevint administrateur avec la passion d’agir. Un parcours du XXe siècle dont on pourrait pourtant penser qu’il serait bon qu’il inspirât certains jeunes ambitieux. ♦







