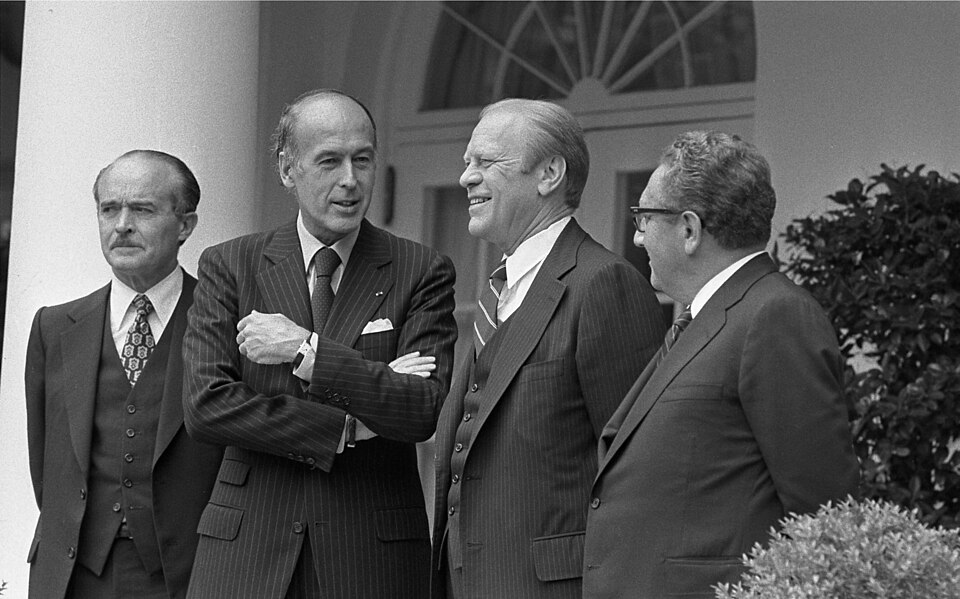The European Union, when concluding, on April 9, 2001, an agreement of stabilization and of association with Macedonia—at the precise moment of destabilisation by its Albanian minority—,puts a clear and deep commitment in ex-Yugoslavia. Regrettably, despite reassuring signs (the most important being that Vojislav Kostunica is president of Yugoslav Union) nothing has been settled especially thorough question remains skip : is it necessary to maintain borders unchanged or to envisage to redefine them ? In front of this major stake, international community puts up with contradictions : on one side, must Kosovo continue to belong to Yugoslavian union ; on the other side, de facto separation deepens every day. Yugoslav case will not be solved either by Providence or by the good will. In that perspective, the European union would know how to only disappoint, economic and financial assistance being not able to be efficient once an indisputable political settlement has been reached.
Le 9 avril 2001, l’Union européenne signe avec la république de Macédoine le premier accord de stabilisation et d’association avec l’un des États issus de la Yougoslavie de Tito. La portée symbolique du geste est évidente : il s’agit de reconnaître la Macédoine comme un « candidat potentiel » à l’entrée au sein de la « famille européenne ». Le moment n’est pas choisi par hasard : la Macédoine est gravement ébranlée par la rébellion d’extrémistes albanais, revendiquant au minimum une renégociation du pacte national macédonien et, à l’extrême, l’indépendance de la partie albanaise de la Macédoine, dans la perspective de la constitution d’une Grande Albanie (Albanie elle-même, Kosovo et Macédoine). L’Union européenne (UE) se pose en guide de l’ex-Yougoslavie vers l’économie de marché et la démocratie. Or, malheureusement, quelles que soient les bonnes intentions de l’UE, la désillusion est probablement au rendez-vous. Un accord, aussi bon soit-il, ne fait pas la paix. En dépit d’apparences rassurantes, rien n’est réglé en ex-Yougoslavie. Le plus dur n’est pas derrière mais devant la communauté internationale.
Un ciel en apparence éclairci
Pourtant, ces derniers temps, le ciel s’est remarquablement éclairci en ex-Yougoslavie. La Slovénie est à peu près sortie du bourbier balkanique : petite, homogène, contiguë à l’Autriche, candidate officielle à l’Union européenne, elle devrait, avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, faire partie de la première vague du futur élargissement à l’Est. La Croatie, qui, sous Franjo Tudjman, était, avec la Yougoslavie de Slobodan Milosevic, l’une des deux promotrices de la purification ethnique, a abandonné son rêve de grande Croatie et s’est fixé pour but de se sortir, elle aussi, du nœud de vipères balkanique et de rejoindre la famille européenne. La Bosnie-Herzégovine est loin d’être guérie des haines entre ethnies : la fédération croato-bosniaque, qui devait être le laboratoire d’une Bosnie multiethnique, est une coquille vide ; l’ex-république d’Herzeg-Bosna (Croates) s’est dotée de son propre chef, à Mostar, d’institutions ; quant à la Republika Srpska, elle reste tenue par les nationalistes. En même temps, depuis les accords de Dayton (décembre 1995), la Bosnie demeure calme, comme si, enfin, s’installait une lassitude des belligérants et que, désormais, l’important était de reconstruire une vie normale. En novembre 2000, accède au pouvoir, à Sarajevo, une coalition dominée par les sociaux-démocrates, mais en fait celle-ci ne gouverne que le tiers bosniaque — musulmans — de la Bosnie.
Le changement majeur vient de la Yougoslavie (fédération Serbie-Monténégro) elle-même, avec l’élection à la présidence de la Fédération de Vojislav Kostunica. Ainsi la Yougoslavie de M. Milosevic, cœur de tout l’ébranlement yougoslave depuis 1991, acteur le plus féroce tant en Bosnie qu’au Kosovo, devient-elle raisonnable… Le président Kostunica semble chercher un équilibre difficile entre, d’une part, la reconnaissance du désastre et, d’autre part, la préservation d’une dignité serbe. C’est ainsi qu’il procède à l’arrestation de Slobodan Milosevic, mais tient à ce que ce dernier soit jugé, non par le Tribunal pénal international (TPI) qui le demande avec insistance, mais à Belgrade, par ses compatriotes. De même paraît-il disposé à prendre acte d’une éventuelle indépendance du petit frère, de l’entité sans laquelle il n’y a plus de Fédération yougoslave : le Monténégro.
Un ciel en apparence éclairci
Or rien n’est réglé
Monténégro
Kosovo
Serbie
Macédoine
Il n’y a que de mauvaises solutions
L’illusion des formules douces
ex-Yougoslavie, Monténégro, Kosovo, Serbie, Macédoine



_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)