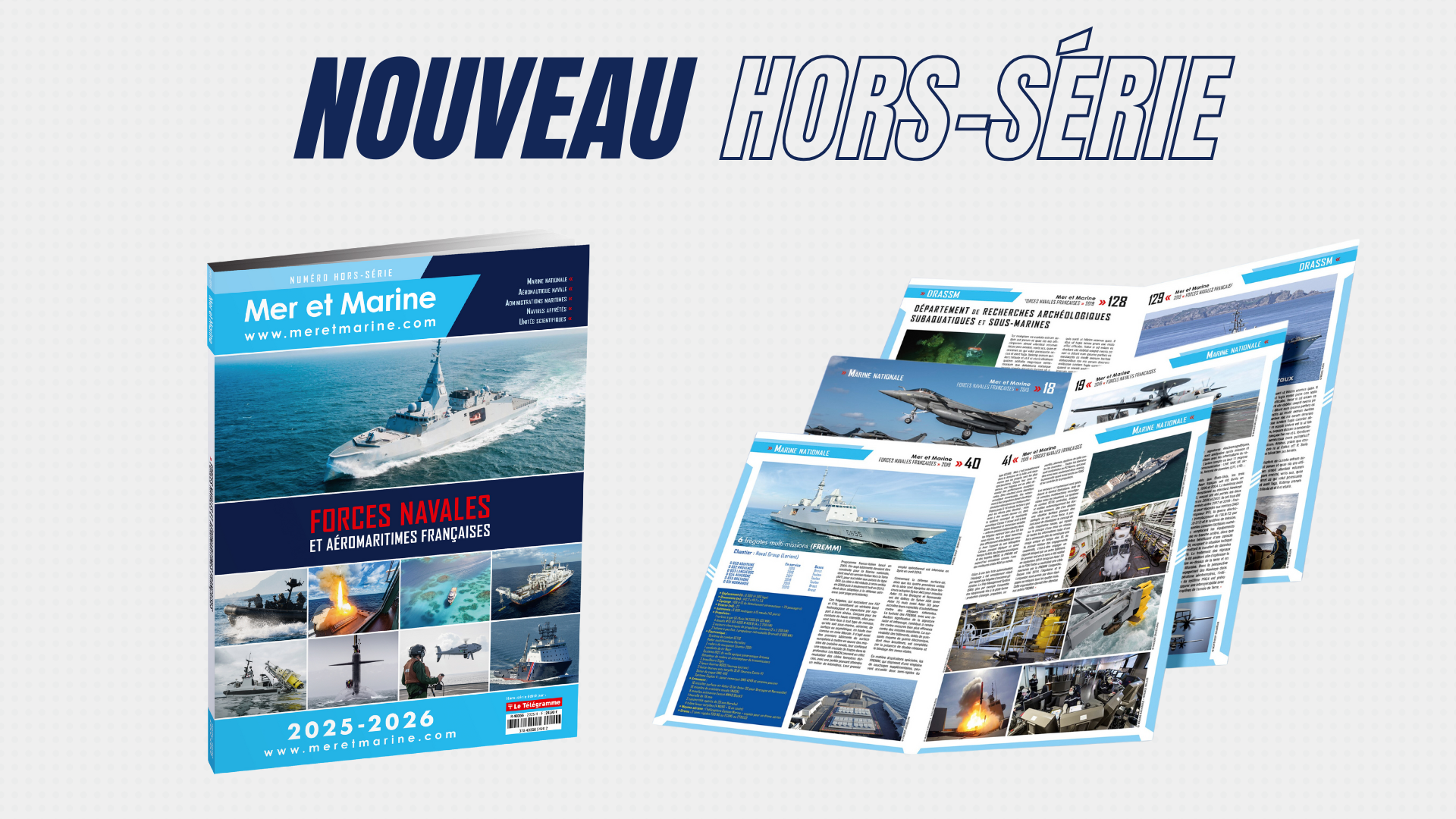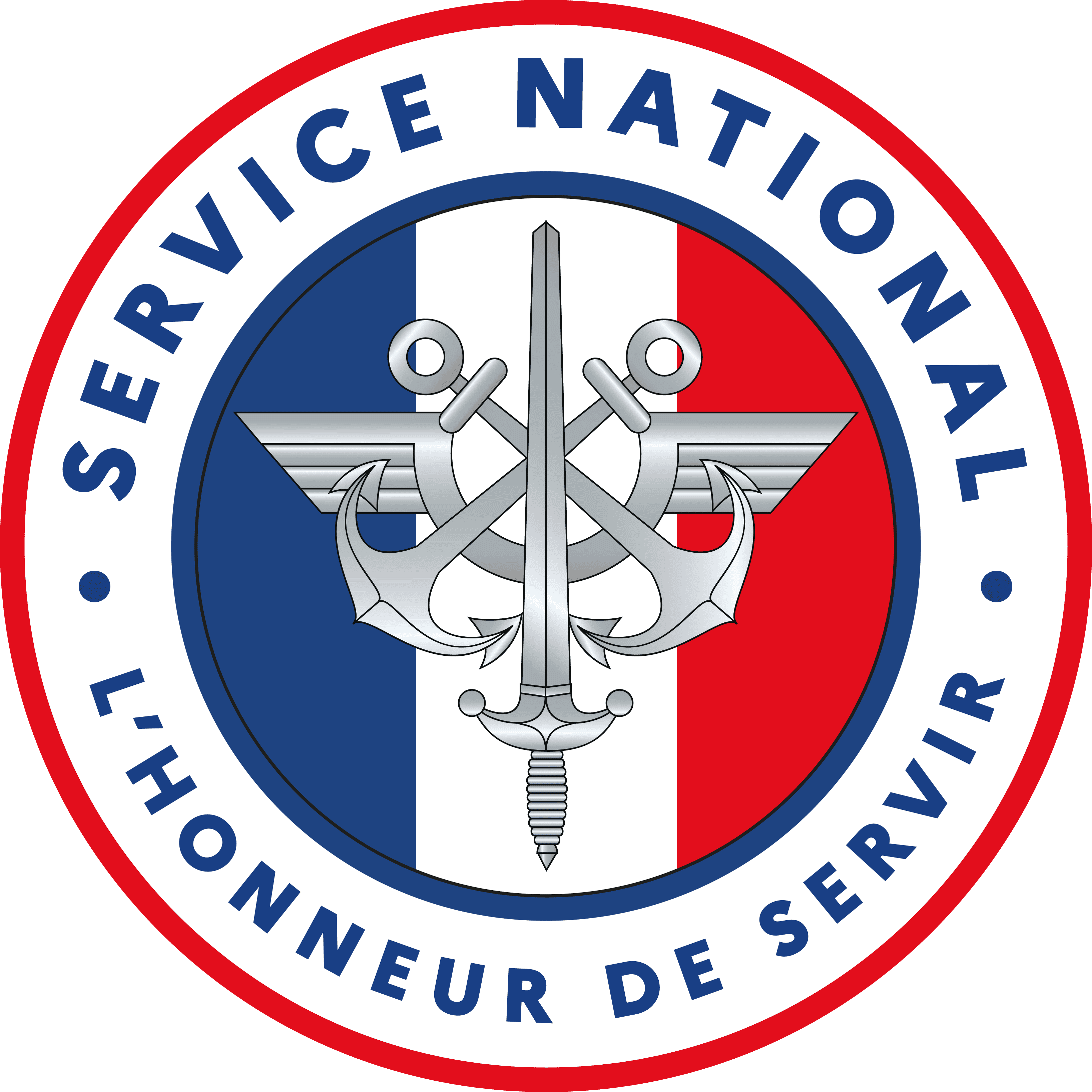Quarante ans après la fin de la guerre d'Algérie, les séquelles de la tragédie restent présentes dans la mémoire collective des sociétés française et algérienne. En France, les Pieds-noirs et les Harkis souffrent encore de plaies non cicatrisées et provoquées par les blessures de contentieux dramatiques qui ont été particulièrement mal gérés par le pouvoir politique. Les controverses déchirantes ont aussi laissé des marques profondes au sein de la communauté militaire. En Algérie, les cruelles désillusions d'une indépendance confisquée par les nouveaux maîtres du régime ont abouti à une conjoncture de contestation généralisée qui a plongé le pays dans un marasme économique. L'opposition au système se manifeste notamment par une situation d'insécurité alarmante et l'affirmation de plus en forte d'une identité kabyle.
L'Algérie, quarante ans après
Quatre décennies après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, le plus grand et le plus riche (potentiellement) des États du Maghreb se trouve dans une situation inquiétante de difficultés politiques, sociales et économiques. Ce constat est amplifié par le conflit des mémoires qui demeurent tourmentées par des controverses indélébiles que l’Histoire a scellées dans l’ambiguïté et l’affliction.
La tragédie des trois controverses
Les Pieds-noirs, les Harkis et l’Armée française en Algérie sont tombés dans le piège d’une guerre qui n’osait pas dire son nom. Ces trois entités ont été gravement affectées par ce drame humain qui n’a toujours pas fini d’ébranler notre société.
L’humiliation des Pieds-noirs
L’exode bouleversant des Européens d’Algérie au cours de l’été 1962 et les conditions dramatiques de leur déracinement ont mis en lumière, d’une part, l’imprévoyance de l’État, complètement désorienté par l’ampleur du phénomène, d’autre part l’échec des accords d’Évian où l’engagement était pourtant pris de garantir la liberté et la sécurité de tous les habitants d’Algérie. Ces accords de dupes, que certains commentateurs ont qualifié de « non-accords d’Évian », n’ont pas été respectés puisque des milliers d’Européens ont été massacrés, et des centaines de leurs propriétés pillées dans les mois qui ont suivi la signature du cessez-le-feu. Contraints de se séparer de la terre de leurs ancêtres et d’y abandonner leurs biens dans des conditions brutales et humiliantes, les Pieds-noirs estiment qu’ils ont été trompés par les promesses longtemps faites par un pouvoir politique qui n’a jamais maîtrisé la crise algérienne. Accueillis en métropole dans un climat d’hostilité, ces naufragés de la Méditerranée ont été subitement plongés dans un angoissant conflit d’identité marqué par un trouble persistant qui a été généré par la confusion entre les notions de pays et de nation. Pour ces Européens de souche, nés sur cette terre du Maghreb sur laquelle ils ont fait fructifier l’héritage de leurs ancêtres, leur pays c’est l’Algérie ; mais leur nation c’est la France. Un pays qui les a dépossédés de leurs biens, une nation qui n’a pas su les protéger, qui a difficilement accepté leur nouvelle insertion et qui les a condamnés injustement après avoir encensé, pendant un temps, leur œuvre civilisatrice. À ce terrible paradoxe s’ajoute le concept de patrie qui s’appuie sur les notions de pays (donc de terre natale) et de nation. Cette équivoque soulève une question mortifiante : quelle est la patrie des Pieds-noirs ? La réponse n’est pas évidente en raison de l’ambiguïté qui taraude leur conscience : la terre qu’ils ont dans leur sang et qui « leur tient aux tripes », celle où sont enterrés leurs aïeux, ou la terre sur laquelle ils ont été obligés de s’installer définitivement ?
Il reste 88 % de l'article à lire
Plan de l'article