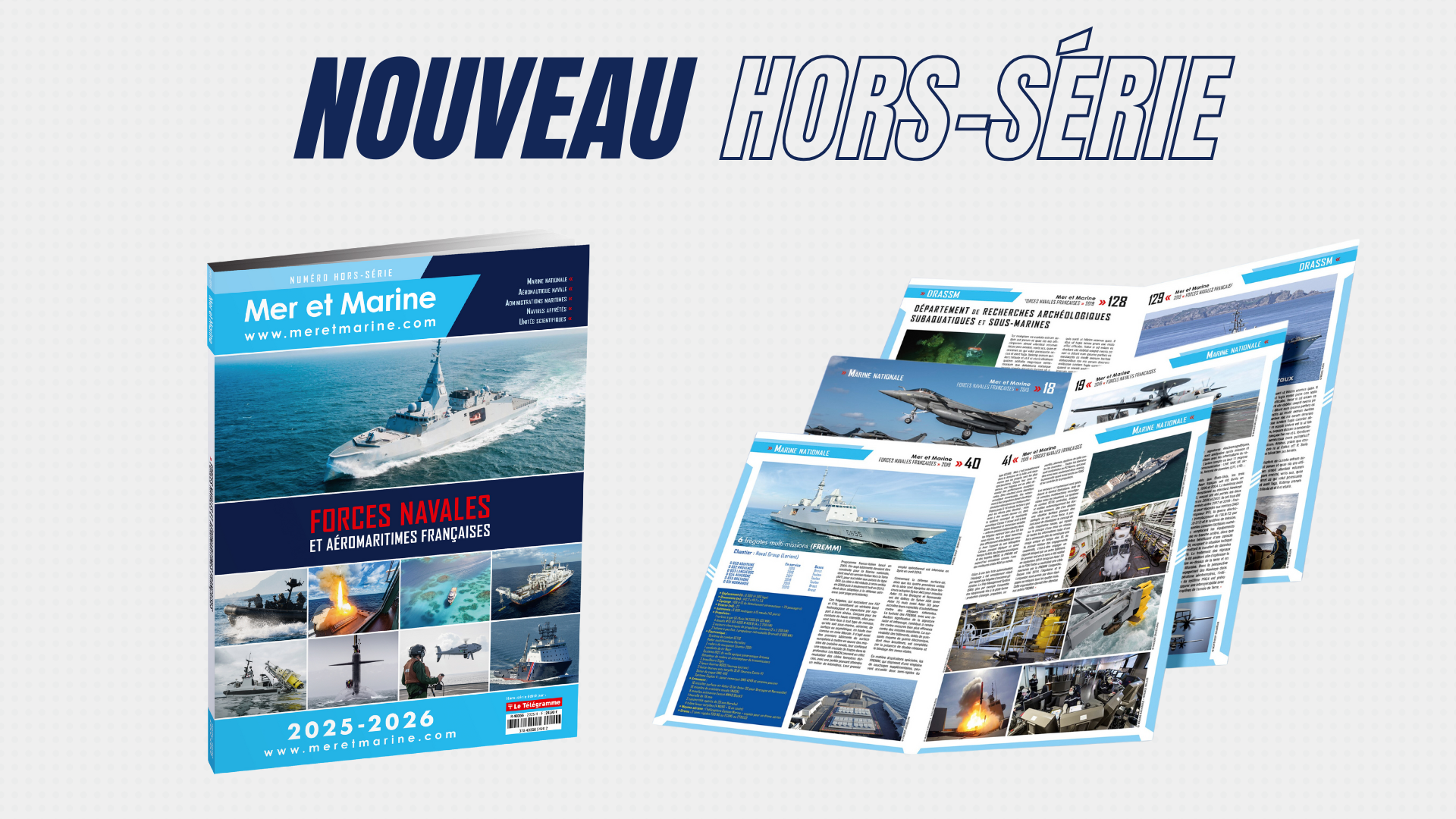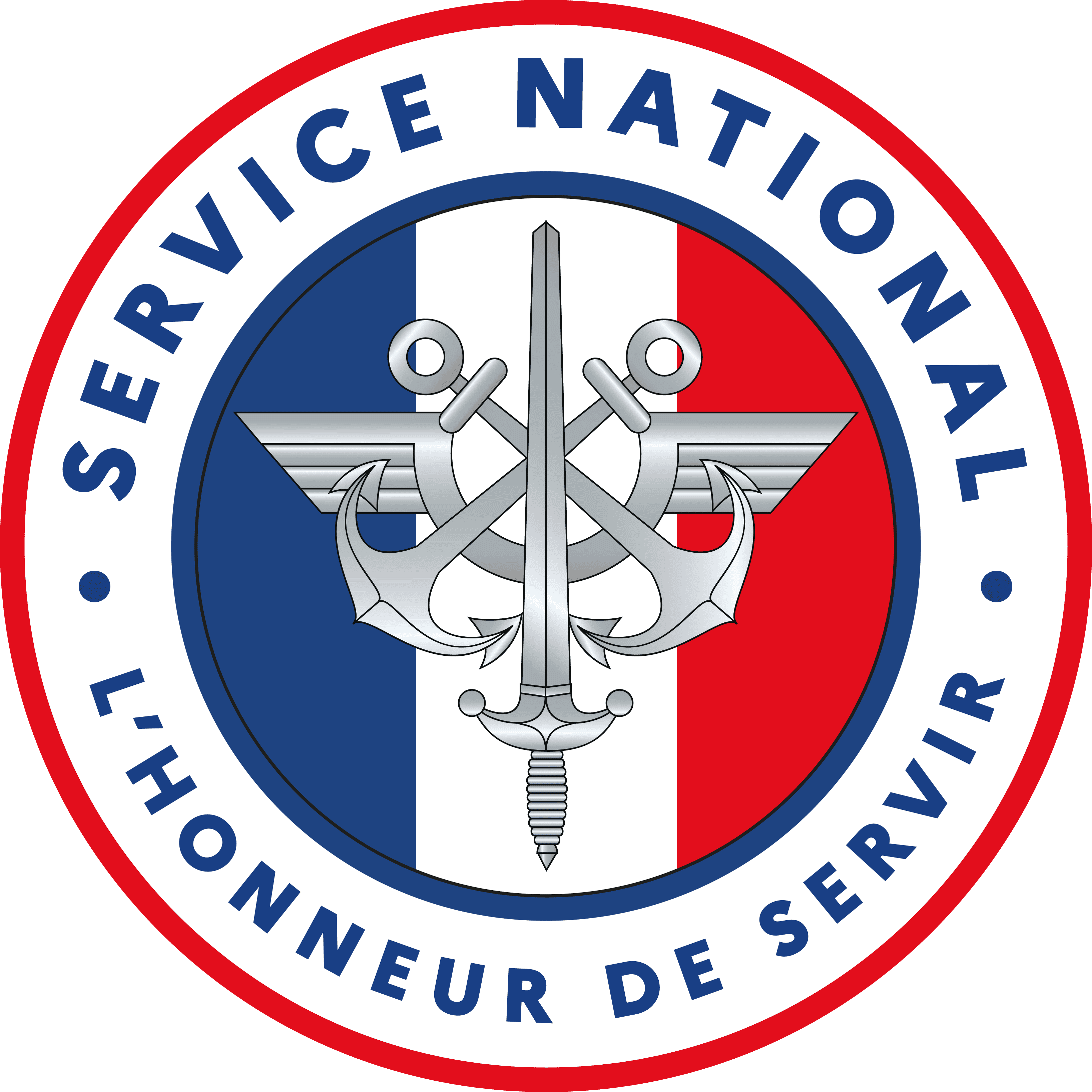Le présent article a été rédigé avant le début de l'offensive américaine en Irak, ainsi que le discours prononcé par le président américain, le 14 mars dernier, sur la question palestinienne. Toutefois, ni l'un ni l'autre n'affectent le contenu. L'objet de l'article est de démontrer la relation existant entre l'ordre mondial et cette région, largement sensible et explosive. Au moment où l'ancien système, avec ses instruments, est mis à l'épreuve, un autre semblerait se manifester. L'auteur s'interroge sur le rôle de cette région dans le processus en cours. Va-t-elle servir de catalyseur à l'émergence définitive d'un « ordre » ou d'un « désordre » mondial ?
Le « nouvel » ordre mondial et le Proche-Orient
Nul doute que le Proche-Orient a toujours occupé une place centrale au sein du système mondial. Théâtre d’une confrontation entre deux superpuissances dans un système bipolaire, il voyait ses propres conflits s’enliser au profit du jeu « à somme nulle » de l’époque. Le vide engendré par la disparition d’une des deux puissances exaltait auprès de l’autre la tentation irrésistible d’accéder, sans rivale, au sommet.
Dès lors, le rôle américain devenait un facteur déterminant dans la gestion des affaires mondiales. Le Proche-Orient allait présenter les premières manifestations de cette nouvelle donne. Tout d’abord, il y avait l’opération « Tempête du désert » lancée, en 1991, sous direction américaine afin de libérer le Koweït de l’occupation irakienne. Ensuite, Washington s’était livré à un exercice diplomatique intense pour convoquer la conférence de Madrid sur la paix au Proche-Orient. En revanche, l’instauration de deux zones d’exclusion aérienne au nord et au sud de l’Irak par les États-Unis et la Grande-Bretagne ainsi que l’opération « Renard du désert » en décembre 1998, sans l’approbation du Conseil de sécurité de l’ONU, relançaient le débat sur des questions fondamentales, parmi lesquelles : le principe du recours à la force au nom de l’ONU mais sans son aval explicite ; l’application partielle des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ; le droit d’ingérence dans les affaires intérieures d’un État indépendant.
Ce débat allait reprendre de plus belle avec l’exigence américaine du départ de deux dirigeants dans la région : Yasser Arafat et Saddam Hussein. Dans le cas palestinien, l’« allié » israélien semblait avoir le « feu vert » pour régler le compte du chef de l’autorité palestinienne, accusé d’ailleurs d’être à la tête d’une « organisation terroriste ». En ce qui concerne celui du raïs irakien, Washington se réservait le droit, avec des pays « alliés », de s’en charger.
Il reste 93 % de l'article à lire
Plan de l'article