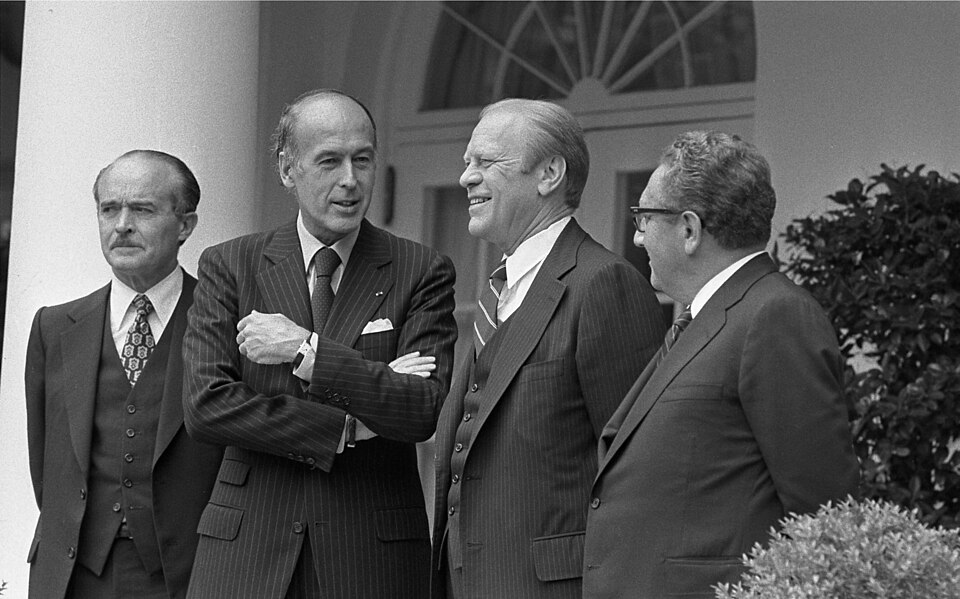Le coup de force du 16 mars, qui a vu les États-Unis et la Grande-Bretagne s'octroyer le droit de faire la guerre, appelle trois questions :
– S'agit-il d'une décision de principe, ou d'une application délibérée au Proche-Orient du « deux poids, deux mesures » déjà dénoncé pour Israël et la Palestine ?
– L'unilatéralisme américain est-il vraiment nouveau, est-il la conséquence du 11 septembre ?
– Est-il impossible de lutter contre ? Le barrage diplomatique et la réponse de Paris, Moscou et Pékin montrent que non. Les peuples arabes doivent se ressaisir et assurer leur part de cette lutte de civilisation aux normes des temps nouveaux.
Le sommet des Açores marque un tournant dans l’histoire de l’après-guerre. Le 16 mars 2003, les États-Unis et le Royaume-Uni, fondateurs des Nations unies, déclarent constater l’échec de l’institution conçue pour assurer la sécurité collective et garantir la paix et la sécurité internationale et décident en conséquence de s’affranchir de la Charte.
Les deux États ouvrent ainsi une ère où, pour la première fois en cinquante-huit ans, la faculté d’apprécier la rupture de la paix et de décider des mesures appelées à la rétablir cesse d’être l’apanage du Conseil de sécurité des Nations unies. Sans proposer une quelconque structure appelée à prendre la relève, ils s’octroient d’autorité tous les pouvoirs et décident de déclarer une guerre hors de toute légalité.
Ce coup de force marquera l’ordre international au-delà de la question irakienne, qui n’est qu’un premier cas d’application. Un tel développement appelle trois interrogations.
Une exception délibérée
Les faiblesses des Nations unies
Le désarmement de l’Irak
Le blocage systématique de l’ONU
Contrôle stratégique
Omnipotence ?
Unilatéralisme
L’imperium
Passivité ou révolte ?
Ressaisissement arabe
Une politique arabe
invasion de l'Irak, États-Unis, George W. Bush, Royaume-Uni, ONU, ADM, deux poids-deux mesures




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)