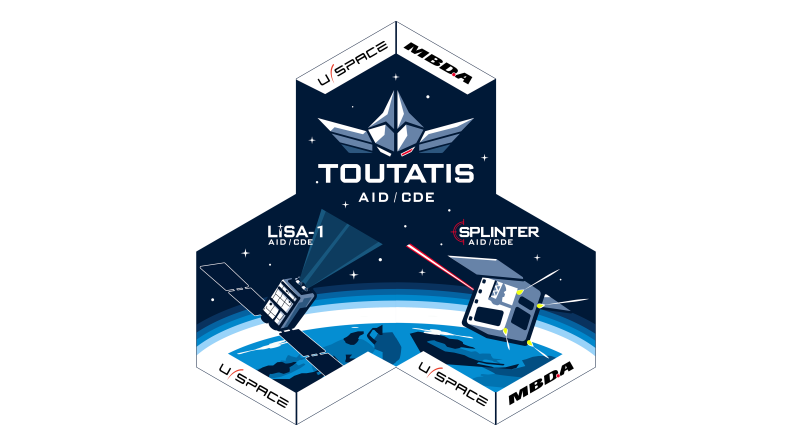Guerre et sacrifice : la violence extrême
Guerre et sacrifice : la violence extrême
C’est en anthropologue qu’il est, matière qu’il enseigne à l’Université de Lausanne, accessoirement en philosophe engagé, que Mondher Kilani analyse le phénomène de la guerre. Sa réflexion procède du conflit irakien et de la doctrine du « zéro mort ». Maints de ses développements sont abstraits ou se réfèrent à des écrits ou des auteurs que tout lecteur n’est pas censé avoir approché. Peu importe, sa réflexion est originale et stimulante. Elle pose quelques-uns des problèmes que tout un chacun doit se poser.
Que signifient exactement les concepts largement utilisés de guerre juste ou injuste, de sacrifice nécessaire, de martyrs de la bonne cause, de lutte du bien contre le mal, comment désigner les vrais ennemis, contenir les risques et les menaces terroristes, dessiner un environnement international sécurisé. Le concept du « zéro mort » est apparu récemment du côté de l’Occident comme l’horizon ultime de toute guerre. Il paraît calqué sur la logique économique du « zéro défaut ». On pense désormais faire campagne sans subir de pertes humaines, du moins de son côté. La guerre « zéro mort » sépare ainsi l’humanité en deux catégories distinctes : celle où les hommes ne doivent pas être tués ; celle où ils peuvent l’être. Le déni de l’échange dans l’acte de guerre, la volonté de ne plus reconnaître à l’autre le statut de combattant, sinon celui d’un obstacle à abattre, le refus de traiter avec lui et de définir un objectif commun, enferment le combattant moderne dans une vision étriquée de l’action pour l’action. Une telle logique de l’immédiat, estime l’auteur, où il s’agit de rendre un coup pour un coup et tout de suite, configure une réciprocité « négative » de ces coups et de la vengeance avec toutes les conséquences incalculables.
Le rapport au sacrifice, en effet, qui est à la base de tout conflit, ne semble pas être le même dans l’un et l’autre cas. Le sacrifice, chose jadis sacrée est reléguée à une pensée prémoderne presque archaïque, celle hier des kamikazes, celle aujourd’hui des feddayin, littéralement celui qui sacrifie sa vie pour sauver celle des autres, après avoir été celle des moujâhed, tiré de jihâd. Quant au terme de châhed, qui se rapprocherait le plus du terme français de « martyr », il désigne celui qui est mort dans le combat contre l’ennemi. Or le sacrifice de soi est toujours nécessaire pour alimenter le sacré, que celui-ci soit d’ordre religieux ou séculier. Une telle attitude des pays occidentaux vis-à-vis de la mort est peut-être compréhensible, mais ne dénature-t-elle pas en définitive toute notion anthropologique de la guerre qui a toujours été basée sur une forme de réciprocité de l’autre, de l’ennemi, avec lequel, tôt ou tard, il conviendra de conclure la paix ou pactiser, à moins de viser son seul anéantissement.
Mondher Kilani en revisitant la thèse de Samuel Huntington, sur le conflit des civilisations, estime de manière un peu forte que l’on assiste en vérité à une forme de guerre civile à l’intérieur de l’empire, incluant sa périphérie musulmane. La puissance impériale n’est pas résolue à l’observation armée (Clausewitz) dans son aire d’influence et reproduit la division ami-ennemi à intégrer du même ensemble politique. La guerre du « zéro mort » relève d’une attitude plus générale visant à l’élimination totale du risque et des aléas de l’ensemble des domaines de la vie. Plus le monde est sécurisé plus l’insécurité fait scandale. La guerre apparaît dans cette optique une catastrophe et non comme un mode de gestion des conflits entre sociétés qu’elle était jadis. Cette forme de guerre en quelque sorte « désacralisée », « désincarnée », lui ôte ses fonctions sociales, psychologiques et politiques traditionnelles. Elle modifie les notions de violence et de sacrifice. On ne suivra peut-être pas l’auteur sur cette voie, mais il aura ouvert bien des chemins pour une plus juste appréciation de la guerre d’aujourd’hui. ♦