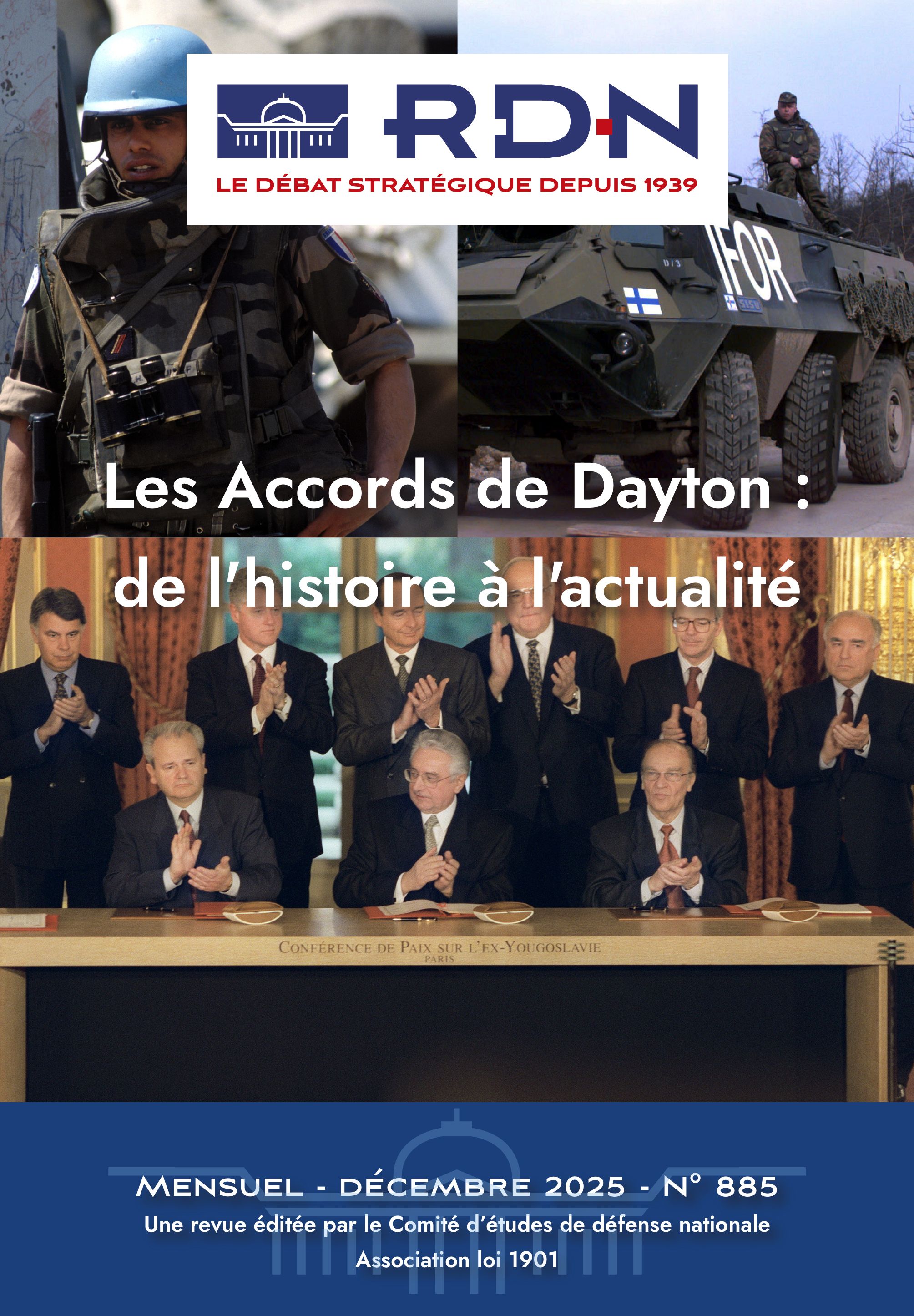Politique et diplomatie - Vers une justice pénale internationale ?
Le 22 février 1993, par la résolution 808, le Conseil de sécurité des Nations unies, à l’unanimité, « décide la création d’un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ». Le 8 novembre 1994, par la résolution 955, il institue un tribunal du même type pour le Rwanda. Ces deux créations sont importantes, d’abord parce que le Conseil de sécurité les fonde sur le chapitre VII de la Charte, domaine du maintien de la paix dans lequel il peut adopter, s’il le juge nécessaire, des mesures coercitives que doivent appliquer tous les États membres de l’Organisation mondiale. Les violations graves du droit humanitaire constituent donc une menace contre la paix, appelant la mobilisation de toute la communauté internationale. En outre, depuis les tribunaux mis en place à l’issue de la Seconde Guerre mondiale (Nuremberg, Tokyo), aucune juridiction pénale internationale n’avait été établie.
Alors, que signifient ces tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ? Ne sont-ils que les produits de la conjoncture politique (la gravité, la perception des crimes commis, l’émotion des opinions publiques occidentales obligeant les gouvernements à faire un geste frappant) ? Ou, au contraire, traduisent-ils un mouvement de fond, les États prenant de plus en plus conscience que des atteintes majeures à la dignité des hommes ne peuvent pas rester impunies ? La réponse ne saurait être qu’extrêmement prudente. Certes, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la question de la sanction pénale des responsables politiques ayant commis, à l’occasion de leurs fonctions, des actes criminels, est en débat ; de plus, ces tribunaux sont instaurés dans des circonstances précises. Cependant, la difficulté de fond est toujours là : l’ordre international reste construit sur des États souverains ; rien — et notamment le recours à la force — ne peut avoir lieu sans leur accord, leur coopération, bref leur volonté.
Du Traité de Versailles aux tribunaux de Nuremberg et de Tokyo
À l’issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles introduit, dans les relations internationales, une novation redoutable. Il déclare l’Allemagne coupable des dégâts de la guerre : « L’Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés » (article 231). Le traité pose le principe d’une inculpation et d’un jugement de dirigeants allemands, et d’abord de Guillaume II : « Les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités » (article 227). Derrière ces dispositions, que de questions terribles : la guerre, phénomène politique par excellence, peut-elle être transposée sur un terrain moral ? Au nom de quel principe, sinon celui du plus fort, le vainqueur peut-il affirmer incarner le bien et faire du vaincu le mal ? Un peuple peut-il être responsable collectivement ? Comment un chef d’État peut-il être coupable de faire la guerre, alors que la guerre fait partie des compétences fondamentales de l’État souverain et surtout que la détermination de l’agresseur suscite des controverses sans fin (en ce qui concerne la Grande Guerre et le rôle de l’Allemagne, le débat est toujours vivant chez les historiens) ?
Il reste 80 % de l'article à lire
Plan de l'article