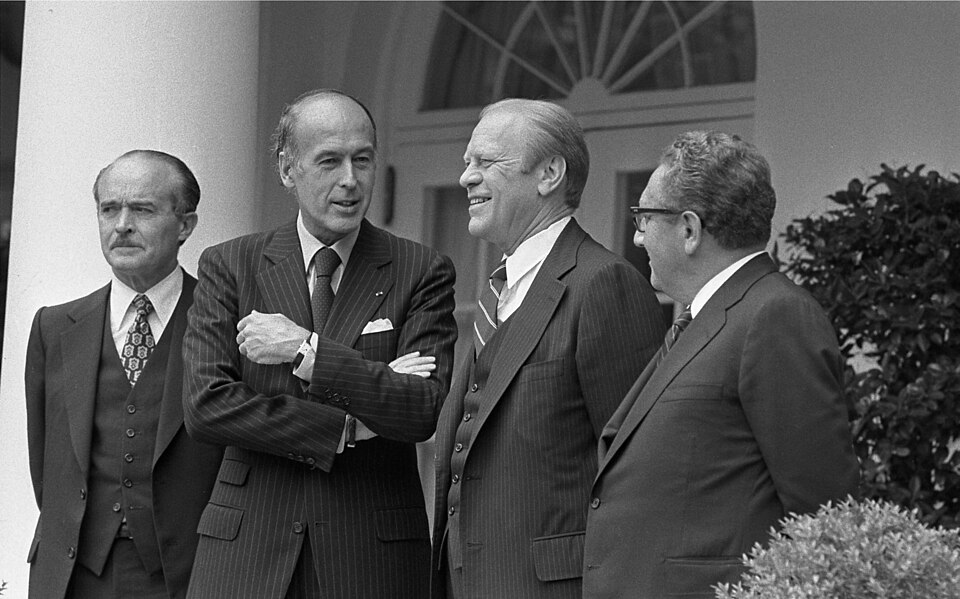Nucléaire - Le Projet Manhattan
Il y a 65 ans le monde venait d’entrer dans une ère nouvelle : l’ère nucléaire (on disait alors atomique). Le 6 août 1945, une seule bombe, dite bombe A, d’un type nouveau et d’une puissance sans précédent, raye de la carte en quelques secondes une grande ville japonaise, Hiroshima, tuant quasi instantanément 80 000 personnes, 10 000 autres étant portées disparues. Près de 70 000 habitants sont irradiés à divers degrés. Le monde découvre non seulement les effets destructeurs de cette arme, mais aussi les effets de l’irradiation sur l’homme, effets jusque-là peu, voire pas du tout, connus.
L’ère nucléaire a commencé, véritablement le 2 décembre 1942, lorsque pour la première fois au monde une réaction en chaîne auto-entretenue est observée dans un réacteur nucléaire (on disait alors pile atomique). C’est la pile CP-1, réalisée à Chicago par Enrico Fermi (1901-1954), aidé par Léo Szilárd (1898-1964). Petite pile presque artisanale – sorte de cube de 6 mètres de côté étayé à l’aide de poutres en bois – formée en empilant sous les tribunes du Stagg Field (stade universitaire) 50 000 briques de graphite pur (385 tonnes) comme ralentisseur de neutrons, 6 tonnes d’uranium métal (des blocs de deux kilos chacun), 37 tonnes d’oxyde d’uranium UO2 et des barres de cadmium pour piloter la pile.
Si la pile CP-1 délivre une puissance très faible – 200 Watts au plus – son importance dans l’histoire des sciences est capitale. La divergence de cette pile, le 2 décembre à 15 h 25, marque d’une part le début de l’utilisation, pacifique ou guerrière, de l’énergie tirée de l’atome, d’autre part le départ de la course à la bombe atomique aux États-Unis, course plus connue sous le nom de Projet Manhattan. En effet, les États-Unis veulent posséder une bombe atomique opérationnelle avant l’Allemagne pour l’utiliser contre ce pays. L’Allemagne a cependant déjà perdu cette course, ce que les Américains semblent ignorer (1). Le Projet Manhattan est lancé dans le plus grand secret en novembre 1942, sous la direction scientifique du physicien Robert Oppenheimer (1904-1967) et du général du Génie de l’US Army Leslie Groves (1896-1970) pour la logistique, les infrastructures, les rapports avec les autorités militaires, la sécurité (contre-espionnage) et la planification d’emploi des bombes fabriquées. Officiellement, c’est le 15 avril 1943 que commencent les divers travaux (recherches fondamentales et appliquées, fabrication, etc.) sur cet engin, avec une petite équipe de 50 scientifiques rassemblés par Oppenheimer ; 2 000 autres savants ne vont pas tarder à se joindre à cette première équipe.
Il reste 87 % de l'article à lire
Plan de l'article




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)