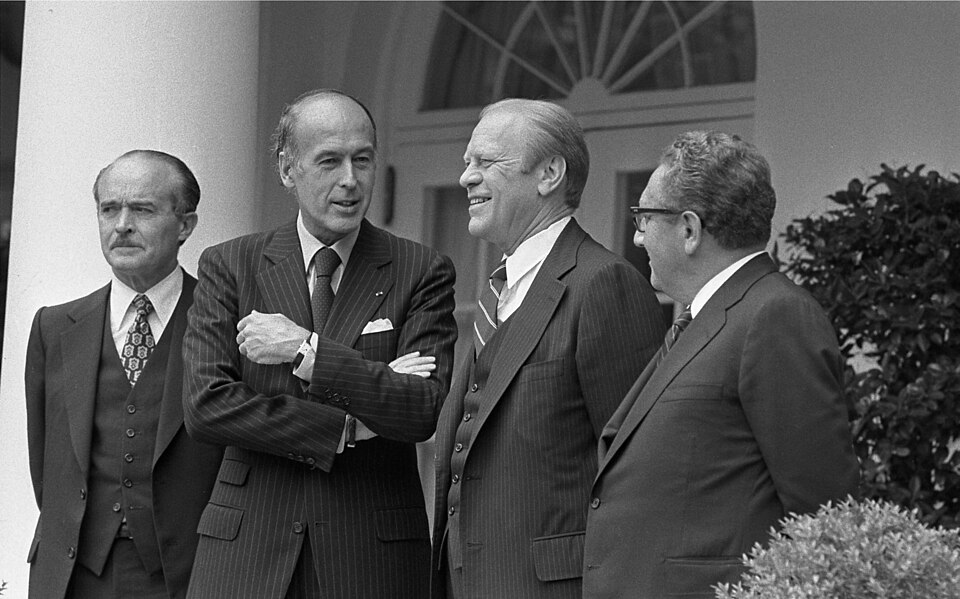Le Maréchal Leclerc en 1944 (© Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque)
Tout comme l’art, l’exercice du commandement est assujetti au contexte de son époque et demeure en constante évolution face aux bouleversements qui opèrent dans la société ou l’institution militaire. La figure contemporaine et édifiante du Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque permettra d’étayer de manière contextuelle et vraisemblable du fait de la relative proximité historique, en quoi réside l’art du commandement, le contexte dans lequel il s’inscrit et les défis qui se posent à son exercice de nos jours.
Command: The Example of Leclerc (T 1247)
Just like art, the exercise of command is subject to the context of its time and remains constantly evolving in the face of the upheavals that operate in society or the military institution. The contemporary and edifying figure of Marshal Philippe Leclerc de Hauteclocque will make it possible to support in a contextual and plausible way because of the relative historical proximity, in what lies the art of command, the context in which it takes place and the challenges facing its practice nowadays.
Loin de la fiche de tâche ou du manuel exhaustif et procédural, l’exercice du commandement et plus particulièrement celui militaire s’appuie sur un équilibre subtil, une alchimie dont les ingrédients et leurs proportions échappent en partie à une logique mathématique et objective. D’Alexandre le Grand au général de Gaulle, les grands chefs historiques témoignent pourtant de l’existence d’un socle commun de qualités et d’aptitudes qui participent pleinement à la discrimination des hommes dans le succès des armes. L’art est ainsi fait. S’appuyant non seulement sur une maîtrise des savoirs et des techniques, il se bâtit également sur les attributs innés et naturels des individus, des qualités qui, à défaut de pouvoir être inoculées, se développent et enfin se révèlent dans un contexte favorable. L’art du commandement, littéralement « l’ensemble des procédés, des connaissances et des règles servant à donner des ordres » repose donc, d’une part, sur des logiques conceptuelles et relativement maîtrisées héritées de notre histoire et dont le général de Gaulle dira qu’elles sont « la véritable école du commandement » (1) et, d’autre part, sur des qualités individuelles difficilement identifiables ou quantifiables.
Tout comme l’art, l’exercice du commandement est assujetti au contexte de son époque et demeure en constante évolution face aux bouleversements qui opèrent dans la société ou l’institution militaire. La figure contemporaine et édifiante du Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque permettra d’étayer de manière contextuelle et vraisemblable du fait de la relative proximité historique, en quoi réside l’art du commandement, le contexte dans lequel il s’inscrit et les défis qui se posent à son exercice de nos jours.
Les piliers du commandement
La justesse et la pertinence du commandement se fondent avant tout sur une matière première que tout donneur d’ordre doit chérir : la connaissance. Seule la connaissance procure au chef la capacité de discernement dans la tourmente des événements, la légitimité aux yeux des subordonnés et la confiance de sa hiérarchie. Cette connaissance est multiple ; elle est basée tout aussi bien sur le retour d’expérience des batailles que sur la maîtrise de ses propres capacités, sur le renseignement en provenance de l’ennemi ou l’expérience personnelle. La faculté d’un chef à pouvoir sans cesse mettre en perspective les événements à travers l’éclairage du passé et les informations collectées dans le présent est un facteur déterminant dans tout exercice de commandement. La maxime séculaire de Sun Tzu « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même » demeure d’actualité malgré la complexité croissante des technologies et l’avènement du cyberespace comme nouveau terrain d’affrontement.
Il reste 88 % de l'article à lire
.jpg)





_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)