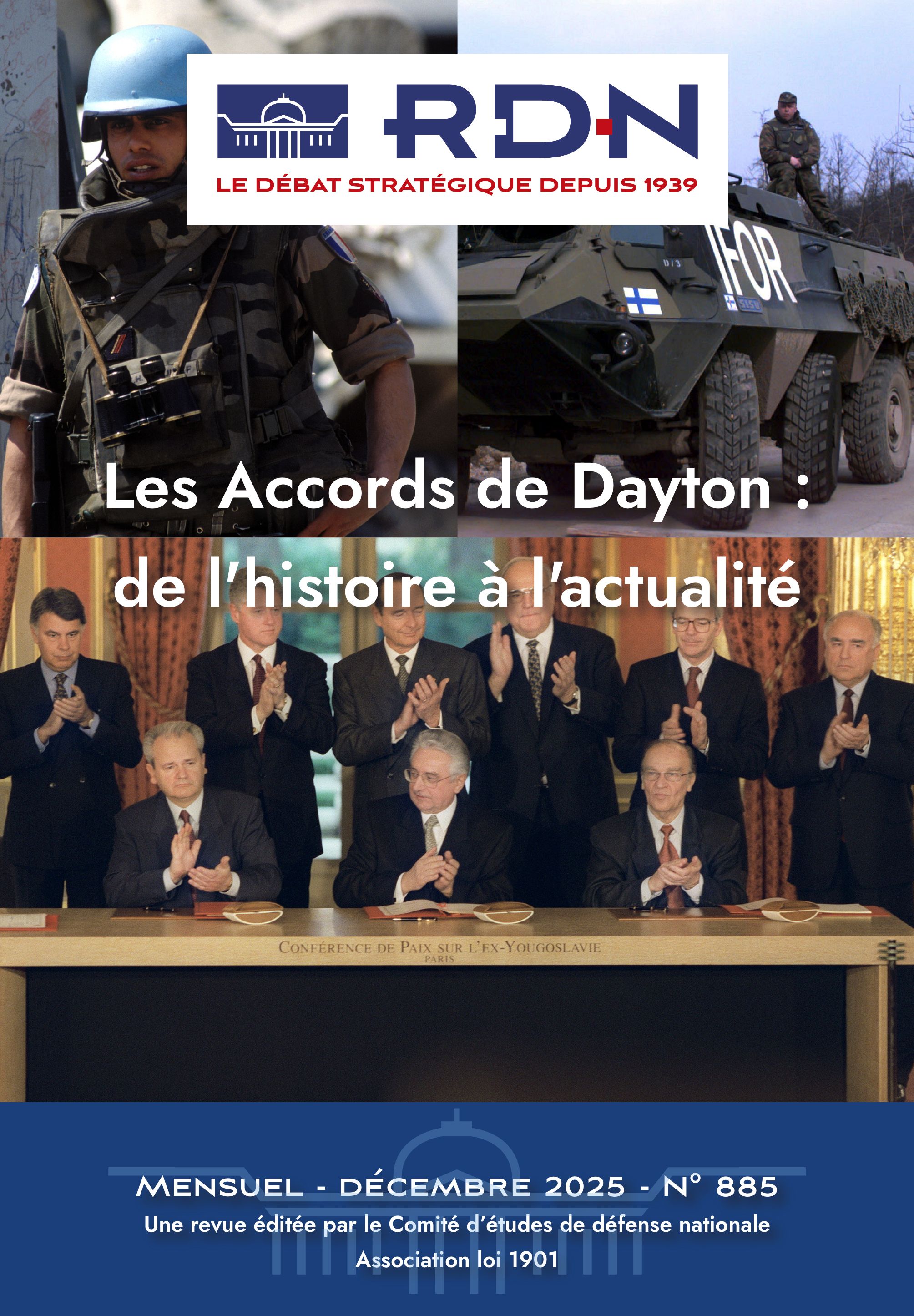Présentation du monument sur le site Internet de l’agence publique polonaise Niepodlegla.
Un monument récent édifié en Pologne met en lumière quatre personnages ayant contribué à construire l’État polonais après la Première Guerre mondiale. Un Polonais (le maréchal Pilsudski), un Hongrois (Pal Teleki), un Ukrainien (Symon Petlioura) et un Français, le capitaine Charles de Gaulle. Certes, celui-ci fut envoyé à sa demande auprès des troupes polonaises luttant contre les forces bolcheviques de Moscou. Toutefois, son rôle reste celui d’un officier subalterne, alors même que le général Weygand fut le chef de la mission conjointe franco-britannique auprès du gouvernement de Varsovie. La mise en valeur du futur chef de la France libre obéit plus à une relecture politique de l’histoire plutôt qu’à une réalité militaire, mais elle démontre le besoin existentiel de la Pologne de rappeler son attachement viscéral à l’Europe occidentale face à la menace russe toujours perçue comme un fait stratégique structurant la défense du pays depuis toujours.
De Gaulle and Poland: Reflections on the Skierniewice Monument (T 1249)
A recent monument erected in Poland highlights four figures who contributed to building the Polish state after the First World War. A Pole (Marshal Pilsudski), a Hungarian (Pal Teleki), a Ukrainian (Symon Petlioura) and a Frenchman, Captain Charles de Gaulle. Admittedly, he was sent at his request to the Polish troops fighting against the Bolshevik forces in Moscow. However, his role remains that of a junior officer, even though General Weygand was the head of the joint Franco-British mission to the government in Warsaw. The highlighting of the future leader of Free France obeys more a political rereading of history rather than a military reality, but it demonstrates Poland's existential need to recall its visceral attachment to Western Europe in facing the Russian threat still perceived as a strategic fact that has always structured the country's defense.
Le 11 novembre 2020, le vice-Premier ministre et ministre de la Culture polonais Piotr Glinski a inauguré un monument érigé dans la ville polonaise de Skierniewice. Ce monument « exprime la gratitude aux peuples qui ont, il y a cent ans, soutenu la Pologne dans son combat contre les Bolcheviques » et notamment lors de la décisive bataille de Varsovie en août 1920 (1). Selon le sculpteur, quatre personnalités, présentées grandeur nature et en bronze, symbolisent cette lutte : de gauche à droite : Charles de Gaulle (France), Jozef Pilsudski (Pologne), Symon Petlioura (Ukraine) et Pal Teleki (Hongrie).
Historiquement, il est exact que les quatre personnages ont combattu les Bolcheviques dans les années 1919-1920. Pilsudski et Petlioura aussi bien politiquement que militairement ; Teleki, politiquement – bien que Béla Kun ait menacé l’existence de la Hongrie par son insurrection bolchevique (instauration d’une République des conseils de Hongrie du 21 mars au 1er août 1919). Le soutien hongrois et ukrainien à la défense de Varsovie a été bien moins efficace que celui de la France, pour des raisons évidentes. Le capitaine de Gaulle a participé « techniquement » à la mise sur pieds d’une structure militaire polonaise lors de son premier séjour d’avril 1919 à mai 1920 au sein de la Mission militaire française (MMF). Il a également été sur le champ de bataille comme un des conseillers de groupe d’armées polonais lors de son second séjour de juin 1920 à la fin du mois de janvier 1921. Mais c’est le général Henrys qui était à la tête de la MMF tandis que le général Weygand était le conseiller technique de la mission franco-anglaise (lancée en juillet 1920 à l’initiative du britannique Lloyd George) auprès du Haut Commandement polonais. Et c’est le président du Conseil Georges Clemenceau en 1919 qui a pris la décision politique de soutenir sérieusement et efficacement la Pologne, décision confirmée par son successeur, Alexandre Millerand en 1920. Donc, du point de vue strictement historique, ce sont d’abord Clemenceau, Henrys et Weygand qui mériteraient d’être honorés.
Alors, y a-t-il une autre symbolique à cette œuvre, par le choix des personnages et faire ainsi le lien entre 1920 et 2020 ? Voulait-on toucher le passant en lui rappelant le passé et l’amener à réfléchir sur le présent ? Par conséquent, d’imaginer l’avenir de cet espace immense qui va de l’Atlantique jusqu’au Pacifique ? L’auteur de ces lignes pense que oui !
Il reste 73 % de l'article à lire
.jpg)