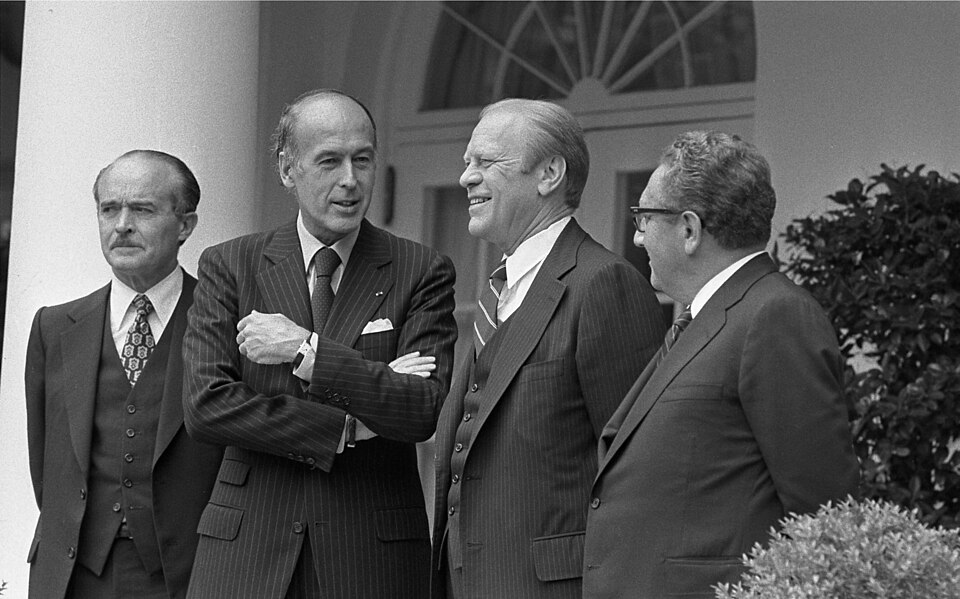Le Deep Web ou « Web profond », parfois « Web caché », représenterait, selon certaines estimations, plus de 96 % de l’Internet actuel. Un article de deux chercheurs associés à l'Institut d'étude des crises de l'intelligence économique et stratégique (IEC-IES) qui cherche à recentrer le débat sur les enjeux liés au Deep Web et au Dark Web, à l'heure où les questions sur le cyberespace prennent de plus en plus d'importance.
Demystifying the Deep Web and the Dark Web (T 1259)
The Deep Web, sometimes "hidden Web", would, according to some estimates, represent more than 96% of the current Internet. An article by two researchers associated with the Institute for the Study of Economic and Strategic Intelligence Crises (IEC-IES) which seeks to refocus the debate on issues related to the Deep Web and the Dark Web, at a time when cyberspace issues are becoming increasingly important.
Le Deep Web ou « Web profond », parfois « Web caché », représenterait, selon certaines estimations, plus de 96 % de l’Internet actuel. Défini en 2001 par Michael K. Bergman (1) par opposition au « Web surfacique » ou « référencé », ce terme rassemble toutes les données non accessibles facilement avec les moteurs de recherche usuels, c’est-à-dire non référencés dans leurs bases. Ces moteurs traditionnels, que les internautes utilisent quotidiennement, ne réussissent à atteindre que les données indexées par ceux-ci, occultant ainsi la plus grande majorité des informations contenues sur les réseaux informatiques.
Le Web profond incorpore, par exemple, l’e-mail, les conversations privées avec des messageries sécurisées comme WhatsApp, Telegram ou Signal, les contenus à accès limité ou payant, les forums protégés par des mots de passe ou encore les données contenues sur des réseaux privatifs d’entreprise, les « Intranets ». De nombreuses pages Internet référencées par les moteurs de recherche usuels contiennent ce type de support non référencé. Ces données protégées par un simple mot de passe ou parfois chiffrées plus fortement, peuvent receler des informations précieuses allant de la protection de la vie privée d’une personne à des informations stratégiques concernant des entreprises privées, voire des États. Dossiers médicaux, rapports scientifiques ou ressources gouvernementales constituent quelques exemples concrets de documents pouvant être trouvés sur cette partie de la toile.
Le Web profond est constitué par un ensemble de données qui ne sont pas accessibles via les moteurs de recherche habituels pour différentes raisons : besoin de protéger la vie privée, choix technologiques ou encore volonté de rentabiliser un site Internet en limitant son accès. Ainsi, les chercheurs Chris Sherman et Gary Price ont proposé de diviser le Deep Web en quatre aires (2).
Il reste 84 % de l'article à lire
.jpg)

.jpg)