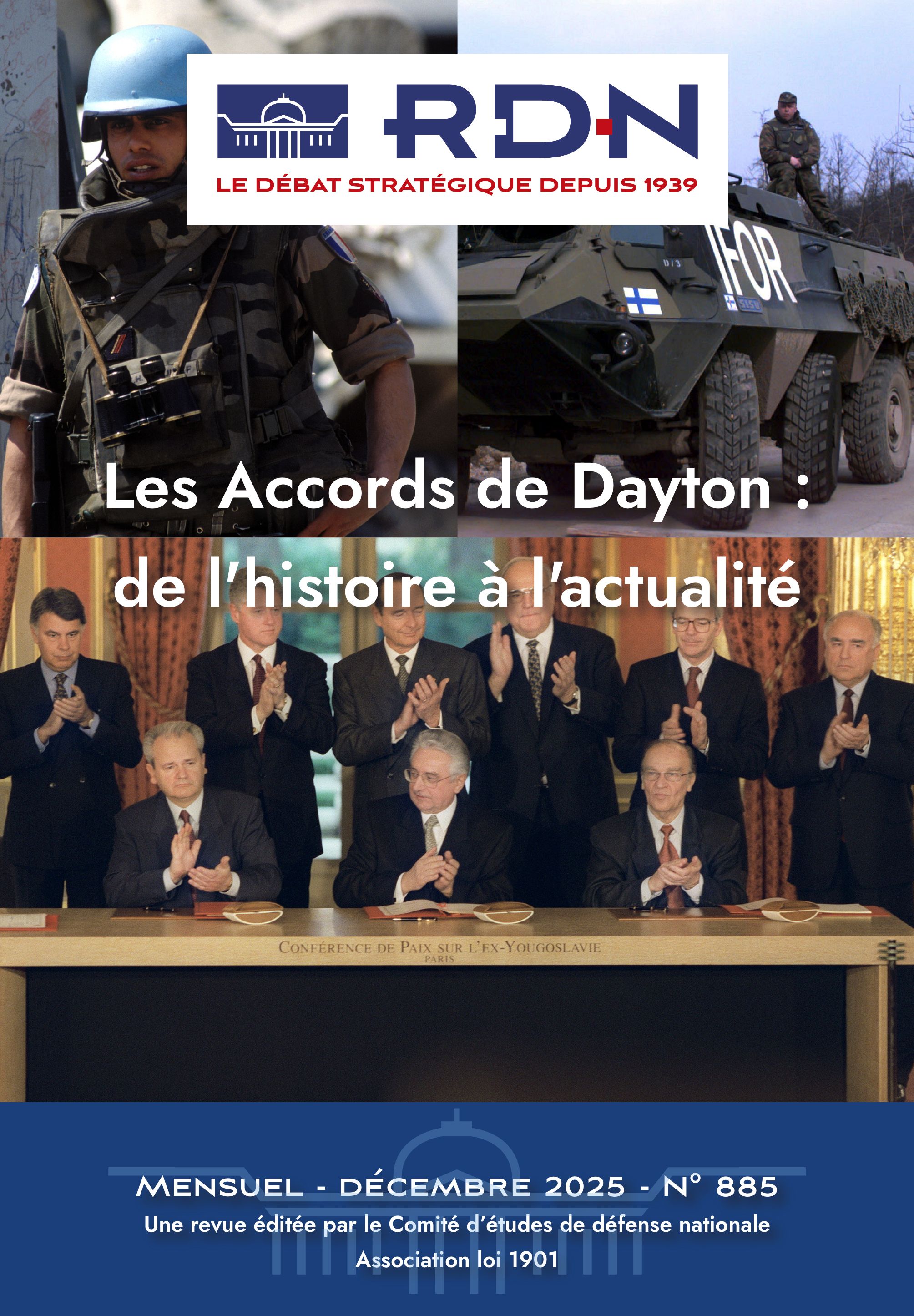(© Erica Guilane-Nachez / Adobe Stock)
Jean-Philippe Immarigeon analyse le film de Mathieu Vadepied, Tirailleurs, sorti le 4 janvier 2023 ainsi que les débats qui en résultent. Si le contexte de sortie du film n'est pas le même que celui d'Indigènes, l'auteur regrette que le récit soit passé à côté de thématiques non traitées dans le cinéma français. L'ombre de « l'américanisation » des combats sociétaux plane sur ce film, alors qu'historiquement, le traitement des soldats était largement différent d'une part et d'autre de l'Atlantique.
Il y a seize ans, le film Indigènes (Rachid Bouchareb, 2006) nous rappelait l’injustice subie par les troupes coloniales réquisitionnées dans la lutte contre le nazisme, mais ne centrait pas son propos sur la colonisation elle-même. Tirailleurs (Mathieu Vadepied, 2022) prétend au contraire en faire son sujet, mais n’en déplace pas moins dans les tranchées « ceux qui allaient mourir en Europe pour le Droit, la Liberté et bien d’autres choses encore, dont ils n’avaient jamais entendu parler avant qu’un administrateur colonial vînt, au nom de la République, planter un drapeau sur la place du village (1) ». Or, si la colonisation est une entreprise de pillage accompagnée du refus de reconnaître des droits aux conquis, c’est cela qu’il faut questionner. Tirailleurs se contente d’une scène introductive de chasse à l’homme, allusion limpide à la Traite, pour illustrer une conscription forcée prévue par un décret de 1912 qui n’était lui-même qu’une des facettes du Code de l’indigénat, cet apartheid français qu’il faudra un jour traiter (2), comme l’était le travail forcé que ce soit pour construire la ligne Congo-Océan ou plus tard, sous drapeau de la France Libre, assurer la production de caoutchouc pour les Alliés.
Néanmoins, une fois dans les tranchées de l’Argonne, à Craonne ou aux Éparges, ce sont les mêmes conditions de combat, les mêmes assauts pour « grignoter » les Boches, la même vermine et les mêmes rats, la même boue de cadavres en décomposition, et des pieds qui pourrissent tout autant dans des godillots qu’on n’enlève jamais, qu’on soit Peul ou Breton, Tonkinois ou Kabyle. Et si le Code de l’indigénat et le Code noir établirent un statut personnel, il ne pesait sur l’indigène ou l’esclave que dans les colonies et disparaissait, même au XVIIIe siècle dès qu’il posait le pied sur le territoire métropolitain. C’est une spécificité française, ça s’appelle le Droit du sol et ça date de l’Édit du 3 juillet 1315 ! Or, Tirailleurs use visiblement pour raconter cet épisode de notre singulière Histoire de France de la grille de lecture d’une Amérique qui n’a ni le même passé ni les mêmes valeurs, qui a connu jusque récemment l’esclavage à domicile puis la ségrégation, et qui n’a pas attendu l’époque récente pour assigner chaque individu à ses origines supposées (3). Les deux logiciels sont incompatibles, et on le comprend en revenant sur un incident fort éclairant, contemporain des faits qui servent de toile de fond à Tirailleurs, qui révéla le gouffre qui sépare la France des États-Unis sur la « question ethno-raciale » – pour reprendre une expression du ministre de l’Éducation nationale.
Choc de civilisations
Le colonel d’artillerie Linard, polytechnicien de formation, avait été nommé, sous les ordres du général Ragueneau, chef d’état-major de la Mission militaire française auprès du Corps expéditionnaire du général Pershing. C’est à ce titre qu’il fut confronté à des remarques de moins en moins amènes sur le comportement de ses compatriotes à l’encontre des soldats noirs, africains ou américains. Petit retour en arrière : lors de leur entrée en guerre en 1917, la ségrégation est à son apogée aux États-Unis. Les lois dites Jim Crow (1877) et un arrêt de la Cour suprême (Plessy v. Ferguson, 1896) l’avaient légalisée ; elle ne sera abolie qu’en 1964. Le Ku Klux Klan semait la terreur dans les États du Sud, à l’épouvante d’une presse européenne qui s’en faisait l’écho (4). Aussi, les Afro-Américains s’enrôlent-ils en masse pour échapper à cette situation. Les autorités rechignent à les incorporer, puis les versent dans le Service of Supply sans les envoyer tous outre-mer : sur quatre cent mille, il n’y en a que cent mille en France relégués à l’arrière, dans les ports et les dépôts. On leur refuse de servir dans les unités combattantes, il est hors de question que des régiments soient mixtes. La situation se reproduira en 1944.
Il reste 86 % de l'article à lire
.jpg)