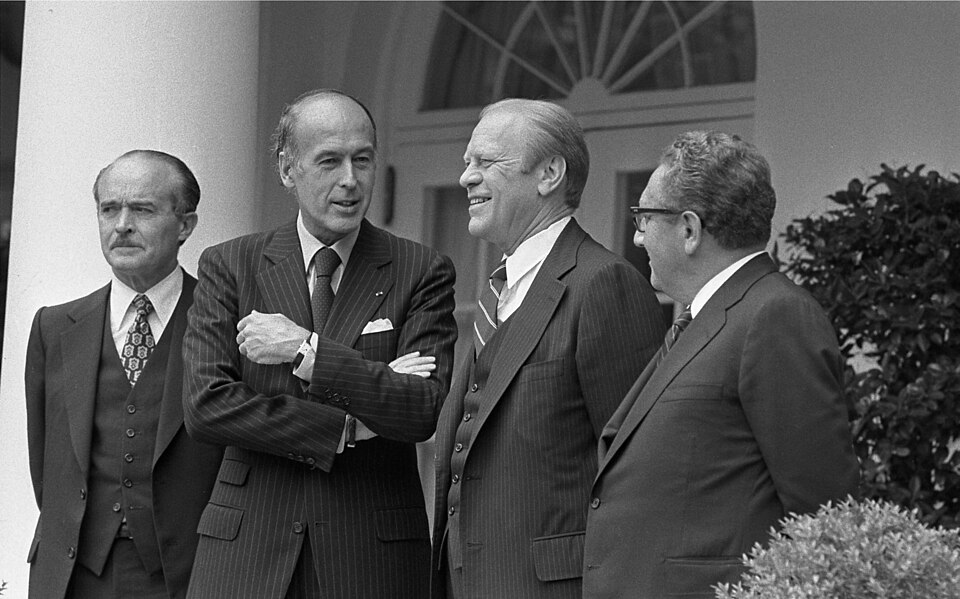Le president Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères du Barheïn, le Premier ministre israélien et le ministre des Affaires étrangères des Émiras arabes unis signent les accords d’Abraham le 15 septembre 2020 à la Maison Blanche
Dans ce nouveau focus d'actualité, l'ambassadeur Bertrand Besancenot revient sur les accords d'Abraham et leur acceptabilité, près de 3 ans après leur signature, par les populations des pays arabes concernés par la nouvelle normalisation des relaions avec l'État hébreu.
Depuis des semaines, le ministre israélien de l’énergie s’active sur tous les fronts pour promouvoir ce qui semble être devenu un volet majeur de sa politique régionale : fournir ses voisins arabes en eau et en énergie, avec en toile de fond l’objectif de cimenter les relations. Israël Katz vient notamment d’annoncer que son pays allait augmenter les exportations de gaz vers l’Égypte, qui a vu sa production chuter de 12 % en deux ans. Il s’est surtout rendu à Abou Dabi pour avancer sur l’un des sous-produits des accords d’Abraham : un accord trilatéral selon lequel Israël doit exporter de l’eau désalinisée vers la Jordanie qui, en échange, lui fournira de l’électricité solaire via un champ de panneaux photovoltaïques financé par les Émirats arabes unis (EAU).
Alors qu’un premier protocole d’accord avait été ratifié en 2021, puis un second à la COP 27 de Charm-el-Cheikh l’année suivante, les trois parties prévoient, cette fois, de finaliser sa signature lors de la COP 28 qui se tiendra fin novembre à Dubaï. Pour les Émiriens, il s’agit avant tout de vendre leur image en montrant qu’ils participent à une initiative verte, à trois mois de la COP 28. Masdar est l’entreprise chargée de la construction du champ de panneaux solaires, dirigée par ailleurs par Sultan Al Jaber, PDG de l’ADNOC. Cette dernière doit partager les 180 millions de dollars annuels de gains à égalité avec la Jordanie.
En recevant 200 millions de mètres cubes d’eau par an d’Israël en échange de 600 Megawatts d’électricité solaire, le Prosperity Project ressemble plus à un accord de survie pour la Jordanie, composée à 92 % de terres désertiques et qui présente l’un des stress hydriques les plus élevés au monde. Un autre accord de la sorte, le Red Sea-Dead Sea, avait de surcroît été enterré cinq mois auparavant, en juin 2021. Le projet consistait à transporter de l’eau de la mer Rouge via un pipeline prévu pour relier la ville côtière jordanienne d’Aqaba jusqu’à la région de Lisan dans la mer Morte, dont le niveau ne cesse de baisser depuis plusieurs années. Au passage, il devait aussi augmenter la fourniture d’eau désalinisée à Israël et à la Cisjordanie. Des doutes avaient toutefois été émis sur le coût du projet, ainsi que sur son impact environnemental.
Il reste 78 % de l'article à lire
.jpg)




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)