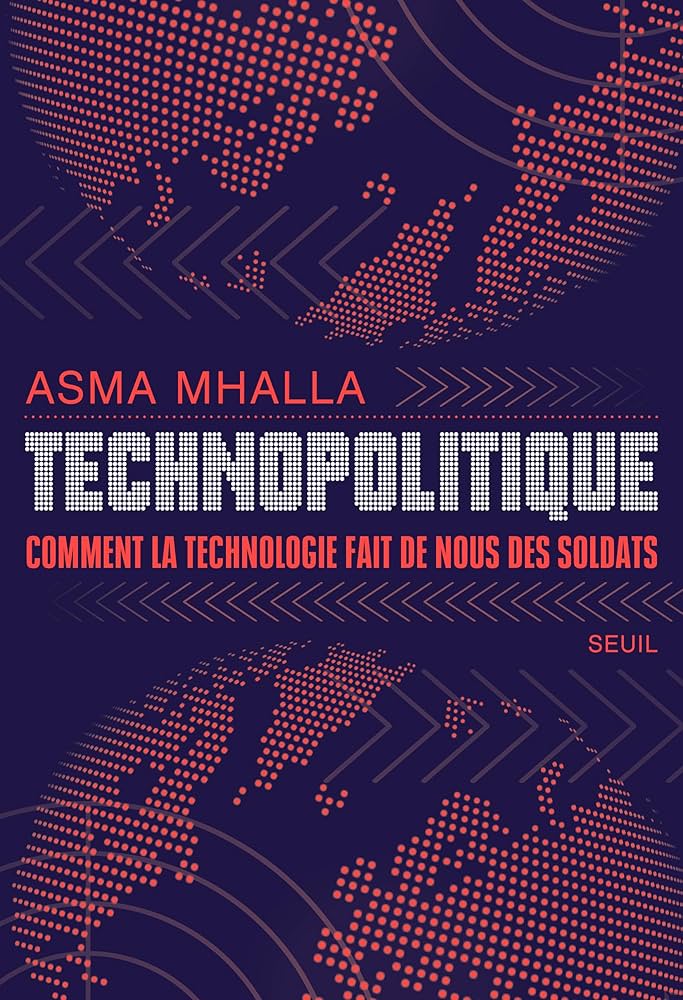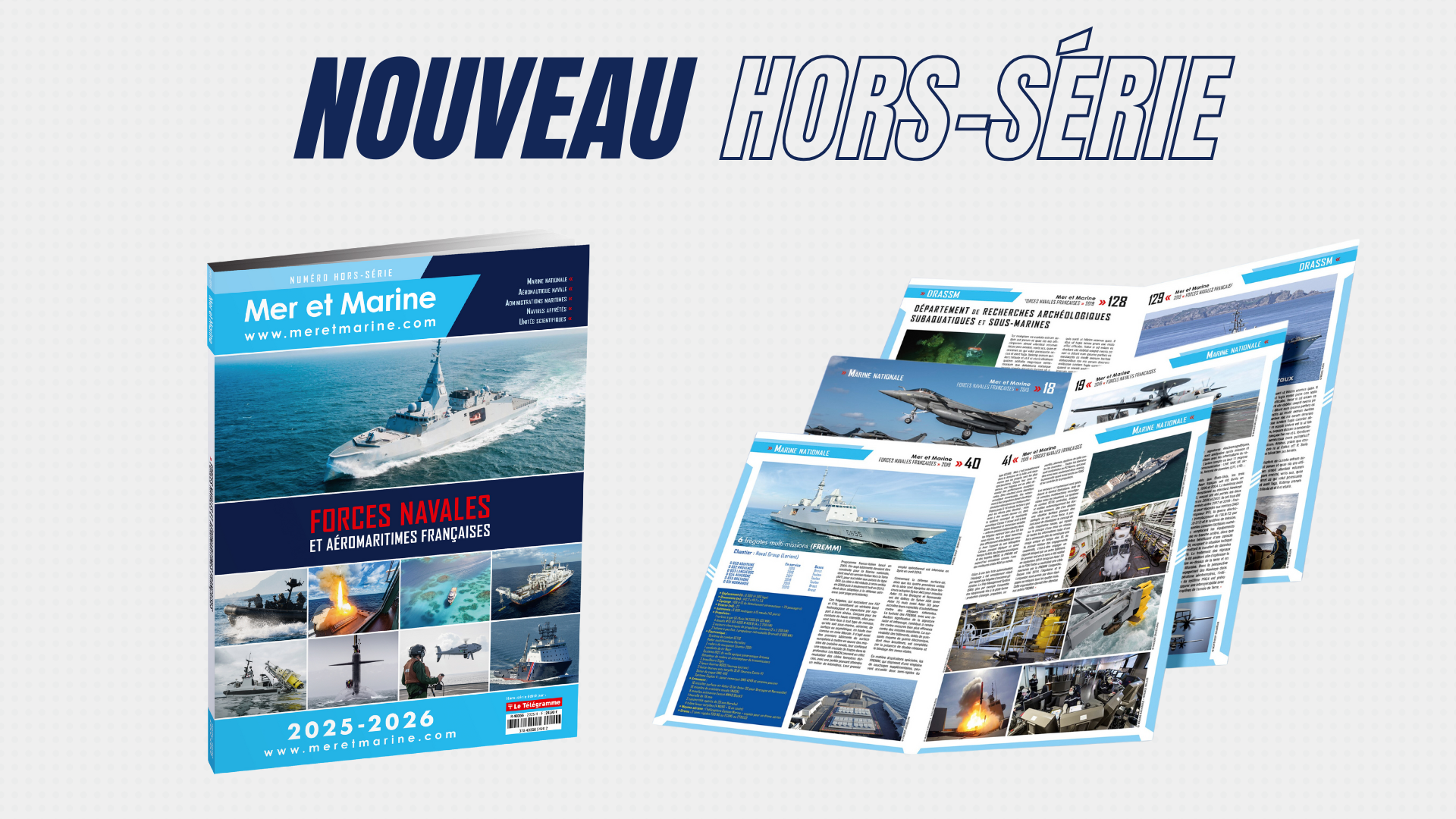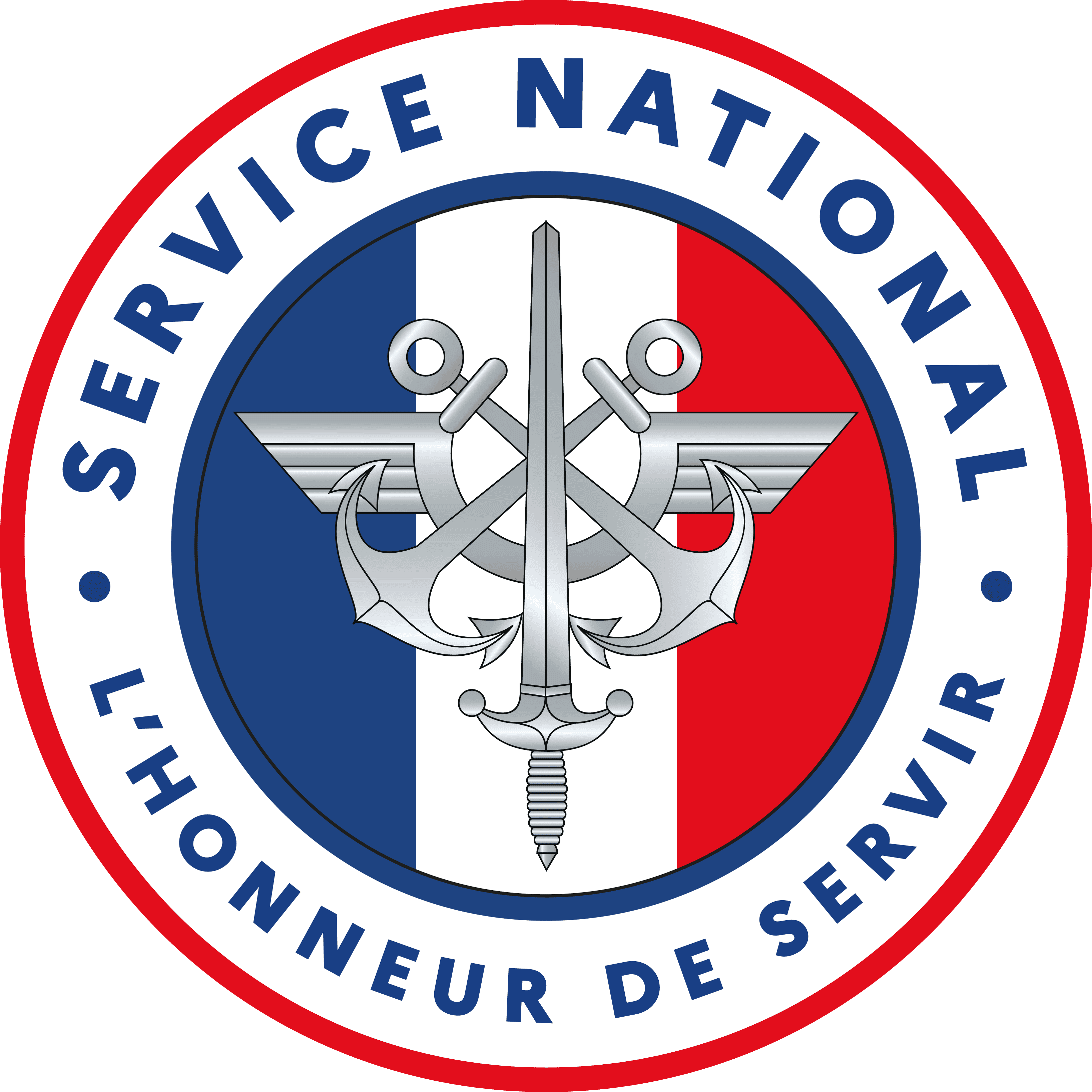Thibault Lavernhe et Eugène Berg donnent leur analyse de l'ouvrage d'Asma Mhalla, Technopolitique. Si l'un voit en cet ouvrage un plaidoyer pour concilier démocratie et technologie, l'autre considère que nous sommes entrés dans une ère d'affrontement technologique.
La question du lien entre technologie et politique n’est pas nouvelle, mais force est de constater que l’accélération galopante du progrès technologique, depuis deux décennies, donne un relief nouveau à cette problématique. Avec Technopolitique, Asma Mhalla, politologue spécialiste des enjeux technologiques, s’empare du sujet en posant la notion de « technologie totale » et en s’interrogeant sur la manière dont le modèle démocratique peut trouver, face à la puissance d’une technologie omnipotente qui irrigue tous les compartiments du pouvoir, un point d’équilibre entre tentation techno-autoritariste et préservation des libertés individuelles.
Incarnée par le tandem Big State et Big Tech, la « technologie totale » fragilise, selon l’auteur, les fondements du modèle démocratique occidental : son caractère englobant ferait en effet sauter les lignes de partage entre sphère privée et sphère publique, entre État et entreprises, entre masse et individus, pour aboutir à un paysage bouleversé dans lequel les démocraties évoluent désormais sur une ligne de crête qui engage leur avenir. Pour bien cerner les enjeux auxquels font face les sociétés occidentales, l’auteure propose une plongée dans le monde des Big Tech, ces structures techno-économiques dont l’empire d’Elon Musk (SpaceX, Tesla, Neuralink, X) est un des symboles les plus aboutis. En analysant les moteurs économiques, technologiques et idéologiques de ces nouveaux acteurs dont le poids politique – voire diplomatique – est indéniable, l’auteure montre comment les Big Tech sont devenus à bien des égards un prolongement de certains États. En parallèle, l’essai s’attache à montrer comment l’État issu du modèle démocratique occidental est désormais contourné à la fois par le haut (par le poids des Big Tech affranchis des frontières) et par le bas (par l’effet polarisant des réseaux sociaux et par l’atomisation d’une société où les corps intermédiaires ne jouent plus leur rôle stabilisateur), voyant parfois son pouvoir et sa légitimité remises en cause. La tentation, pour certains États, pourrait être alors de tirer parti du levier technologique pour s’imposer à l’extérieur et rétablir un contrôle sur sa société à l’intérieur, affaiblissant dans le même temps la source de sa légitimité : c’est l’écueil du Big State, qui étoufferait sous son pouvoir normatif et ses capacités de surveillance, au nom de la sécurité, les dernières parcelles de liberté propres au modèle démocratique. Reste alors les individus, coincés entre Big State paternaliste et Big Tech cynique, dont l’auteure estime que les cerveaux seraient devenus, par la force des choses, l’ultime champ de bataille. Dans ce contexte où les démocraties sont sommées de s’adapter pour éviter un choix binaire entre la disparition et la bascule dans un modèle techno-autoritaire, Technopolitique se positionne comme un plaidoyer pour concilier démocratie et technologie.
Si le propos est plutôt pertinent, on peut en revanche regretter le style parfois ampoulé de l’essai, qui rend sa lecture difficile. Les analyses factuelles et documentées, bien menées dans l’ensemble, sont émaillées de digressions pseudo-philosophiques qui alourdissent le propos. Surtout, Technopolitique regorge de néo-logismes et de produits de la novlangue (« totalisme », « visibiliser », « cognition », etc.) dont le lecteur, arrivé au bout de l’ouvrage, aurait aimé faire l’économie.
Il reste 73 % de l'article à lire
.jpg)