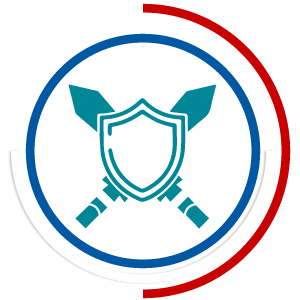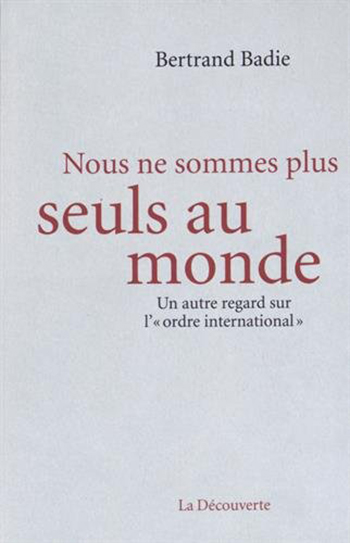
Professeur des Universités à Sciences Po Paris, auteur d’une vingtaine d’ouvrages de référence, Bertrand Badie fait figure d’un des analystes les plus pénétrants des relations internationales en France. En cette année 2016, au moment où la conjoncture internationale est d’une rare complexité, comme elle ne l’a jamais été depuis soixante-dix ans, quel regard porte-t-il sur le monde ?
Sa réflexion commence d’abord sur l’« ordre mondial » ou ce qui en tient lieu, s’agissant plutôt pour lui d’une anarchie internationale. Mais le concept même d’ordre international est-il vraiment opératoire ? En vérité, il ne s’est jamais agi d’un ordre fixe, durable ; mais plutôt d’une succession de rapports de forces, d’équilibres globaux, régionaux ou partiels qui ont varié dans le temps à mesure des modifications intervenues dans la constellation des rapports de force. Il suffira de voir, que durant l’époque de l’ordre dit bipolaire, qui régna durant la guerre froide (1947-1989), les diverses guerres et conflits ont provoqué 33 millions de morts ! Il se livre sur ce point à de stimulantes réflexions en mettant à nu les concepts si souvent utilisés de bipolarité, d’unipolarité et de multipolarité.
Retenons la distinction qu’il fait entre polarité et polarisation : la première décrivant une juxtaposition de puissances sans pour autant qualifier leurs relations. La polarisation suppose une confrontation potentielle et réelle : c’est ce qui a opposé les États-Unis à l’URSS de 1947 à 1989. On trouve donc toute une gamme de cas de figure allant de la coexistence, de la juxtaposition à la compétition ou à l’affrontement direct ou indirect. Une telle analyse est tout à fait pertinente et peut servir à qualifier les rapports américano-soviétiques ; puis américano-russes. En deux années, du début 2014, au voyage de John Kerry à Moscou le 24 mars 2016, n’est-on pas passé d’un affrontement (au moins verbal et en sous-main) à une forme nouvelle de coopération (dans la lutte contre le terrorisme et Daech), laissant en place des traces de compétition sur l’Ukraine. Si l’on revient sur le moment exceptionnel de l’unipolarité américaine, elle n’aura duré que moins de cinq années, de la chute du mur de Berlin aux bombardements de l’Otan sur la Serbie qui marquèrent le retour progressif de l’antagonisme russo-occidental.
Mais surtout, Bertrand Badie s’en prend résolument à l’« ancien ordre mondial », en clair celui des grandes puissances, par essence inégalitaire, car oligarchique. Or démontre-t-il avec brio, il est désormais bien révolu le temps où les « grands » pouvaient imposer leur loi. C’est là chez lui une de ses convictions les plus ancrées, puisqu’il n’a cessé de la développer tout au long de ses écrits et de ses enseignements. L’idée est fort louable, mais peut-il nous fournir un exemple d’une époque un tant soit peu durable au cours de laquelle régna un ordre « égalitaire, inclusif, démocratique » ? La scène internationale plus encore que la scène politique nationale est celle où se déploient les puissances, dont la hiérarchie a été maintes fois analysée et mise à l’épreuve. Aristote, n’avait-il pas vu qu’au sein de toute société humaine, à fortuit de notre société planétaire, se mêlaient éléments autocratiques, aristocratiques et démocratiques. Il est peut-être salutaire de rêver à une véritable démocratie internationale. Mais le poids de Nauru, ne sera jamais celle de la Chine, même si chacun dispose d’une voix à l’Assemblée générale.
Mais on sait bien qu’au sein de l’ONU, ce n’est pas l’Assemblée générale, mais le Conseil de sécurité qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il paraît difficile pour le moment aux relations internationales d’échapper au concept de « concert des nations » qui s’est épanoui durant des siècles sur le continent européen. Pour ne prendre que l’exemple du conflit syrien ne voit-on pas, phénomène que salue d’ailleurs Bertrand Badie, que l’effort de Moscou a été de remettre en place une forme de bipolarité américano-russe, mise en place en 1967 à Glassboro, rappelle-t-il, tout en impliquant les puissances régionales, Turquie, Arabie Saoudite, Iran et Égypte ; sorte de hiérarchie à deux niveaux, les autres acteurs locaux, ne se situant qu’au troisième rang. En fait Bertrand Badie va au-delà de cette critique qu’il adresse aux divers « concerts des nations ». À ses yeux il ne s’agit que ce procédé diplomatique des plus classiques n’apparaisse au mieux qu’une tentative de règlement des divergences extérieures entre États souverains. Celle-ci se situe dans une logique de pure puissance sans que les diverses sociétés humaines dans toute leur épaisseur et leur diversité ne soient impliquées. Cela est d’autant plus regrettable que la plupart des conflits ne sont plus interétatiques, mais intraétatiques. D’où son plaidoyer pour une sociologie des relations internationales ouvrant des perspectives nouvelles. En premier lieu, celles-ci ne doivent pas être tenues pour une sphère à part : elles sont des faits sociaux comme les autres, elles sont conscrites, elles aussi, dans le tissu de notre univers quotidien, même si c’est à une échelle particulière. Fort bien mais qu’est-ce à dire ? D’ores et déjà le spécialiste des relations internationales, comme le praticien, devrait être à la fois historien, juriste, un peu géographe, plus encore économiste, linguiste, devra-t-il aussi devenir sociopsychologue, expert culturel, spécialiste de la psychologie des peuples, un « psychologue social », un « médiateur culturel », un « médecin des âmes » ? Et que sais-je encore ? N’est-ce pas trop demander à un seul homme, ou à un seul Département ministériel ? On verra si dans les années et décennies à venir le métier de diplomate saura évoluer dans cette direction, cela est plus facile à écrire qu’à faire, mais ne perdons pas espoir. Sa seconde constatation est plus banale : qui peut nier désormais que les relations internationales n’obéissent plus à la seule initiative des États, que ces derniers sont de plus en plus promis à réagir à la dynamique des sociétés plutôt qu’à agir sur elles. S’agit-il vraiment d’un élément nouveau ou celui-ci n’a-t-il pas pris son ampleur à la faveur de la mondialisation. Après tout, les internationales ouvrières, celles des syndicats, pour ne pas parler du gotha des familles princières, existaient déjà au XIXe siècle et transcendaient les frontières nationales.
L’ouvrage de Bertrand Badie qui contient bien d’autres réflexions actuelles est donc stimulant, provocateur même, et pousse le lecteur à la réflexion et à lui remettre en cause bien des idées et des comportements reçus. Mais rétorquons-lui que s’il a raison dans maintes de ses affirmations, où nous mènent-elles en fin de course ? « L’efficacité de la puissance s’effrite face aux formes nouvelles de violence et de conflit : on entre vraiment dans le XXe siècle ». À ses yeux le 11 septembre 2001 signifiait que la violence ignorait les frontières (les a-t-elle vraiment toujours respectées) et que la notion de souveraineté perdait de sa pertinence. Cette dernière affirmation va loin : la Russie de Poutine ne revendique-t-elle pas son droit à la souveraineté, c’est-à-dire du droit de décider seul de ses intérêts vitaux, en dehors des pressions extérieures, ce qu’a cherché à faire en son temps le général de Gaulle pour la France.
Il consacre un fort chapitre de 42 pages à la politique extérieure française, « La France, des ambitions contrariées aux défis de l’altérité », qui à lui tout seul est un opuscule et doit être lu avec le plus grand intérêt. Mais s’il est de bon ton de brocarder les États sur qui sinon eux doit reposer la lutte contre le terrorisme international ? Peut-on confier cette tâche aux multinationales, aux ONG, aux Églises, même si ces différentes instances peuvent et doivent y contribuer plus que jamais dans leur domaine d’activité ou d’influence. Aussi le professeur Badie nous semble plus excellent dans le diagnostic que dans la prescription. Qu’il est éloquent dans sa description des nouveaux conflits à étages : « Politique imparfaite et inachevée, atrophie de la société civile, déficit institutionnel, et faible légitimité des pouvoirs existants, défaillance de la construction nationale, et absence de véritable contrat social, pathologies liées aux carences du développement humain, et social, sentiment d’humiliation collective ». Quel pays, quel État, quelle population, ethnie, groupe religieux actuellement dans le monde peut-il se targuer d’échapper à l’une de ses stigmates s’il ne le concentre pas tous ? Certains y verront la description du terreau sur lequel a proliféré le djihadisme, les autres y verront la description des « damnés de la terre » ou les manifestations de l’humiliation russe et du désir de revanche chinois. Il est vrai malheureusement qu’« aucune des guerres nouvelles menées par une puissance du Nord n’a débouché sur une victoire probante ». Mais ne fut-ce pas déjà le cas de la Première Guerre mondiale qui fut suivie d’un armistice de vingt ans ? Certains milieux aux États-Unis se sont targués d’avoir gagné la guerre froide et se sont comportés en conséquence, avec la conséquence que l’on a vue. Or, George F. Kennan, le père de la théorie du containment a préconisé la retenue à Bill Clinton.
En conclusion, Bertrand Badie réitère son credo : « La loi d’airain de l’oligarchie internationale doit être brisée comme elle l’a été jadis à l’échelle des nations, replaçant l’acteur concerné au centre de la délibération nationale ». Quel est cet acteur et ces acteurs, leur légitimité, leurs objectifs, leurs poids ? Où a-t-il vu que l’oligarchie a disparu au niveau national. Aux États-Unis, où l’argent domine la scène électorale ; en Chine, où les barons rouges s’érigent en dynasties ; en Russie, où dominent différentes oligarchies. Notre monde est une arène où s’affrontent encore ambitions et intérêts, même si l’espace de coopération et d’harmonie tend à s’étendre. N’en témoigne pas le tout récent effort de l’ONU d’aboutir à un traité international sur la haute mer, qui couvre 55 % de la surface du globe, resté jusqu’à présent sans règle commune.