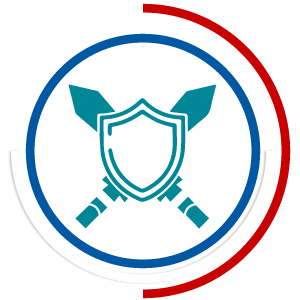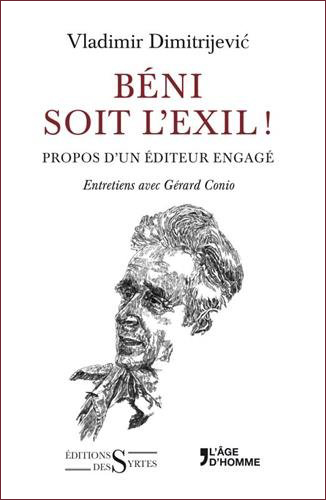
Fuyant la Yougoslavie communiste, Vladimir Dimitrijevic (1934-2011) est arrivé en Suisse en 1954. Après avoir travaillé comme ouvrier, puis footballeur professionnel (!), il ouvrit une petite librairie à Lausanne. Il fonda ensuite les éditions L’Âge d’Homme en 1966. Lors de sa mort accidentelle en 2011, au volant d’une camionnette chargée de livres, son catalogue comportait 4 500 titres.
À l’époque de la guerre froide, Dimitrijevic fut le premier à faire connaître au public francophone les écrits des dissidents des régimes communistes, s’attirant ainsi les foudres de l’intelligentsia occidentale d’alors.
En 1972, il rencontra l’universitaire Gérard Conio, spécialiste des littératures slaves, ce qui marqua le début d’une fructueuse collaboration éditoriale et d’une grande amitié. Cette passion de la conversation, qui animait Vladimir Dimitrijevic, donna lieu à un certain nombre de causeries informelles, dont Conio enregistra certaines au fil des années. Elles forment la matière de ce livre qui nous permet de découvrir à la fois un homme et un éditeur, fidèle à sa réputation de courage et de non-conformisme.
Vladimir Dimitrijevic était d’abord un humaniste, qui se rattachait expressément à l’« humaine condition » décrite par Montaigne, mais ce fut aussi un humaniste chrétien. Sa réflexion s’appuyait en effet sur une profonde foi orthodoxe, qu’il évoque d’ailleurs souvent dans ses discussions avec Gérard Conio. Il écrivit lui-même des pages magnifiques sur le Christ, manifestant ainsi une profondeur spirituelle étonnante pour un laïc, comme de nombreux commentateurs l’ont relevé. Dimitrijevic mettait ainsi en exergue ce qu’il voyait comme l’universalité de la pensée chrétienne à travers l’orthodoxie, l’appartenance nationale venant après et restant secondaire.
Dans ses entretiens, il critique une civilisation du gaspillage basée sur une manière « horizontale » de régler les choses, « gaspiller me semble aller à l’encontre de tout ce que Dieu nous a légué » avoue-t-il. Était fondamental pour lui, en effet, le lien entre la culture et la nature. C’est sa foi qui lui permet de rejoindre dans la même critique les sociétés communiste et occidentale en tant que « sociétés sans pardon ». On relève aussi dans ses entretiens une obsession du dépouillement, ainsi qu’une avidité de connaître et de faire connaître, de transmettre aux autres.
Dimitrijevic fut aussi un grand éditeur avec une conception personnelle de son métier. Ce fut tout d’abord dans les termes de Conio, « un mystique de l’édition ». Il menait « une vie ascétique, mangeant des sandwiches et dormant dans son camion afin de pouvoir éditer un livre de plus ». Il résista jusqu’au bout à la marchandisation qui est devenue aujourd’hui la principale règle de l’édition et n’a jamais considéré le livre comme un produit.
Au début de son aventure éditoriale, se trouve un véritable amour de la littérature remontant à ses années de lycée en Yougoslavie, de la littérature universelle, par-delà les frontières. Les grands livres, explique-t-il « ce sont des livres ainsi faits que, de Sophocle à nos jours, on les ressent comme écrits tout spécialement pour nous ». De là l’idée que la littérature est un contre-pouvoir spirituel : « Le véritable écrivain est celui qui dit ce qui ne se dit pas, qui fait ce qui ne se fait pas ». Partisan de « la vérité face au compromis », en opposition avec la phrase de Sartre bien connue (« Il ne faut pas désespérer Billancourt »), Vladimir Dimitrijevic fut souvent conduit à prendre des positions à contre-courant. Il se considérait comme un « dissident » et voulait avant tout se mettre au service des dissidents. Célébré comme tel à l’époque communiste, il le resta depuis 1991.
Il avait l’obsession des « lacunes », des cases vides dans la littérature (se référant ainsi à Mendéléiev qui lors de l’établissement de sa table des éléments avait laissé des cases vides qui seront remplies par ses successeurs), « trouver les pièces manquantes de la mosaïque », même dans la littérature française ou suisse. Il a fini d’ailleurs par publier presque toute la littérature suisse.
Comment Dimitrijevic choisissait-il les auteurs qui allaient remplir ces « cases vides » littéraires ? Il nous l’explique longuement dans cette série d’entretiens : « Je ne choisis pas les écrivains qui colportent les idées reçues » ; « je publie les écrivains qui, d’après-moi, expriment quelque chose d’original, que les autres n’ont pas admis, que les autres n’ont pas senti, et je m’attache à ces écrivains, qui sont, comme je les appelle, un peu à côté. » Ce qui est beau dans un texte, disait-il, ce sont ce qu’il appelait les « idées fulgurantes ».
Ce qui importait surtout pour lui c’était l’engagement de chaque auteur dans son œuvre personnelle. Il n’aimait pas les auteurs qui cédaient à ce qu’il appelait le « pacte de soumission avec la puissance dominante ». Lorsqu’il découvrait une œuvre, Dimitrijevic, craignait, lorsqu’il la lisait pour la première fois, que l’auteur ne se livre à un compromis, n’aille pas jusqu’au bout de sa démarche, se trahisse, pour se conformer à cette « loi du monde » qui oblige chacun à faire des compromis, à « pactiser ». Pour Vladimir Dimitrijevic, l’œuvre doit être ce qu’est l’auteur. La littérature, pour Dimitrijevic, devait ainsi « porter témoignage ». Il ne choisissait jamais les livres à éditer en fonction de ses goûts personnels, mais au contraire en raison de l’authenticité qui émanait de l’œuvre en question. Il évoquait ainsi dans ses entretiens la recherche d’un « noyau irréductible… fait de l’acceptation et de l’appropriation de l’autre, non appréhendé dans ce qu’il a d’identique à moi, mais dans son essentielle différence. On retrouvera cette intégrité chez tous les écrivains que je fréquente, si bien que, dès qu’il y a un penseur ou un romancier qui s’approche de ce noyau, j’ai la fâcheuse tendance de considérer que son livre a été écrit pour moi. » Il reprenait ici l’idée de Witkiewicz qui évoquait l’« unité dans la multiplicité » (tous ses auteurs avaient en commun un certain « noyau »). Dimitrijevic considérait d’ailleurs son catalogue comme son « portrait-robot ».
Ces entretiens révèlent enfin quelques-unes de ses bêtes noires, la principale étant le système de Hegel et l’idéalisme allemand !
Le recueil d’entretiens avec Gérard Conio est un livre capital pour tous ceux qui s’intéressent à la littérature universelle.