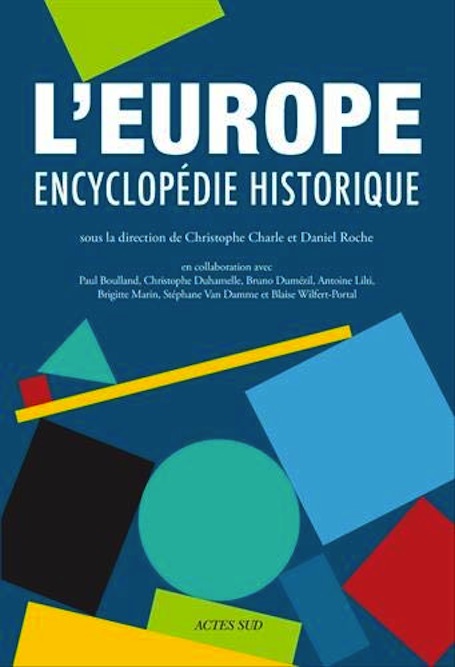
L’Europe, pourquoi comment, jusqu’où se demandent dans leur copieuse introduction, les maîtres d’œuvre de cette monumentale entreprise éditoriale qui a réuni plus de 430 spécialistes de tous les pays, de tous les horizons de toutes les disciplines. Au moment où l’Europe ne sort pas de l’histoire, mais s’interroge plus que jamais sur son destin, son avenir, sa cohésion et stabilité, sa sécurité et son « autonomie stratégique », il paraît nécessaire de mieux savoir d’où elle vient cette Europe, ce cap extrême de l’Asie, qui a conquis jadis les trois quarts de la planète. Car elle semble se retirer à petits pas de la scène mondiale, l’Europe, celle du moins où s’affrontent à nouveau les « gladiateurs » de Hobbes, les États continents ces « constructions impériales » que sont les États-Unis, la Russie, la Chine et demain l’Inde, le Brésil peut-être.
C’est sur une longue période de 1 500 ans, de la chute de Rome jusqu’à nos jours, presque jusqu’aux élections européennes de mai 2019, que s’est penchée la riche pléiade d’auteurs. À titre d’exemples, puisque maintes célébrations se scandent autour du chiffre 8, cher aux Chinois, on trouvera une entrée sur les Traités de Westphalie (1648) qui ont jeté les bases d’un ordre mondial, axé sur la souveraineté exclusive des États, détenant le monopole de la force armée, faisant sortir l’Europe du Moyen Âge, du « rêve impérial » ou de la monarchie universelle, un moment caressé par Charles Quint, repris plus tard par Napoléon et Hitler, la coupant également de la papauté, laquelle exerçait une tutelle sur les rois, les reguli.
Puisque se sera tenu à Paris le 11 novembre, le Forum de la Paix, réunissant une soixantaine de chefs d’État et de gouvernement, le lecteur se plongera dans le récit de certaines batailles épiques de la Grande Guerre, de l’armistice du 11 novembre 1918, du Traité de Versailles, qui, en créant la SDN, ancêtre de l’ONU, entendait poser les bases d’un premier ordre mondial, de paix, de stabilité, et de prospérité, qui a été jeté à terre par étapes le coup final ayant été assigné par les accords de Munich, antichambre de la Seconde Guerre mondiale, dont est issu notre ordre mondial édifié en 1945, à Yalta et Potsdam. Ce tournant qui a vu la création de l’ONU et de maintes institutions internationales, multilatérales, auquel un Donald Trump s’évertue à donner des coups de hache.
Le lecteur de la Revue Défense Nationale prendra certainement plaisir à lire les nombreux articles consacrés à l’art militaire et à la façon de mener la guerre, tel que ces notions ont évolué au cours des siècles. Si la notion de guerre juste tient au droit de déclencher et de mener une guerre, il lui est progressivement lié la manière de faire la guerre, l’appréciation des comportements légitimes des guerriers en action. Comment s’est forgée la figure de l’ambassadeur, passé du courtisan à l’expert. Il tirera profit des enseignements des grands Congrès de la Paix, dont les règles et secrets n’ont pas fondamentalement changé et que l’on aimerait voir réunis pour régler bien des questions internationales brûlantes, Palestine, Syrie, Corée… Il tirera également profit de la lecture de l’article consacré au cérémonial et rangs, notion et pratiques qui ont certes évolué avec le temps, mais n’ont pas perdu de leur charge symbolique et de leur utilité pour donner un sens au pouvoir et de son lien avec la société.
Un chapitre entier est consacré à l’Europe des guerres, des réformes et lumières. Un beau tour d’horizon des grandes guerres, des formations militaires, du rôle des mercenaires, comment est né l’uniforme, les multiples jeux des alliances et de la guerre des Traités de Westphalie à Potsdam. Plus on avance dans le temps, plus les techniques et moyens se perfectionnent, bombardements, déportés, rideau de fer, mais que d’autres entrées sur les révolutions, la torture, les murs… Des pans de civilisation sont scrutés de tous côtés et bien des phénomènes que l’on croyait engloutis dans un passé révolu font surface sous des formes nouvelles.
En se plongeant par petites doses dans les centaines d’entrées de longueur inégales, on entre dans la substance de l’univers européen. De ses frontières et périphéries d’abord, l’Oural, frontière tardive et la Sicile, l’île carrefour des mondes, ou la Crimée, la porte et le verrou. Comment ne pas inclure dans ces périphéries le Maghreb, si proche et si présent en Europe même. Que de capitales prestigieuses ont parsemé le sol européen d’Athènes à Madrid, de Lisbonne à Moscou, sans parler des villes mythiques, Weimar, Strasbourg, Genève, carrefours historiques, culturels et diplomatiques. Que de symboles européens ont marqué les esprits, châteaux, arcs de triomphes, places, drapeaux, de cultures partagées, de langues parlées, éteintes, apprises, qui ont procédé à de riches échanges et ont essaimé sur la planète ; quatre d’entre elles sont devenues les langues officielles ou de travail de l’ONU (anglais, français, espagnol, russe), le portugais étant également de portée mondiale.
Combats religieux, débats d’idées, inventions culturelles, combats politiques, d’idées ou affrontements culturels ont traversé les siècles, secoué les hommes, les âmes, les sociétés, et ont souvent été transposés aux antipodes. L’Olympisme, né et réapparu en Europe est devenu non seulement universel, mais fait figure avec la coupe du monde de football, comme on l’a vu l’été dernier en Russie, du seul grand lien réunissant hommes et femmes des cinq continents, au-delà de leurs différences religieuses, ethniques, sociales… Les Expositions universelles, la première industrialisation, l’État-providence, aujourd’hui remis en cause, la Bourse, cœur du capitalisme, autant de novations devenues mondiales, mais qui relèvent plus d’un glorieux passé que d’un avenir prometteur.
L’Europe n’est-elle destinée qu’à devenir un vaste musée, un continent pétri de nostalgie, temple du savoir vivre, de la civilité (qu’est-elle devenue ?), de la tolérance, qui s’effrite, de la gastronomie (la pizza est devenue un plat universel), des jardins, parfums et cosmétiques, qui ont valu à la Bourse de Paris sa belle croissance, étant donné l’appétit de la Chine pour les marques, produits de luxe français. Mais c’est la raison d’être de cette si riche et abondante encyclopédie que d’être historique. L’Europe a tant apporté au monde, s’est abreuvée au monde, qu’elle doit être assurée de son avenir, s’en donner les moyens, le désir et la volonté. Un monde sans une Europe active, et présente, serait un monde amputé d’une grande partie de lui-même. C’est l’une, et loin d’être la seule leçon que livre cette Encyclopédie historique, dans laquelle chaque lecteur et lectrice trouvera son centre d’intérêt, réponse à ses interrogations, confirmation ou approfondissement de son savoir. Un vivant temple dont on sort ragaillardi sur l’Europe et son destin.






