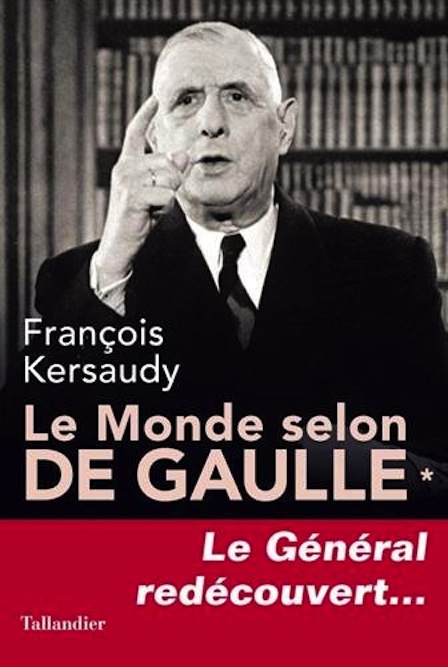
On se réfère souvent au général de Gaulle, sans l’avoir toujours bien lu et médité. Il est vrai que cet homme d’État, qui, depuis juin 1940, écrivait deux heures par jour, a laissé bien des discours, lettres, notes, Mémoires, confidences qu’ont notées ses collaborateurs les plus proches, au premier chef Alain Peyrefitte qu’il voyait presque chaque jour. Le mérite de François Kersaudy, qui a enseigné aux universités d’Oxford et de Paris I, auteur de De Gaulle et Churchill et d’une biographie de Churchill est de se situer à ces hauteurs et d’avoir su choisir, parmi l’abondant corpus gaullien, les passages ou citations les plus appropriés. Les thèmes qu’il a choisis sont vastes mais portent sur les questions essentielles. Celles du destin de la France d’abord (Pétain et Vichy, la France libre et la Résistance), de l’État et des institutions, et de l’Algérie. Des sujets aujourd’hui largement historiques mais qui ont laissé des blessures toujours non guéries ou dépassées. Mais l’essentiel – de quoi nous combler – porte sur les thèmes de politique extérieure.
On trouvera ainsi nombre de remarques, pensées, réflexions du général de Gaulle, sur Churchill et l’Angleterre. Il ne cachait pas son admiration à l’égard du Premier ministre britannique, dont il a rendu un hommage prononcé à sa mort ; mais leurs relations n’ont pas, on le sait, été toujours aisées. Durant la première semaine de combat en France après le 6 juin leurs relations furent même glaciales. « Churchill est un gangster ! ». Lorsqu’il apprit que le vieux lion fêtait ses soixante-treize ans, il laissa échapper : « Je vous le dis : celui-là, c’est la méchanceté et l’alcool qui le conservent. » Mais admirons surtout la lucidité du chef de la France libre : « Churchill a été magnifique jusqu’en 1942. Ensuite, comme s’il était épuisé par un trop gros effort, il a laissé le flambeau aux Américains et s’est effacé derrière eux. » De fait, ce fut à partir de cette année le début de l’hégémonie américaine en Occident et la naissance du monde bipolaire. On connaît ses relations combien difficiles avec Roosevelt et les États-Unis, le Président américain ne voyait en lui qu’un dirigeant autoritaire, voire un vulgaire dictateur. « Roosevelt est fou ! », clama de Gaulle le 8 juin 1944 lorsqu’il apprit que les États-Unis voulaient se conduire en France comme en pays occupé. Puis cette remarque qui n’a rien perdu de sa force : « Ce pauvre Roosevelt, il a tout bâclé, parce qu’il se voyait déclinant. Alors cela s’est appelé Yalta ! La grande affaire en politique, cher ami (il s’adressait en mai 1946 au journaliste Jean-Raymond Tournus), c’est de savoir se retirer à temps. » Que de remarques ajustées en particulier sur Eisenhower et Kennedy, de Johnson même qualifié de « cow-boy ». Qu’aurait-il dit de Trump ! l’Union soviétique aussi nous vaut de copieuses réflexions, sur Staline et ses successeurs. À une question de Jackie Kennedy, lui demandant lequel de tous les nombreux chefs d’État qu’il avait rencontrés avait le plus d’humour, sa réponse fuse aussitôt – Staline, Madame ! À un de ses ministres qui émettait l’opinion (avant la crise de Cuba) qu’avec Khrouchtchev, nous risquions d’aller à la guerre, il répond : « Vous n’y pensez pas, il est trop vieux et trop gros ! »
Au-delà de ces réflexions saisies le plus souvent sur le vif, qui dénotent le trait d’esprit et l’humour, ce sont les prophéties du général de Gaulle qui frappent par leur lucidité et leur prémonition, c’est avec elles d’ailleurs que débute le livre de François Kersaudy. En 1915, il prévoit l’entrée en guerre de l’Italie et de la Roumanie. En 1928, dix ans avant sa survenance, il estime que l’Anschluss est proche. Plus étonnant encore après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, il prévoit que la guerre est définitivement gagnée, mais qu’elle se poursuivra en deux phases. La première verra le sauvetage de l’Allemagne par les Alliés ; la seconde verra une guerre entre les Russes et les Américains. En 1941, il confie à son fils Philippe : « Je connais les Allemands. Un jour, eux et nous marcherons du même pas, car nous avons trop de choses en commun. » En 1965, il prévoit l’éclatement de la Yougoslavie : le jour où Tito s’en ira, les Croates, les Serbes, les Bosniaques mettront leur passion à lutter entre eux… Ce sont des peuples guerriers. Sur le Vietnam, il prévoit dix ans avant – en 1965 – le retrait sans honneur des États-Unis. En 1966, il confie au sénateur américain Frank Church : « Il faudra à la Chine trente-cinq ans pour devenir une grande puissance, mais elle en a pris le chemin. » De fait, c’est à compter de l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001 que le monde a assisté à son stupéfiant décollage.
Au moment où se déclenche la guerre de Six Jours, en juin 1967, de Gaulle prévoit la victoire écrasante de Tsahal, mais ajoute : « Ils sont fous ! Je les avertis, ils vont provoquer un phénomène qu’ils ne soupçonnent pas : le terrorisme. » L’OLP est créée en 1969, le monde entre dans l’ère du terrorisme… À Peyrefitte, il confie le 9 septembre 1967, au château Wavell de Cracovie : « Les jeunes Polonais d’aujourd’hui secoueront le joug soviétique. C’est inscrit sur le mur ! » On pourrait multiplier de tels éclats de lucidité, terminons par celle, datant du 17 mars 1949, avant la signature du pacte Atlantique : « L’Amérique est un pays essentiellement isolationniste parce que c’est une île. Elle ne s’est jamais sentie solidaire de l’Europe, dont il est, ma foi, vrai qu’elle est séparée par une grande étendue d’eau. » Cela vaut bien la fameuse formule d’André Siegfried, le père de la science politique française (né au Havre le 21 avril 1875 et mort à Paris le 28 mars 1959, sociologue, historien et géographe français, pionnier de la sociologie électorale) : « L’Angleterre est une île entourée d’eau de toutes parts. » Sont-ce les thalassocraties anglo-saxonnes qui se détachent du continent européen ou celui-ci qui s’apprête à voguer seul sur les mers agitées du globe ?






