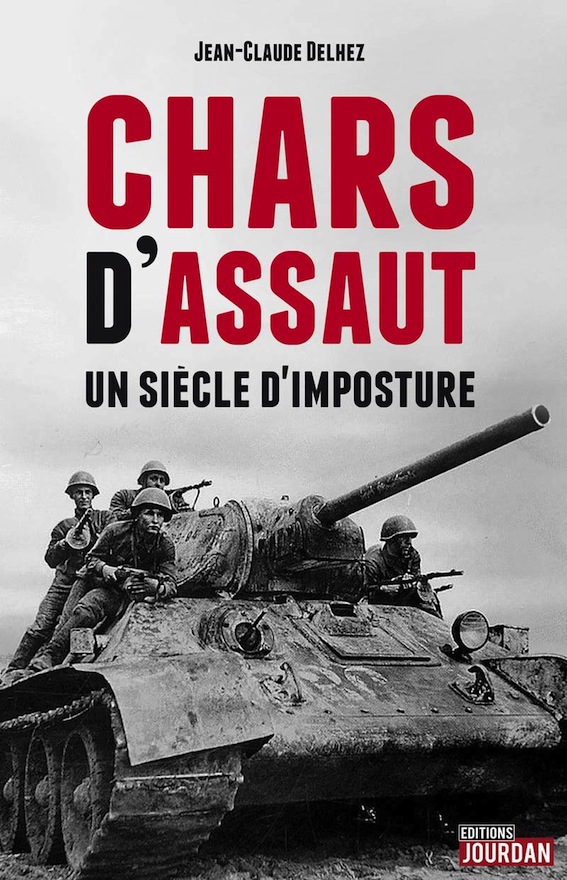
Jean-Claude Delhez n’aime pas les chars. C’est le moins que l’on puisse dire. Dans un livre-réquisitoire, cet historien et journaliste belge, auteur de plusieurs ouvrages portant sur les deux guerres mondiales (cf. La bataille des frontières, Joffre attaque au centre 22-26 août 1914, Paris, Économica, 2013), s’efforce ici de nous démonter que les chars d’assaut, qu’il assimile à des canons roulants dont le seul objet serait de détruire d’autres chars, n’ont strictement aucune utilité sur le plan militaire.
Pour les besoins de sa démonstration, l’auteur consacre les deux tiers de son livre à l’élaboration de statistiques qui ne s’avèrent finalement, ni représentatives, ni incontestables. Il s’agit ainsi de résumer, laborieusement, une centaine d’affrontements mettant en jeu des blindés lors de la bataille de France en 1940, puis de l’offensive des Ardennes à l’automne 1944.
Cette multitude d’engagements, ou d’escarmouches, impliquent à chaque fois un très petit nombre de blindés, et pour la plupart restent relativement indécis à leur niveau (celui du peloton ou de la compagnie), ce qui n’est guère surprenant. Delhez procède néanmoins à ce qui s’apparenterait grossièrement à une intégration (au sens mathématique) afin d’en extraire des statistiques (succès/échec ; causes de la destruction des blindés ; « prédateurs » des blindés, etc.). La démarche est étrange sur le plan méthodologique, et fait penser aux paradoxes du philosophe pré-socratique Zénon d’Élée (« Achille et la tortue », etc.), qui visaient à l’époque à démontrer l’impossibilité du mouvement en le découpant en tranches d’immobilité. Car en effet, en mai 1940, les panzers de Guderian et de Rommel, dont l’emploi, selon Delhez, se résume à une succession d’échecs tactiques, ont bien, en fin de compte, atteint la Manche en quelques jours et enfermé en Belgique une grande partie de l’armée française…
La réponse de Jean-Claude Delhez est toute trouvée : « L’acteur clé de la percée de 1940, ce ne sont pas les blindés, mais bien les fantassins. » Pour lui, en effet, sans infanterie, les Panzerdivisionen « ne pouvaient accomplir leur mission. Alors que l’absence de Panzer n’aurait rien changé au scénario historique, sauf peut-être un léger retard… ». À travers une série d’approximations (« la guerre éclair ne doit rien au char, elle doit presque tout à l’idée de Manstein », etc.), Delhez omet de nous exposer les concepts stratégiques mis en œuvre, même s’il cite incidemment dans une note de bas de page les vraies raisons du succès opératif allemand : pertinence du plan Manstein (coup de faucille), décentralisation du commandement (Auftragtaktik), création de groupements tactiques interarmes (Kampfgruppe).
Or, nous avons ici un témoin capital, un peu oublié aujourd’hui, en la personne d’Antoine de Saint-Exupéry, pilote de reconnaissance en 1940, qui tirera quelques années plus tard les enseignements de ce qu’il a pu observer personnellement lors de ces quelques semaines de mai, oh combien critiques pour l’armée française : « … ces raids de tanks qui circulent aisément, faute de chars à leur opposer, entraînent des conséquences irréparables, bien qu’ils n’opèrent que des destructions en apparence superficielles (telles que capture d’états-majors locaux, ruptures de lignes téléphoniques, incendies de villages). Ils ont joué le rôle d’agents chimiques qui détruiraient, non l’organisme, mais les nerfs et les ganglions. Sur le territoire qu’ils ont balayé en un éclair, toute armée, même si elle apparaît comme presque intacte, a perdu son caractère d’armée. Elle s’est transformée en grumeaux indépendants. Là où il existait un organisme, il n’est plus qu’une somme d’organes dont les liaisons sont rompues. Entre les grumeaux – aussi combatifs que soient les hommes – l’ennemi progresse ensuite comme il le désire. Une armée cesse d’être efficace quand elle n’est plus qu’une somme de soldats » (Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre, Gallimard, 1942, p. 82-83.) Tout est dit ! Peu nombreux furent ceux qui comprirent si clairement dès cette époque la nouveauté que représentait la guerre éclair sur le plan stratégique.
Sur un plan technique, on considérait les B1bis et les Somua français, et les Matilda britanniques, comme supérieurs à leurs homologues allemands mais Delhez nous détrompe : « L’intervention des chars alliés dans le combat se concluant, systématiquement, ou presque, par des échecs, souvent cuisants, on peut en conclure que la valeur militaire de ces engins était à peu près nulle. Il n’y aurait pas eu le moindre char dans les armées alliées de 1940 que ça n’aurait pas changé le déroulement de la campagne d’un iota. » Parfois, Delhez, dans sa verve, brûle même les étapes du raisonnement logique : « Les DCR ont très peu d’infanteries (sic). Ce ne sont donc pas les meilleures divisions françaises mais les pires. »
En s’efforçant de déconstruire un certain nombre de « mythes », dans la vague d’une mode historiographique récente, l’auteur se retrouve souvent prisonnier de son élan, ce qui le conduit à écrire qu’« à l’inverse de ce que prétend l’historiographie, les belligérants de 1940 n’ont pas agi autrement que leurs parents de 1918. Ce sont les alliés, Français et Britanniques, qui ont utilisé le char en masse. Et ce ne furent que des échecs. Quant aux Allemands, ils lui ont préféré une infanterie mordante, bien soutenue par toutes les armes disponibles ». Le général allemand Hermann Balck (1893-1982) montre pourtant bien dans ses mémoires comment l’apparition du char a entraîné un changement de paradigme en faisant de l’attaque la forme supérieure de combat, et ce même dans un contexte opératif défensif, comme le fut celui de la Wehrmacht après 1943 (Hermann Balck, Order in Chaos, The memoirs of General of Panzer troops Hermann Balck, trad. D. Zabecki et D. Biedekarken, University Press of Kentucky, 2015, p. 447).
L’argument final de l’auteur à l’encontre du char tient dans un raccourci historique frappant : Napoléon en 1812 serait arrivé à Moscou « en moins de trois mois et à pied, les Allemands avec leurs panzers en cinq mois et dix jours ! ».
L’ouvrage se termine sur une analyse psychanalytique de bas étage assimilant le canon du char à un symbole phallique, et cela dans un chapitre final s’efforçant de démontrer que le char est une arme de guerre psychologique. L’argument choc étant que « les pays les mieux dotés en chars, aujourd’hui, sont aussi les régimes les plus autoritaires de la planète » !
Malgré ses outrances, le livre conserve néanmoins quelque intérêt. Il pose tout d’abord une question lancinante depuis la fin de la guerre froide : « Quel est l’intérêt pour une armée, hier, aujourd’hui, demain, de posséder des chars dans son ordre de bataille ? » Il est dommage que là où certaines études récentes (cf. Antoine d’Évry, « Les chars, un héritage intempestif ? », Focus stratégique n° 53, Ifri, septembre 2014) traitent cette question d’une manière mesurée et équilibrée, Jean-Claude Delhez se croie investi d’une mission de procureur et instruise le procès des chars d’assaut systématiquement à charge, et au surplus à partir d’un dossier très partiel qui ne recoupe que deux périodes historiques bien déterminées (la percée de Sedan en mai 1940, et l’offensive des Ardennes en décembre 1944) et d’une durée de quelques semaines au maximum.
Ce biais méthodologique aboutit à négliger d’un trait de plume le rôle essentiel que les blindés, employés en masse, et en combinaison avec l’infanterie portée, ont joué sur le front de l’Est pour les deux belligérants et en particulier dans les coups de boutoir opératifs de l’armée rouge en 1943 et 1944. Pour les conflits plus récents, on pourrait également évoquer le raid blindé américain dans Bagdad en 2003 qui a mis fin au régime irakien. L’approche de Delhez qui a choisi ici de considérer le char, uniquement comme un canon anti-char sous blindage, est ainsi particulièrement réductrice et néglige son emploi principal à l’encontre de l’infanterie.
L’ouvrage de Delhez a le mérite également de nous rappeler les circonstances historiques de la naissance du char d’assaut. Pendant le premier conflit mondial, était ainsi apparue la nécessité d’une arme d’appui mobile capable de franchir les tranchées et les réseaux de barbelés : « L’idée première du char était la bonne : une arme de soutien d’infanterie, une manière d’accompagner l’assaut des soldats avec un canon ou une mitrailleuse. » C’est en fait exactement la tendance actuelle, que l’étude de l’Ifri citée plus haut confirme parfaitement en montrant que l’intérêt des chars, même en zone urbaine, réside essentiellement dans leur synergie avec l’infanterie.
Autre mérite du livre de Delhez : le fait de mettre l’accent sur la grande efficacité de l’artillerie antichar lors de la Seconde Guerre mondiale (cf. : la bataille de Gembloux en 1940, le killing ground de Médenine en Afrique du Nord en 1943), ce qui est assez peu évoqué aujourd’hui par les historiens militaires.
Enfin, un chapitre intitulé « La supercherie Patton » démonte le mythe qui s’est construit autour des talents supposés de tacticien du général américain, que l’auteur qualifie en outre de criminel de guerre à la suite de l’exécution de prisonniers lors des campagnes de Sicile et d’Allemagne.
Avant de conclure il convient de préciser que la description des engagements évoqués par Delhez s’appuie sur une dizaine de cartes, lesquelles, fort bien réalisées au demeurant, ne figurent pas dans le livre mais sont à télécharger sur le site Internet de l’éditeur !
La morale de cet ouvrage atypique est quant à elle difficilement contestable : même si l’auteur a consacré la plus grande partie de son livre à comparer des matériels, en oubliant souvent les hommes qui les servaient, il est finalement forcé d’en conclure que dans les affrontements qu’il a étudiés, « c’est l’esprit qui a vaincu, non la mécanique », ce sur quoi nous ne saurions lui donner tort.






